Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait
Ce document est la version HTML accessible du Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait, disponible en format PDF sur le site Web du Conseil du statut de la femme.
Table des matières
Avis
Dans la partie juridique de cet avis, les notes bibliographiques prendront la forme normalement appliquée dans le domaine du droit. Les normes de références bibliographiques du Conseil du statut de la femme, habituelles aux sciences sociales, auront cours dans le reste du texte.
Glossaire
- Conjoint
Chacune des deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui forment un couple, qu’elles soient liées par le mariage, par une union civile ou par consentement mutuel, ou union de fait.
- Conjoint de fait
-
Chacune des deux personnes qui forment un couple, de même sexe ou de sexe différent, vivant en union de fait ou union libre, et qui ne sont pas mariées ni unies civilement. Les conjoints de fait sont assimilés à des conjoints mariés, à moins que le contexte ne s’y oppose. Plusieurs lois et programmes fédéraux ou provinciaux, dont la liste se trouve dans les pages suivantes, accordent aux conjoints de fait des droits et des obligations comparables à ceux des conjoints mariés. La durée de vie maritale nécessaire pour que les couples soient reconnus comme conjoints de fait varie selon les lois et les programmes, mais la présence d’un enfant issu de l’union ressort comme un critère déterminant dans tous les cas.
Les quelques exemples suivants montrent bien que les programmes et la majorité des lois assimilent les conjoints de fait aux conjoints mariés, mais qu’il n’y a pas d’harmonie quant aux caractéristiques précises des conjoints de fait.
- Régie des rentes du Québec
-
« Votre conjoint de fait est la personne avec qui vous vivez maritalement depuis :
- au moins 3 ans
- 1 an si un enfant est né ou doit naître de votre union ou si vous avez adopté un enfant ensemble. »
- Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
-
« La personne qui, à la date du décès du travailleur :
- est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui;
ou
- vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe;
et
- réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union, et est publiquement représentée comme son conjoint. »
- Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
-
« Votre conjoint (de droit ou de fait). Un conjoint de fait est une personne de même sexe ou de sexe différent :
- qui vit maritalement avec vous depuis au moins un an;
ou
- qui vit maritalement avec vous et est le père ou la mère biologique ou adoptif (de droit ou de fait) d'au moins un de vos enfants. »
- Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
-
« Personne âgée d'au moins 16 ans, de même sexe ou de sexe différent :
- qui vit maritalement depuis au moins un an avec le garant ou le parrainé principal;
- qui a une relation maritale depuis au moins un an avec le garant ou le parrainé principal, mais qui ne peut vivre avec lui parce qu'elle est persécutée ou est l'objet d'un contrôle pénal. »
- Revenu Québec
-
« Le conjoint de fait est une personne (du sexe opposé ou du même sexe) qui, à un moment de l'année (…), selon le cas :
- vivait maritalement avec vous et était la mère ou le père biologique ou adoptif (légalement ou de fait) d'au moins un de vos enfants;
- vivait maritalement avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs (toute rupture de l'union de moins de 90 jours n'interrompt pas la période de 12 mois). »
- Agence du revenu Canada
-
« Un conjoint de fait est une personne qui n'est pas votre époux, qui vit avec vous dans une relation conjugale et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- elle vit avec vous dans une relation conjugale et votre relation actuelle avec cette personne a duré au moins 12 mois sans interruption;
- elle est le parent de votre enfant, par la naissance ou l'adoption;
- elle a la garde, la surveillance et la charge entière de votre enfant (ou elle en avait la garde et la surveillance juste avant que l'enfant atteigne l'âge de 19 ans). »
- Droit de retrait (Opting out)
En droit matrimonial, faculté donnée par la loi aux conjoints de se soustraire, par contrat, à l’application de la loi prévoyant le contenu et les modalités de partage du patrimoine familial, selon certaines formalités.
- Famille
Groupe de personnes qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, l’alliance, l’union libre ou l’adoption. Suivant le Dictionnaire du recensement 2011, une famille est formée des membres d’un couple marié ou vivant en union libre et de leurs enfants s’il y a lieu, ou d’un parent seul vivant avec au moins un enfant (Statistique Canada).
- Mariage
-
Union entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, dont la célébration peut être religieuse ou civile, qui détermine certains droits et obligations entre époux, notamment :
- respect, fidélité, secours et assistance;
- la protection de la résidence familiale et de ses meubles;
- le partage des biens accumulés pendant le mariage;
- le devoir d’assumer conjointement les dettes contractées pour les besoins de la famille;
- l’obligation alimentaire entre ex-conjoints;
- la possibilité d’obtenir une prestation compensatoire pour la contribution à l’enrichissement de l’autre conjoint. (Éducaloi; ministère de la Justice)
- Ménage
Une personne ou un groupe de personnes qui habitent sous le même toit. Un ménage peut se composer d’une ou de plusieurs familles partageant le même logement, d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une personne vivant seule.
- Obligation alimentaire
Obligation entre conjoints de subvenir aux besoins de la vie quotidienne de l’autre même après une rupture lorsque ceux-ci sont mariés ou unis civilement. L’obligation alimentaire s’applique aussi entre les parents et les enfants.
- Pension alimentaire (aliments)
Somme d’argent versée par un ex-conjoint à l’autre ex-conjoint pour lui permettre d’assurer sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, etc.) ou celle des enfants issus de leur union (pension alimentaire pour enfant).
- Union civile
Union entre deux personnes dont la portée juridique est comparable à celle du mariage. Entre 2002 (Loi instituant l’union civile) et 2005 (Loi sur le mariage civil), l’union civile était la seule possibilité pour des conjoints de même sexe de bénéficier d’un droit égal au mariage. (Éducaloi; ministère de la Justice)
- Union de fait (ou union libre)
Union conjugale entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, qui n’offre aucune protection juridique dans le Code civil du Québec aux conjoints en cas de rupture, à moins que ceux-ci n’aient conclu un contrat de vie commune.
Sources : Éducaloi www.educaloi.qc.ca; Statistique Canada www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=40000&lang=fra&more=1; Ministère de la Justice www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union-civ.htm#definitions.
Lois accordant aux conjoints de fait les mêmes droits et les mêmes obligations qu’aux conjoints mariés ou unis civilement (ministère de la Justice)
- Législation québécoise
- Loi sur les accidents du travail
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
- Loi sur l’aide financière aux études
- Loi sur l’aide juridique
- Loi sur l’assurance automobile
- Loi sur les assurances
- Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
- Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
- Loi sur les élections scolaires
- Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
- Loi sur les coopératives
- Loi sur les impôts
- Loi sur la taxe de vente du Québec
- Loi sur les normes du travail
- Loi sur les tribunaux judiciaires
- Loi sur le régime de rentes du Québec
- Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
- Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
- Loi sur les régimes complémentaires de retraite
- Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
- Loi sur le régime de retraite de certains enseignants
- Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
- Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
- Loi sur le régime de retraite des enseignants
- Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels
- Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale
- Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
- Loi sur l’aide financière aux études
-
Législation canadienne
- Régimes de pensions du Canada
- Loi sur la citoyenneté
- Loi sur l’assurance-emploi
- Loi de l’impôt sur le revenu
- Loi sur la sécurité de la vieillesse
- Loi sur le partage des pensions de retraite
- Loi sur les sociétés de caisse de retraite
- Loi sur l’emploi dans la fonction publique
- Loi sur la pension de la fonction publique
- Loi sur les régimes de retraite particuliers
- Loi sur les prestations de retraite supplémentaires
- Loi sur les allocations aux anciens combattants
Source : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm#Anchor-49575
Introduction
Le Québec est aujourd’hui la société industrialisée où l’on recense la plus grande proportion de couples vivant en union de fait. En 2011, 37,8 % des couples se retrouvent dans ce type d’union contre 62,2 % qui sont mariés. La tendance est encore plus frappante chez les jeunes: les deux tiers des femmes âgées de 15 à 34 ans vivant en couple étaient conjointes de faits (ISQ, 2011). De plus, 63 % des enfants naissent de parents non mariés.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a moins d’un demi-siècle, en effet, les conventions sociales empêchaient pratiquement qu’une femme et un homme vivent une relation conjugale sans s’être mariés. À moins d’avoir été officialisée par un acte de mariage, devant l’Église ou devant le législateur, leur union ne pouvait bénéficier de la reconnaissance sociale. Les couples cohabitant hors des liens du mariage étaient de ce fait très rares. En 1970, la situation reflétait encore largement cette vision. On estimait qu’à l’époque, environ 90 % des gens (88 % des femmes et 92 % des hommes) se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire. La propension à se marier a chuté depuis lors : en 2011, les taux de nuptialité ne sont plus que de 32 % pour les femmes et de 29 % pour les hommes.
L’importance croissante du nombre de couples en union de fait par rapport à celui des couples mariés est certainement liée à la mutation des valeurs sociales qui s’est manifestée au Québec à partir des années 1960. Ces transformations ont permis que l’union de fait, autrefois jugée immorale parce que contraire à l’ordre social, soit progressivement acceptée, puis reconnue socialement, et à certains égards juridiquement, au même titre que le mariage.
Ces changements sociaux ont amené la reconnaissance des conjoints de fait dans la plupart des programmes sociaux gouvernementaux, de même que sur le plan fiscal, où ils sont assimilés aux couples mariés, en présence d’un enfant issu de l’union ou de certains critères de durée de vie commune. Mais ces diverses transformations n’ont pas abouti à une redéfinition des rapports de conjugalité entre les conjoints de fait eux-mêmes en matière juridique. Ainsi, alors que la dernière réforme du droit de la famille au Québec, en 1980, visait à accroître la protection des époux lors de la rupture, notamment par l’introduction de la prestation compensatoire, il faut noter que les conjoints de fait en sont totalement écartés.
La réforme de 1980 reconnaissait également pour la première fois la pleine égalité des époux, et visait à donner un statut analogue aux enfants, qu’ils soient nés de parents mariés ou non, en abolissant la notion d’ « enfants naturels ». Avec le délaissement marqué de la nuptialité, voilà que ces acquis juridiques échappent aux couples non mariés.
Cette distinction sur le plan juridique entre les statuts conjugaux se fonde en grande partie sur la notion de liberté de consentement. En droit, un tel consentement doit être éclairé. Or, comme il sera plus amplement démontré dans cet avis, une grande confusion réside au sein de la population quant aux véritables droits et obligations entourant le statut des conjoints de fait, alimentée en grande partie par le fait que les programmes sociaux et les lois fiscales leur accordent les même obligations qu’aux couples mariés, ce qui laisse sous-entendre dans l’esprit de plusieurs qu’ils seraient titulaires des mêmes droits.
En outre, la notion de libre choix individuel occulte le fait que la décision de se marier formellement relève d’un accord mutuel. La jurisprudence récente, notamment l’affaire Éric. c. Lola1 qui a connu un grand retentissement public, a contribué à remettre à l’avant-scène les limites constitutionnelles du statu quo et la nécessité pour le législateur québécois de revoir l’encadrement juridique des conjoints de fait, dans un souci d’équité pour l’ensemble des citoyennes et citoyens, ainsi que pour tous les enfants du Québec.
À la lumière des changements significatifs qui sont survenus dans la conjoncture sociale au Québec depuis la dernière réforme majeure du droit de la famille en 1980, et pour les motifs plus amplement exposés dans cet avis, le Conseil du statut de la femme considère que le statu quo juridique n’assure plus une protection adéquate des femmes au chapitre de leurs droits collectifs, considérant le caractère systémique des disparités engendrées par la non-reconnaissance juridique de l’union de fait à l‘égard de celles-ci.
Le Conseil se préoccupe des conditions matérielles dans lesquelles les Québécoises vivront avec leur famille, advenant la rupture de leur couple, si leur union conjugale n’est pas pleinement reconnue par la loi. S’il a longtemps défendu un traitement différencié entre les couples mariés et non mariés lors de la rupture, c’était au nom de l’autonomie et de l’égalité des personnes, selon la conjoncture sociale de l’époque. Il soutenait que les femmes étaient sur la voie de l’autonomie économique et qu’elles seraient capables de faire le choix le plus avantageux pour elles, pour peu qu’elles reçoivent une information adéquate et complète sur les droits et obligations conférés par le mariage ou par l’union de fait.
Le Conseil défendait cette position, jugeant que l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, en leur permettant d’acquérir leur autonomie économique, les placerait en position d’égalité au sein du couple. De cette façon, elles seraient en mesure de négocier, avec leur partenaire, les aspects économiques de leur union et, le cas échéant, de leur séparation. Le Conseil tenait avant tout à ce que les femmes soient autonomes économiquement et qu’elles restent conscientes que la meilleure sécurité économique découle de la formation et de l’emploi.
Cette position semblait d’ailleurs justifiée par un lien statistique que l’on pouvait observer dans les années 1970, particulièrement au Québec, entre le niveau d’éducation des femmes qui vivaient en union de fait et celui des femmes mariées. Le recensement faisait en effet ressortir qu’en 1981, les femmes diplômées de l’université avaient moins tendance à contracter un mariage que les non-diplômées : 58 % des diplômées québécoises étaient mariées, ce qui était le cas de 73 % des femmes non diplômées. Pendant ce temps, 8 % des diplômées et 5 % des non-diplômées vivaient en union de fait. Ce lien statistique, suggérant que l’union de fait aurait été plus compatible avec l’autonomie économique des femmes, ne s’est pas maintenu dans le temps et, en 2006, l’influence des études universitaires (diplôme) sur la propension des femmes à se marier avait pratiquement disparu au Québec2.
Se montrant attaché au principe de liberté de choix pour les femmes, le Conseil a donc recommandé au législateur, dans les avis qu’il a publiés sur la question de 1979 à 1997, de ne pas inclure dans le Code civil de dispositions visant à assujettir les conjoints de fait aux mêmes droits et obligations que les conjoints mariés. Préserver la différence entre le mariage et l’union de fait devait permettre, selon lui, de respecter la différence d’intention entre les partenaires des deux formes d’union. Le Conseil préconisait alors la mise sur pied de campagnes d’information dans le but de favoriser les choix responsables et éclairés des femmes. Outre les droits liés au mariage et à l’union de fait, il soutenait que l’information devait porter sur les avantages qu’ont les conjoints de fait à conclure des conventions visant la propriété et le partage de leurs biens, ainsi que sur l’obligation alimentaire des conjoints à la suite d’une rupture.
Mais aujourd’hui cette posture ne cadre plus avec la réalité sociale québécoise. L’union de fait est de plus en plus répandue au Québec, et cette tendance est appelée à se maintenir, si l’on se fie au comportement des jeunes générations. Le nombre de couples vivant en union de fait s’est presque multiplié par 4 (3,7), entre 1986 et 2011, pendant que le nombre de couples mariés diminuait de 13 %. En 2011, parmi les jeunes femmes (âgées de 15 à 35 ans) vivant en couple, une minorité (32 %) était mariée. Et les naissances en dehors des liens du mariage sont maintenant majoritaires : alors qu’en 1981, 15,6 % des naissances étaient le fait de parents non mariés, cette proportion s’élevait à 63,3 % en 2012 (Institut de la statistique du Québec, « Naissances selon l’état matrimonial des parents, Québec, 1951-2012 »). En outre, ces unions de fait sont de plus en plus instables, tout comme les mariages : 12 ans après le début de la vie commune, près de la moitié des unions de fait datant des années 1990 ont mené à une séparation (Comité consultatif sur le droit de la famille, 2013, p. 10). S’ajoutant à ce contexte démographique, le fait qu’un grand nombre de familles monoparentales qui sont dirigées par une femme ont aujourd’hui à vivre dans la précarité financière à la suite de la dissolution de leur couple a poussé le Conseil à revoir sa position de façon à mieux tenir compte de la réalité des ex-conjointes et de leurs familles. L’enjeu de cette révision est de s’assurer que les conjointes de fait ne se trouvent pas désavantagées par leur statut matrimonial, en cas de rupture. Puisque l’investissement des femmes dans la sphère domestique se fait au détriment de leur sécurité économique, comme il sera démontré dans cet avis, le Conseil considère qu’il est nécessaire d’accorder une forme de protection juridique au conjoint de fait le plus vulnérable sur le plan économique (femme ou homme), lequel ne peut compter, dans l’état actuel du droit de la famille, sur pratiquement aucune compensation financière de son ex-conjoint à la rupture. Une révision allant en ce sens tiendra compte à la fois des choix individuels des femmes et de la protection des intérêts économiques de la famille, assurant ainsi leur protection sur le plan collectif.
Des études ont prouvé que la rupture ou le divorce entraînent une
baisse du niveau de vie des femmes (Crespo, 2009; Galarneau et Sturrock, 1997). La juge L’Heureux-Dubé a souligné, en 1992, dans l’arrêt
Moge c. Moge (Cour suprême du Canada, CanLII 25, paragr. 849) que la rupture du mariage avait des conséquences économiques difficiles pour les
femmes. Elle a repris cette idée dans son opinion dissidente dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh (2002,
paragr. 116) : « Il est bien connu que le divorce accroît la probabilité qu’un des conjoints divorcés vivra au-dessous du seuil de pauvreté. Ce problème
touche de la même façon les conjoints de fait hétérosexuels qui vivent une rupture. »
Même avec la protection du législateur, on le sait, le divorce ne garantit pas la sécurité économique des ex-conjoints, mais dans le cas de l’union de fait, l’absence d’encadrement légal visant à atténuer les conséquences financières en cas de rupture nous permet de supposer que les ex-conjointes de fait sont plus exposées à ce risque d’appauvrissement que les ex-épouses.
Cela contredit, selon nous, la théorie du choix éclairé qui se serait exercé au moment d’entreprendre la vie conjugale. Il est difficile, en effet, de soutenir que les femmes qui se trouvent appauvries par la rupture d’une union de fait aient véritablement choisi, en toute connaissance de cause, le type d’union qui protégerait le mieux leurs intérêts financiers. Elles n’ont pas pris non plus, dans le cadre d’un contrat avec leur conjoint, les moyens d’assurer une contrepartie financière à leur investissement dans les soins de la famille ou l’entretien de la maisonnée3, ni ceux d’encadrer les conséquences d’une éventuelle séparation.
Le Conseil estime que le choix par défaut de l’union de fait ne signifie pas d’emblée que les conjoints de fait – les femmes en particulier – souhaitent ainsi délibérément se soustraire à la protection du droit.
Qui plus est, la possibilité d’un choix réel est
limitée lorsque l’un des partenaires refuse de se marier. À propos des conjointes de fait, l’avocate Jocelyne Jarry se demande d’ailleurs avec justesse
: « Choisissent-elles vraiment de ne pas se marier ou subissent-elles
la décision d’un conjoint qui, lui, n’y voit assurément aucun avantage. Ainsi, il faut être deux pour se marier et le refus de l’un emporte le choix de
l’autre »
(Jarry, 2008 : 20). De même, dans le jugement de la Cour suprême Québec (Procureur général) c. A, connu sous le nom de
Éric c. Lola4, la juge Abella a soutenu que « le régime actuel fondé sur l’adhésion volontaire (…) ne reconnaît
pas que la décision de se marier formellement est une décision mutuelle. Un des
membres du couple peut décider de refuser de se marier ou de s’unir civilement et ainsi priver l’autre du bénéfice d’un soutien alimentaire nécessaire
lorsque la relation prend fin »
(2013 CSC 5, paragr. 375).
Les couples sont susceptibles d’adopter les mêmes comportements, au
sein de la maisonnée ou dans leur communauté, et ce, indépendamment de leur statut matrimonial. D’ailleurs, la juge Abella a fort bien décrit la similitude
des comportements des conjoints de fait et des conjoints mariés, lors du jugement Éric c. Lola : « Ils forment des unions de longue durée; ils se partagent
les tâches ménagères et il s’établit entre eux une grande interdépendance; et, fait crucial, le conjoint financièrement dépendant, et par conséquent
vulnérable, subit, au moment de la dissolution de la relation, les mêmes inconvénients que les conjoints mariés ou unis civilement »
(ibid.,
opinion de la juge Abella, paragr. 284). Nous démontrerons dans cet avis que les conjointes de fait ont tendance, tout comme les
épouses, à prendre de leur temps salarié pour s’occuper des enfants ou accomplir des tâches ménagères. Est-il équitable qu’advenant la rupture de leur
couple elles soient privées de la protection financière qui est accordée aux ex-épouses à la suite d’un divorce?
Cette situation est d’autant plus inéquitable que les conjoints de fait sont soumis, durant leur union, aux mêmes lois sociales et fiscales que les conjoints mariés. Pourquoi ce principe ne s’applique-t-il plus au moment de la rupture?
Le Conseil est d’avis que les conjoints de fait ne doivent plus être exclus du champ d’application des dispositions du Code civil en matière familiale et qu’il faut protéger les conjoints les plus vulnérables du risque d’appauvrissement lié à la dissolution du couple. En adoptant cette position, il n’ignore pas que les femmes du Québec se sont scolarisées massivement au cours des dernières décennies et que plusieurs d’entre elles exercent de nos jours des emplois mieux rémunérés que par le passé. Aujourd’hui, 29% des femmes vivant en couple touchent un revenu supérieur à celui de leur conjoint, ce qui ne veut pas dire que ce revenu est nécessairement élevé (Sussman et Bonnel, 2006). On le voit, la position du Conseil non seulement tient compte des intérêts individuels des femmes, mais vise aussi à préserver l’ensemble des familles des risques d’appauvrissement en cas de rupture de l’union de fait.
Depuis 2009, la cause très médiatisée d’Éric c. Lola
a mis cet enjeu sur la place publique. Selon un sondage datant de 2010 et portant sur cette affaire, une majorité de répondants appuyaient le statu quo. En
effet, 56 % d’entre eux affirmaient qu’en l’absence d’un contrat de mariage, « aucun des conjoints de fait ne devrait avoir de responsabilité
financière envers l’autre lors d’une rupture (excluant la pension alimentaire aux enfants) »
(Castonguay, 2010 : A4). Bien que « Lola », conjointe de
multimillionnaire, ne soit pas le meilleur exemple pour témoigner de l’appauvrissement des conjointes de fait après une rupture, son accès à des
ressources financières considérables lui a permis d’aller jusqu’en Cour suprême et de mettre en lumière les conséquences économiques qu’aurait, pour
d’autres femmes moins aisées, l’absence d’obligation alimentaire et de partage du patrimoine familial dans l’union de fait.
Jusqu’à maintenant, le mouvement féministe québécois n’a pas fait de cet enjeu une priorité de lutte, espérant que les femmes s’engagent sur la voie de l’indépendance économique. Seules la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) et une poignée de juristes du Québec demandent depuis plusieurs années une réforme du droit familial québécois qui tienne compte des conséquences économiques des ruptures des unions de fait. Compte tenu des réalités sociales et économiques actuelles, le Conseil considère que le respect du droit à l’égalité réelle requiert la reconnaissance de l’investissement des conjointes de fait dans la sphère privée.
Dans le présent avis, le Conseil s’intéresse principalement à la situation des couples composés d’une femme et d’un homme, mais il garde en vue qu’une réforme éventuelle s’appliquera à toutes les personnes vivant en union de fait, qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Les problèmes économiques découlant de la rupture sont aussi présents dans les unions de même sexe.
Nous décrirons, au premier chapitre, le contexte social qui existait, au Québec, à la transformation du couple et de la famille, entre les années 1970 et aujourd’hui, ainsi que la croissance du nombre d’unions de fait qui en a résulté. Le deuxième chapitre présente un portrait statistique des familles : on y confirme la prévalence des unions de fait et des naissances hors mariage, dans la société québécoise d’aujourd’hui, ainsi que la place croissante des familles monoparentales. Des données permettent ensuite de comprendre la situation économique des femmes et des hommes vivant en couple ainsi que celle des parents séparés. Le chapitre 3 traite sommairement de l’évolution du droit familial, s’intéressant particulièrement au cas des couples non mariés. Au chapitre 4, nous examinons l’encadrement juridique de la conjugalité de fait dans différentes juridictions qui pourraient inspirer le Québec. Au cinquième chapitre, nous formulons des recommandations à l’endroit du législateur afin que les conjoints de fait puissent bénéficier d’une protection juridique en cas de rupture.
Chapitre 1
Évolution des relations matrimoniales au Québec
La transition du Québec d’une société traditionnelle à la modernité s’est échelonnée sur plusieurs décennies : ce passage est le résultat d’une lente transformation des valeurs qui s’est manifestée à partir des années 1960. Jusqu’au début de cette décennie, le mariage se présentait comme l’institution fondatrice du couple et de la famille, celle à laquelle il était pratiquement impossible de se soustraire (Collectif Clio, 1992 : 527 et suiv.). Le droit familial était alors régi par le Code civil du Bas-Canada (en vigueur de 1866 à 1980), et le mariage était l’unique forme d’union conjugale qui soit acceptée socialement. Dans ce cadre, la puissance maritale et paternelle et la fidélité de l’épouse étaient les piliers du bon fonctionnement de la famille. Les unions de fait, les naissances hors mariage et les ruptures de mariage étaient jugées comme immorales et donc réprimées. La stabilité matrimoniale était aussi la seule solution envisagée, parfois au détriment de l’équilibre psychique des conjoints.
À partir des années 1970, le déclin du mariage a fait place à d’autres formes d’unions conjugales. Malgré les transformations radicales de la conjugalité, les pratiques au sein du couple sont demeurées calquées sur une vision plutôt traditionnelle des rapports sociaux de sexe. Les femmes continuent d’assumer une plus grande part des responsabilités domestiques et familiales, ce qui nuit à leur activité professionnelle.
Le déclin du mariage
Les mariages d’autrefois n’étaient pas d’une harmonie ni d’une solidité à toute épreuve. Dans son essai sur l’avènement de la modernité au Québec, Colette Moreux a saisi, à partir des propos de résidentes et de résidents de petites communautés rurales ou urbaines du Québec, recueillis au début des années 1970, les sentiments qu’inspirait à la population la profonde révolution qui commençait à modifier les rapports entre les femmes et les hommes au sein des couples et dans la société québécoise :
Renouveau religieux, libération de la femme, épanouissement de l’enfant, les promesses du modernisme [apparaissaient] à tous les niveaux difficiles à concrétiser. Leur séduction a d’abord servi à barbouiller le gris du passé, à donner l’envie « d’une autre chose» un peu vague, mais certainement localisée du côté du bonheur. Cependant quand l’enthousiasme de la rupture d’avec la triste tradition doit enfin se matérialiser en décisions concrètes, les modèles se dérobent. Ces carences prescriptives ne sont certes pas propres à notre communauté, elles touchent tous les groupes confrontés aux idéologies tertiaires; quelles que soient leur nature, leur origine, ne se définissent-elles pas toutes par leur silence normatif, l’autonomie créatrice qu’elles demandent au sujet? Mais lorsque, (…), de tels mots d’ordre tombent sur des sociétés encore enserrées dans les rigueurs normatives de leur tradition, ils risquent fort de laisser l’individu démuni lorsqu’il aura rejeté d’un revers de la main insouciant tout l’univers prescriptif d’un passé devenu sans objet (Moreux, 1982 : 276).
Si l’influence de l’Église catholique, combinée à la
force des contraintes juridiques et économiques, a longtemps suffi à maintenir les couples et les familles « unis aux yeux de la société, mais
désunis à l’intérieur de la maisonnée»
, la population a brusquement rejeté le carcan de l’influence religieuse sur la vie maritale et nombre de
couples ont choisi de mettre fin à leur relation matrimoniale. À la fin des années 1960, l’adoption de la Loi sur le
divorce (1968) devait permettre à ces couples d’officialiser leur séparation. Jusqu’alors, seule une loi privée permettait d’obtenir
un divorce5. L’introduction du mariage civil (1969) a rendu possibles de nouveaux mariages pour les conjoints
divorcés.
Dans son ouvrage Le mariage en question. Essai sociohistorique, Renée B. Dandurand (1988 : 101) affirme que les femmes, davantage que leurs partenaires de vie, ont commencé à remettre en question le mariage traditionnel qui, encourageant la division sexuelle du travail au sein des couples et dans la société, était contraire à leurs aspirations à l’égalité. La conjoncture de l’époque leur offrait d’ailleurs la possibilité de s’émanciper de la domination économique de leur mari en exerçant un emploi rémunéré; le contexte social incitait également les couples à définir de nouveaux modèles capables de concrétiser l’idéal moderne d’autonomie et de réalisation de soi. L’auteure fait ressortir que les femmes du début des années 1970, conscientes que la vie matrimoniale comportait de nombreux freins à leur épanouissement, étaient ainsi mieux placées pour comprendre les nouveaux modes de vie choisis par leurs enfants et plus enclines que les hommes à accepter l’évolution des relations conjugales.
Cette montée de l’individualisme, liée au passage du Québec à la modernité, a été analysée par l’avocate et sociologue de la famille Dominique Barsalou. Celle-ci s’est penchée, dans son ouvrage Ma mère de travaille pas. Le traitement juridique de la mère au foyer en droit québécois de la famille, sur ce phénomène et sur l’influence des institutions d’État, de la famille et du couple sur l’individualisation d’un sujet particulier du droit : la mère au foyer.
Dominique Barsalou rappelle que c’est durant la deuxième moitié du 19e siècle que l’individu commence à être valorisé et sa liberté reconnue face au pouvoir du roi et de l’État. La première étape du passage à la modernité a conduit, avec le développement de l’État de droit, à un individualisme abstrait, où les individus sont perçus comme semblables, libres et égaux. Commençant dans les années 1960, la seconde modernité a poussé plus loin l’individualisation en mettant l’accent sur les différences entre les individus, sur leur authenticité et sur leur droit d’être reconnus pour ce qu’ils sont vraiment. Les institutions doivent prendre acte de l’originalité de chacune et de chacun, et même la soutenir. Les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, créées dans cette mouvance, consacrent la primauté des droits individuels. Pour Barsalou, l’interprétation donnée par la Cour suprême à la Charte canadienne des droits et libertés constitue une illustration de cette reconnaissance des différences individuelles. L’auteure décrit les chartes comme les nouveaux « piliers éthiques ».
Alors que, durant la première modernité, la vie des individus continuait d’être marquée, profondément et de manière prévisible, par leur genre, leur situation conjugale ou leur revenu, cette conscience du poids des modèles sociaux tend à disparaître dans la seconde modernité. L’individu deviendra alors responsable de créer non seulement sa vie, mais aussi son univers normatif: il devra assumer individuellement les conséquences de ses choix.
Pour le Conseil, ce phénomène d’individualisation rend
les personnes aveugles aux déterminants sociaux à l’origine de leurs choix. Pourtant, ceux-ci limitent les possibilités qui s’offrent à elles.
Les rôles des différents acteurs continuent d’être marqués, au sein de la famille, par les rapports sociaux de sexe. Par conséquent, la
liberté de créer sa vie et de choisir son univers normatif, accessibles en principe à tout individu, ne se présentent pas de la même manière
aux femmes qu’aux hommes. « [L]eur vie n’est plus définie exclusivement par la famille, mais leurs responsabilités familiales sont encore
beaucoup plus importantes que celles assumées par les pères »
(Barsalou, 2013 : 50). Ce constat sera illustré statistiquement au chapitre
suivant.
Ainsi, considérant le cas des femmes qui, préparées par leur socialisation au travail de mère, font des choix déterminés par les rapports sociaux inégalitaires, il est impossible de soutenir qu’elles sont les seules responsables de leurs choix. S’appuyant sur un tel présupposé, le droit québécois conduit actuellement à un renforcement des inégalités sociales constatées entre les sexes (Ibid. p. 202). Mais à l’heure où le législateur examine les diverses options d’une réforme du droit familial, il est essentiel de prendre conscience de la dimension collective de la division sexuelle du travail et de ses effets sur la vie matérielle des individus et des couples.
La recherche de nouveaux modèles conjugaux
Il a résulté des nombreux bouleversements sociaux survenus depuis la Révolution tranquille (dont l’augmentation du nombre de femmes en emploi et aux études supérieures), une transformation profonde des valeurs portées par le projet conjugal, celles-ci faisant désormais une plus large place à l’aspiration individuelle au bonheur et à l’accomplissement personnel. On a assisté, parallèlement, à l’apparition de nouvelles formes de conjugalité qui se sont substituées au mariage. C’est ainsi que la société québécoise a développé une acceptation envers le divorce, les relations sexuelles prénuptiales, les naissances hors mariage et les unions de même sexe. On a aussi assisté à l’essor rapide des dissolutions maritales et à l’expansion du nombre d’unions de fait.
Après avoir atteint, en 1972, le sommet inégalé de 53 967 mariages célébrés annuellement au Québec, le nombre de mariages déclinera sans cesse jusqu’à nos jours pour atteindre en 2012 le nombre de 23 491.
Dans ce contexte de mutation des valeurs, les modifications apportées au droit de la famille ont accentué l’évolution du portrait d’ensemble des familles québécoises. L’introduction, en 1969, du mariage civil a permis à certains couples d’officialiser leur union sans pour autant se soumettre aux diktats de l’Église. Les mariages religieux continuaient d’être reconnus en droit civil, mais il existait désormais une célébration purement civile du mariage. En 2012, presque la moitié (48,6 %) des mariages de conjoints de sexe opposé sont des mariages civils (ISQ, 2013b).
Les divorces ont fait une apparition timide en 1970 dans les statistiques démographiques, à la suite de l’adoption de la Loi sur le divorce, en 1968. Ils se sont rapidement multipliés, à partir de 1985, par suite des modifications apportées à cette loi. En remplaçant comme motifs les fautes maritales6 par le seul fait d’être séparé, la Loi sur le divorce a en quelque sorte libéralisé le recours à cette procédure. Alors qu’en 1970, on estimait que 14 % des mariages conclus au Québec se soldaient par un divorce, depuis 1990, c’est environ 50 % des mariages qui se terminent de cette façon.
Au chapitre suivant, nous examinerons de façon plus approfondie l’évolution statistique de la structure des familles québécoises selon le statut matrimonial.
Une division du travail qui tarde à changer
L’évolution du droit et la reconnaissance du principe d’égalité entre les femmes et les hommes a produit des transformations dans la conjugalité, mais la division sexuelle du travail continue de façonner différemment les aspirations des femmes et des hommes. C’est ainsi que les pratiques au sein du couple sont demeurées calquées sur une vision plutôt traditionnelle des rapports sociaux de sexe, les femmes étant préparées, par leur socialisation, à assumer la majeure partie du travail familial non rémunéré.
Les transformations décrites plus haut
ont eu pour principal effet de rendre accessible à tout couple qui désire cohabiter le choix de vivre comme mari et femme, et ce, le plus
simplement du monde. L’extrait suivant d’un blog sur le droit et les finances est symptomatique de la perception, répandue aujourd’hui chez les
jeunes couples, de l’équivalence entre mariage et concubinage : « Une vie maritale c’est identique à concubinage ou union
libre. Le concubinage ou vie maritale reste une situation de fait sans statut spécifique »
(Droit-finances.net, page consultée le 28 octobre 2013).
On constate que la révolution des valeurs ne s’est pas conclue par l’avènement d’une organisation résolument égalitaire des rapports sociaux de sexe. Des études qualitatives, de même que l’examen des statistiques, confirment la persistance, chez les membres de la génération montante, du partage inégal du travail parental et domestique entre les hommes et les femmes, et ce, quel que soit le statut matrimonial du couple (ISQ, 2010; Surprenant, 2009).
Même si, au cours des dernières décennies, les femmes ont accru leur présence dans la sphère publique et leur participation au marché du travail de façon continue, y compris lorsqu’elles sont mères de jeunes enfants, elles demeurent les principales responsables du travail non rémunéré dans la sphère privée. Mariées ou en union de fait, elles subissent plus fortement que leur conjoint le poids des exigences contradictoires du travail rémunéré et du travail domestique et familial.
En s’appuyant sur des entrevues avec 16 jeunes vivant en couple et âgés de 20 à 30 ans, Marie-Ève Surprenant a étudié comment les femmes et les hommes d’aujourd’hui s’y prennent pour concilier la famille et le travail. Elle a observé que, même au sein de cette génération qui a grandi dans la foulée des changements sociaux engendrés par le mouvement féministe, les habitudes de vie égalitaires tardent encore à se concrétiser :
Pour plusieurs d’entre eux, la mère est et sera toujours le parent principal, les hommes se satisfaisant d’un rôle de soutien, en dépit de la volonté d’engagement et de l’investissement accru des jeunes pères. [Face aux] différentes contraintes de la conciliation famille-travail, ce sont en majorité les jeunes femmes qui ont tendance à se retirer du marché du travail, pour une période plus ou moins longue, au bénéfice de la vie familiale (Surprenant, 2009 : 103).
En y regardant de plus près, l’auteure décèle tout de
même une évolution des mentalités et des pratiques, puisque, après avoir divisé l’échantillon en trois catégories, selon la perception que les
répondantes et les répondants avaient de l’égalité et de son actualisation dans le quotidien, elle a observé que, pour les plus égalitaires
(celles et ceux qui voient le couple comme la rencontre de deux individus distincts et autonomes), l’instauration de pratiques égalitaires
repose sur la communication : « Contrairement aux jeunes des catégories précédentes, le partage des tâches fait l’objet de nombreuses
discussions et négociations au sein de leur couple, tant au début de la cohabitation que par la suite »
(Ibid. p.
55).
Le partage du travail non rémunéré tend donc à devenir une préoccupation chez les jeunes couples, mais les pratiques résolument égalitaires tardent à se matérialiser.
Le coût assumé par les femmes
La maternité continue d’avoir des conséquences majeures sur l’insertion professionnelle des femmes. Elle incite plusieurs d’entre elles à opter pour le travail à temps partiel ou pour la semaine comprimée, à refuser des promotions ou à interrompre temporairement leur participation au marché du travail pour s’occuper des enfants (Tremblay, 2012). Dans le cas des hommes, au contraire, ce sont plutôt les obligations professionnelles qui empiètent sur la vie familiale.
Le taux d’emploi des parents
Les résultats du recensement de 2006 nous apprennent que le taux d’activité et le taux d’emploi des hommes âgés de 25 à 44 ans augmentent avec le nombre d’enfants, contrairement à ceux des femmes qui diminuent. En outre, l’Enquête sur la population active a permis de montrer qu’en 2008 comme en 1976, les hommes qui ont des enfants de 12 ans ou moins consacrent au travail rémunéré un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à celui des hommes de ce groupe d’âge n’ayant pas d’enfants (écarts de +1,8 et de +1,7 heures en 1976 et 2008), contrairement aux femmes qui réduisent leurs heures de travail lorsqu’elles ont des enfants (écarts de –4,0 et de –1,2 heures en 1976 et 2008). Ces données, présentées dans le graphique et le tableau suivants, permettent de croire que l’arrivée des enfants intensifie la présence des femmes dans la sphère domestique et pousse les hommes au travail salarié.
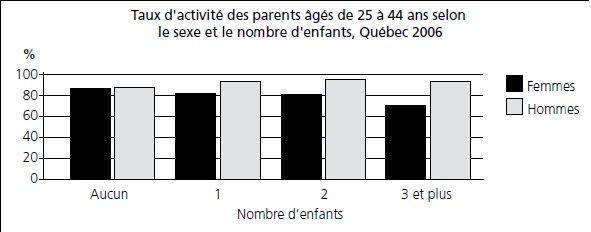
Source : ISQ, Le marché du travail et les parents, 2009.
| Année | Présence d’enfants | Femmes | Hommes |
|---|---|---|---|
| 1976 | Sans enfants de 12 ans et moins | 36,6 | 41,4 |
| Avec enfants de 12 ans et moins | 32,6 | 43,2 | |
| 2008 | Sans enfants de 12 ans et moins | 35,7 | 39,5 |
| Avec enfants de 12 ans et moins | 34,5 | 41,2 |
Source : ISQ, Le marché du travail et les parents, 2009.
Le phénomène a des racines sociétales, affirme l’avocate en droit familial, Jocelyne Jarry :
La société a réussi cet exploit extraordinaire d’imputer aux mères des responsabilités sans partage, en plus de tous les autres rôles sociaux qu’il faut aujourd’hui exercer pour en être partie intégrante et être un individu estimé : travailleur compétent et infatigable, citoyen informé et engagé, écologiste, érudit, bénévole à ses heures, guide et tuteur de nos enfants, environnementaliste, nutritionniste, sportif soucieux de sa santé, etc. (Jarry, 2008 : 170).
Ainsi, dans un couple, le fait d’avoir des enfants à charge comporte des conséquences économiques nettement plus lourdes pour les femmes que pour les hommes, particulièrement en ce qui a trait à la progression en emploi et du revenu, une situation qui se répercute sur les revenus touchés tout au long de la carrière et jusqu’au moment de la retraite. Si l’on compare les gains moyens d’emploi des femmes et des hommes, en tenant compte du fait que les femmes travaillent davantage à temps partiel7, souvent pour se charger des responsabilités familiales, les femmes gagnent 71,5 % du revenu des hommes (Statistique Canada, tableau 202-0102).
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a montré que l’écart entre les heures rémunérées des femmes et des hommes provient surtout du nombre d’heures d’absence pour obligations personnelles ou familiales, qui est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (71,2 h/an contre 18,5 h/an) et du nombre d’heures supplémentaires rémunérées, plus élevé chez les hommes que chez les femmes (47,5 h/an contre 19,8 h/an) (ISQ, 2012a : 254).
Dans les familles recomposées, qui constituent 16 % des familles du Québec (voir tableau 2), il est permis de croire que, lorsque les femmes réduisent leur participation à un emploi rémunéré pour s’occuper de leurs enfants, elles le font aussi pour ceux de leur conjoint, s’il en a eu d’une union précédente.
L’utilisation des congés parentaux
Depuis 2006, le Régime québécois d’assurance parentale permet aux parents de prendre congé de leur emploi rémunéré à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, tout en recevant une compensation financière, pourvu qu’ils aient cotisé au régime et qu’ils aient touché un revenu assurable d’au moins 2 000 $. Le régime de base offre à la mère un congé de maternité d’une durée maximale de 18 semaines et au père un congé de paternité non transférable d’une durée maximale de 5 semaines. Il permet de plus aux parents de partager entre eux un congé parental de 32 semaines additionnelles. Durant la période de congé, le parent prestataire recevra des versements équivalant à 70 % de ses gains d’emploi moyens ou à 55 % de ces gains, le taux dépendant du régime choisi (régime de base ou régime particulier).
Dans le cadre d’une vaste étude portant sur la participation des parents au marché du travail, l’ISQ a notamment examiné l’évolution, entre 2001 et 2006, de la prise de ces différents congés par les nouveaux parents, en comparant la situation au Québec à celle de l’ensemble du Canada.
L’étude nous apprend qu’au Québec comme au Canada, la prise d’un congé par les pères a augmenté durant la période et qu’elle a fait un bond, au Québec, entre 2005 et 2006. L’introduction du Régime québécois d’assurance parentale en 2006, avec un congé de paternité de 5 semaines exclusif aux pères – non transférable à la mère – a causé cette hausse. En 2005, quelque 45 % des pères avaient pris congé à la suite de l’arrivée d’un enfant : en 2006, c’est 75 % d’entre eux qui en ont pris un. La prise d’un congé par les mères semble plus stable sur cette période, fluctuant entre 80 % et 90 %, au Québec comme au Canada.
L’étude révèle en outre qu’une grande proportion de pères retournent travailler avant que l’enfant ait atteint l’âge d’un mois. Les pères québécois sont toutefois moins nombreux que les pères canadiens à reprendre le travail aussi rapidement. En 2006, 63,9 % des pères canadiens âgés de 15 à 49 ans étaient retournés au travail alors que leur plus jeune enfant avait moins d’un mois, comme 43,1 % des pères québécois du même groupe d’âge. Comme les auteurs de l’étude, nous croyons que cette différence peut être liée au congé de paternité exclusif de 5 semaines dont bénéficient les pères québécois (ISQ, Le marché du travail et les parents, p. 51).
Nous constatons que la plupart des mères prennent un congé de maternité et un congé parental totalisant au moins 6 mois. Au Québec, 41,1 % des mères reviennent au travail quand leur plus jeune enfant a entre 6 et 11 mois et 44,9 % le font lorsque l’enfant atteint un âge se situant entre 12 et 48 mois (idem).
Cette prise d’un congé plus long par les mères a pour conséquences de réduire leurs gains d’emploi et d’accroître leur dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint. Du côté des pères, l’allongement de leur congé pour avoir soin d’un enfant nouveau-né aurait pour principaux effets de créer un rapprochement entre le père et l’enfant et de favoriser sa prise en charge des responsabilités familiales, pour les années subséquentes. Ceci rendrait possible un partage plus équilibré entre les conjoints du travail familial gratuit et du travail rémunéré.
Une charge familiale variable
À la suite de l’arrivée d’un enfant, la plupart des parents retournent donc au travail dans un délai inférieur à 4 ans. Mais une proportion non négligeable (17 %) de mères ne sont pas retournées sur le marché du travail quatre ans après la naissance de leur dernier enfant. Parmi celles-ci, on trouve notamment les mères d’enfants qui souffrent d’un trouble de développement ou d’un handicap sévère. Ces enfants, requérant quotidiennement des soins lourds et complexes, ne peuvent de ce fait s’intégrer à un groupe ordinaire dans le réseau des centres de la petite enfance ou dans le réseau scolaire. L’un des parents doit alors se rendre disponible pour leur apporter les soins requis par leur état. Cela signifie, pour le parent visé, un retrait prolongé du marché du travail ou l’adoption d’un horaire de travail réduit, dans son emploi rémunéré.
Lorsque le couple désignera celui des deux parents qui apportera les soins à l’enfant handicapé ou ayant des besoins particuliers, la décision personnelle sera influencée par les normes de genre qui amènent les femmes à se définir d’emblée comme plus disponibles pour le travail auprès des enfants ou des beaux-enfants. Cette tendance sera renforcée par le critère de maximisation des revenus familiaux qui, le plus souvent, jouera dans le même sens. Si un écart significatif existe entre les revenus des deux conjoints, ce critère amènera celui qui touche les revenus les plus faibles à rester à la maison. Dans l’état actuel du marché du travail, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi rémunéré au salaire minimum et, lorsqu’elles travaillent à temps plein, elles touchent en moyenne un revenu inférieur à celui des hommes. Il arrive plus souvent que ce soit elles, plutôt que leur conjoint, qui soient désignées pour avoir soin des enfants.
D’autres tâches associées à la vie familiale peuvent, de la même façon que la présence d’un enfant ayant des besoins particuliers, entraîner le retrait partiel ou total d’un des deux conjoints du marché du travail. Citons à ce titre les cas de familles nombreuses, ceux des femmes qui jouent le rôle de proches aidantes pour leurs parents ou leurs beaux-parents en perte d’autonomie. Dans chacun de ces cas, l’application du critère du revenu pour désigner le conjoint qui quittera son emploi ciblera le plus souvent la conjointe.
En quittant de la sorte le marché du travail pendant plusieurs années, les femmes risquent de devenir dépendantes de leur conjoint pour assurer leur subsistance. Cette situation les placera dans un état de vulnérabilité économique qui s’exacerbera advenant la rupture du couple. La mère au foyer n’ayant pas exercé d’emploi rémunéré pendant un certain nombre d’années aura en effet renoncé aux gains pécuniaires que lui aurait procurés cet emploi et aux droits de retraite correspondants. Ces mères se déqualifient en étant absentes du marché du travail, leur réintégration peut donc être ardue, ce qui réduit leur autonomie économique. Pour le Conseil, puisque la désignation du conjoint qui restera au foyer pour remplir les tâches domestiques et familiales est un choix de couple influencé par des normes de genre inégalitaires, il serait dans l’ordre des choses que le couple assume, après la rupture, les conséquences financières de ce choix, plutôt que laisser le conjoint vulnérable aux prises avec ces conséquences.
Les lois sociales et les lois fiscales qui s’appliquent aux familles
La Loi sur les impôts du Québec (LRQ, c.I-3) et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ((1985), ch. 1 (5e suppl.)) prévoient des avantages sous forme de crédits d’impôt ou de déductions fiscales, destinés à soutenir les familles et les parents, qu’ils soient mariés ou en union de fait.
En outre, plusieurs programmes gouvernementaux visent à soutenir les familles ou à fournir une assurance aux personnes en emploi contre les risques de perte d’emploi ou d’accident. Songeons à la politique familiale, à la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23), au Régime québécois d’assurance parentale, à la prestation fiscale canadienne pour enfants, au Soutien aux enfants, au Régime de rentes du Québec, à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9), à la Loi sur l’assurance maladie (LRQ, c. A-29), à La loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LRQ, c A-13.1.1) et à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LRQ, c A-3.001). Chacune de ces lois contient une définition de conjoint de fait et d’époux. Nous constatons que ces définitions ne sont pas uniformisées, chaque loi se caractérisant par des critères qui lui sont propres pour qualifier les conjoints de fait.
La politique familiale comprend les services de garde à contribution réduite, des mesures universelles de soutien aux enfants et d’autres mesures de soutien financier pour les familles à faible revenu. Le Régime québécois d’assurance parentale offre aux parents la possibilité de prendre des congés parentaux, de maternité et de paternité adaptés à leurs besoins, qu’ils soient salariés ou travailleurs autonomes. La prestation fiscale canadienne pour enfants est un paiement mensuel non imposable versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Elle inclut, le cas échéant, la prestation pour enfants handicapés. Au Québec, le Soutien aux enfants est un crédit d’impôt remboursable versé à toutes les familles admissibles ayant un enfant à charge de moins de 18 ans qui réside avec elles; il est complété par le supplément pour enfant handicapé. Celui-ci a pour objectif d’aider financièrement les familles à assumer la garde, les soins et l’éducation d’un enfant handicapé et la somme versée est la même pour tous les enfants admissibles, peu importe le handicap ou le revenu familial.
Similarités des formes d’union et de perceptions
Les couples en union de fait forment des entités familiales fonctionnellement comparables à celles des couples mariés. On constate qu’ils sont aussi féconds, sinon plus, que les couples mariés, ce dont témoignent les statistiques présentées au deuxième chapitre. Ils cohabitent, partagent le coût des dépenses familiales et acquerront éventuellement une résidence en commun. Ils feront des projets ensemble, se soutiendront mutuellement et il se développera une solidarité et une interdépendance entre les membres du couple. Ils auront des enfants dans des proportions équivalentes : en 2011, c’était le cas de 51,9 % des familles comptant un couple en union de fait et de 47,9 % des familles comptant un couple marié.
Plusieurs personnes croient à tort que les couples vivant en union de fait depuis quelques années sont soumis aux mêmes obligations juridiques que les couples mariés, lorsque survient la rupture de la relation. La sociologue Hélène Belleau attribue cette confusion au fait que les couples, mariés ou non, sont assimilés dans les lois sociales et fiscales alors qu’ils ne le sont pas en droit familial :
[D]e nombreux couples non mariés se pensent, à tort, aussi protégés que les couples mariés, tout en évitant l’institutionnalisation légale de leur union. On observe en effet que, bien qu’une coupure radicale persiste sur le plan légal entre union libre et mariage, les différents traitements législatifs et administratifs de l’union libre semblent conduire à une méconnaissance ou même à l’ignorance parmi la population québécoise des droits et devoirs qui lient les conjoints en union libre, et de ce qui distingue ceux-ci des couples mariés» (Belleau et Cornut-St-Pierre, 2011 : 85).
Dans une enquête qualitative portant sur les représentations de la
conjugalité que se font les jeunes couples, Hélène Belleau et son équipe ont observé que ces couples sont réticents à aborder les questions juridiques ou
financières parce que ces questions leur semblent incompatibles avec l’idéal amoureux. « La plupart des couples n’aiment pas parler de rupture et encore
moins d’argent entre eux ou de contrat : ces questions risquent le plus souvent de mettre en opposition les intérêts de chacun des partenaires voire de
semer un doute dans la relation de confiance qui prévaut entre les conjoints »
(Belleau et al., 2008 : 60).
Les auteurs concluent de leurs entretiens :
Il ressort clairement de cette enquête que la majorité des gens mariés et des conjoints de fait disent ne pas avoir pris en considération les dimensions légales dans la décision de se marier ou non (…).
Par ailleurs, on constate que les personnes les plus au fait des droits et obligations des conjoints sont ceux (sic) ayant connu une rupture antérieurement, celles ayant une formation juridique et certaines personnes mariées religieusement (Ibid. p. 69).
Et la retentissante cause Éric c. Lola ne semble pas avoir convaincu les Québécoises et les Québécois de mieux se protéger en cas de rupture. On aurait pu penser que cette affaire avait eu un effet éducatif, compte tenu de sa grande couverture médiatique. Il semblerait que non. Un sondage de la Chambre des notaires mené deux mois après l’arrêt du plus haut tribunal confirme que les personnes vivant en union de fait sont mal informées quant aux protections légales associées à cette forme d’union. La moitié des personnes interrogées croient ainsi qu’en cas de rupture entre deux conjoints de fait, tous les biens acquis pendant leur vie commune sont séparés en parts égales. En outre, la proportion de répondants qui ont dit croire que le conjoint le plus pauvre aurait droit à une pension alimentaire de la part de son ex-conjoint est presque aussi élevée que celle des personnes croyant qu’il n’y aurait pas droit (41 % contre 42 %). Les autres (17 %) ne savent pas ce qu’il en est. Enfin, moins d’un couple non marié sur cinq a prévu les conséquences de la rupture en signant une convention ou un contrat de vie commune : 11 % ont rédigé ce document devant notaire et 8 % l’ont rédigé entre eux et sans notaire (Chambre des notaires du Québec et CROP, 2013). Bref, une part importante de la population se croit, à tort, bien informée sur le statut des conjoints de fait. En réalité, la majorité de la population ignore qu’à défaut de testament, de contrat de vie commune et lorsque les biens ne sont pas détenus en copropriété, le Code civil ne garantit aucun droit aux conjoints de fait, au moment de la rupture.
En somme, les couples et les familles québécoises se sont transformés au cours des dernières décennies, avec l’avènement du divorce et la croissance de l’activité rémunérée des femmes. Les inégalités dans le partage du travail non rémunéré dans l’espace domestique continuent néanmoins d’avoir d’importantes conséquences sur la sécurité économique des femmes. Nous examinerons, au chapitre suivant, comment ces changements se sont matérialisés, faisant évoluer le portrait statistique de la famille, depuis les années 1980.
Chapitre 2
Portrait statistique des familles
Les transformations de la vision du couple au Québec, au cours des dernières décennies, se sont manifestées par une montée en popularité du choix de l’union de fait comme forme d’union conjugale des couples hétérosexuels.
La diversité des familles du Québec
Selon le Dictionnaire du recensement 2011, une famille est un groupe de personnes qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, l’alliance, l’union de fait ou l’adoption. Elle est formée des membres d’un couple marié ou vivant en union de fait et de leurs enfants s’il y a lieu, ou d’un parent seul vivant avec au moins un enfant. Le couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Une famille comptant un couple avec enfants peut encore être classifiée soit comme une famille intacte, si tous les enfants sont ceux des deux conjoints, soit comme une famille recomposée, si au moins un enfant est celui d’un seul des conjoints, sa naissance ou son adoption étant survenue avant la relation actuelle (Statistique Canada, 2012).
Le recensement de 2011 a permis de dénombrer 2 203 625 familles au Québec. Les couples sans enfants à charge forment 42,2 % des familles tandis que les couples avec enfants de tous âges vivant à la maison constituent 41,2 % de celles-ci. Les familles monoparentales, au nombre de 365 510, représentent une proportion de 28,7 % des familles avec enfants. Plus des trois quarts d’entre elles sont dirigés par un parent de sexe féminin.
Le tableau suivant présente la répartition des familles où vit au moins un enfant de 24 ans ou moins, selon qu’elles sont intactes, recomposées ou monoparentales. Nous avons été contraintes de nous limiter à ce sous-ensemble des familles, puisque les données sur les familles recomposées, publiées pour la première fois à la suite du recensement de 2011, excluent les familles où tous les enfants vivant à la maison sont âgés de 25 ans ou plus. Les familles recomposées sont dites simples si tous les enfants sont ceux d’un seul des conjoints; elles sont complexes si elles comptent au moins un enfant de chaque conjoint.
| Nbre | % | ||
|---|---|---|---|
| Familles intactes | 692 310 | 62,2 | |
| Familles recomposées | simples | 79 375 | 7,1 |
| complexes | 53 180 | 4,8 | |
| Familles monoparentales | Parent sexe féminin | 215 800 | 19,4 |
| Parent sexe masculin | 71 610 | 6,4 | |
| Total | 1 112 350 | 100,0 | |
Source : Données du recensement 2011, compilées par l’ISQ.
Par ailleurs, ces familles, comme l’ensemble des familles vivant au Québec, peuvent être natives, immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents; elles peuvent avoir une identité autochtone, pluriautochtone ou mixte. Leur répartition entre familles intactes, recomposées ou monoparentales sera particulière à chacun des groupes correspondant à différentes identités culturelles. On trouve moins de familles monoparentales chez la population immigrante ou chez les résidents non permanents que dans la population native du Québec. Dans son Portrait statistique des familles au Québec 2011, le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) confirme cette caractéristique des familles non natives, en montrant que 23,2 % des familles immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents qui comptaient des enfants de tous âges à la maison étaient monoparentales en 2006, ce qui était le cas de 29 % des familles natives (MFA, 2011 : 173).
Soulignons une autre particularité des familles immigrantes, influençant la taille des familles. L’ISQ constate « qu’au Québec, la fécondité des femmes nées à l’extérieur du Canada surpasse celle des natives » (ISQ, 2012b : 116). L’indice de fécondité des immigrantes s’élève à 1,9 enfant par femme en 2001-2006 tandis que celui des natives est estimé à 1,5 enfant par femme (idem).
Derrière le pourcentage moyen des couples qui vivent en union de fait, au Québec – 37,8 % de tous les couples ou 39,7 % des couples avec enfants – se cache une réalité qui ne peut être passée sous silence. Dans six régions du Québec, plus de la moitié des couples avec enfants vivent en union de fait. La région de Montréal qui est, de loin, celle qui compte la plus faible proportion de couples en union de fait, influence beaucoup la moyenne québécoise. Dans cette région qui regroupe près du quart (24,6 %) de la population du Québec en 2012, seulement 20 % des couples vivent en union de fait, ce qui tranche beaucoup avec la moyenne du Québec.
Comparé à la moyenne nationale de 39,7 %, ce faible pourcentage de couples en union de fait s’expliquerait principalement par la forte concentration de population immigrante que l’on trouve dans la région de Montréal. L’ISQ estime que, parmi les immigrants admis entre 2006 et 2010 et encore présents au Québec en janvier 2012, 63,5 % vivaient dans la région de Montréal (ISQ, 2013c : 44). En 2011, environ le tiers (33,2 %) de la population de l’agglomération de Montréal était née à l’extérieur du Canada (Communauté métropolitaine de Montréal, 2013). Cette proportion a connu une forte augmentation depuis 2001 : la population immigrante représentait alors 27,6 % de la population totale de l’agglomération de Montréal. Ce phénomène tranche avec la situation des autres régions : au Québec, hors du Grand Montréal, le poids de la population immigrante est passé de 2,3 % en 2001 à 3,2 % en 2011.
Or, la population immigrante affiche au Québec des taux
de nuptialité beaucoup plus élevés que la population native. Bien que nous ne disposions pas des données les plus récentes sur les taux de
nuptialité, une étude du démographe Louis Duchesne permet de les mesurer indirectement, à travers la proportion des naissances hors mariage,
observée chez les femmes immigrées au Québec. « Dans la cinquantaine de pays de naissance des mères retenus ici (ceux qui ont au moins 100
naissances enregistrées), le taux de naissance hors mariage varie de 2 % à 66 %. Ce sont les femmes nées dans les pays moyen-orientaux,
proche-orientaux et méditerranéens qui affichent les taux [de naissances hors mariage] les plus faibles, sans oublier la Chine». L’auteur
explique :« l’arrivée au Québec peut être lointaine, si elles ont
immigré étant enfants, mais […] les immigrantes, surtout les récentes, peuvent avoir encore les mêmes comportements matrimoniaux que dans
leur pays d’origine »
(Duchesne, 2004 : 13).
C’est donc la présence à Montréal d’une importante communauté issue de l’immigration qui donne à la région métropolitaine une proportion aussi élevée (80 %) de couples mariés. Si l’on exclut la région de Montréal, dans le reste du Québec, 46,1 % des couples avec enfants vivent en union de fait et 53,9 % sont mariés.
Du côté des familles autochtones, le ministère de la Famille et des Aînés a constaté que le pourcentage de familles monoparentales était légèrement plus élevé dans leur cas que dans celui des familles non autochtones. Il a également souligné que le type de famille dominant variait selon le groupe d’appartenance.
Par exemple, « chez les Inuits, les familles biparentales
constituent une majorité, alors que les parents seuls sont fortement majoritaires chez les Métis et ceux qui déclarent avoir une identité
autochtone multiple »
(MFA, 2011 : 183).
Les familles homoparentales, c’est-à-dire composées de
deux parents de même sexe, font maintenant partie de l’univers des familles de recensement (depuis 2001). Peu de données publiées nous
permettent de connaître le nombre de ces familles, qu’elles aient des enfants ou non. Par contre, le portrait des familles cité plus haut nous
apprend qu’en 2006, au Québec, « [e]nviron 410 enfants vivent dans une famille homoparentale (830 en 2001) »
. La plupart (1 140 ou 80,9 %) vivent avec un couple féminin. Les enfants
mineurs des familles avec deux parents de même sexe sont plus nombreux à vivre avec des parents féminins : c’est le cas de 90,5 % des enfants
âgés de 0 à 17 ans. De l’autre côté, 50,8 % des enfants majeurs habitant chez un couple homoparental ont des parents masculins (ibid., p.
272).
La popularité de l’union de fait
Si l’on se tourne maintenant vers le statut matrimonial des personnes vivant en couple, on s’aperçoit que la popularité de l’union de fait n’a cessé d’augmenter, au Québec, entre 1981 et 2011, comme le révèlent les données du recensement. En 1981, le Québec comptait en effet 120 885 couples en union de fait (avec ou sans enfants), ceux-ci formant 8,3 % de tous les couples, alors qu’en 2011, c’est 694 750 couples, soit près de quatre sur dix (37,8 %) qui vivaient en union de fait. Nous ne disposons pas de données antérieures à celles de 1981 puisque, jusqu’au recensement de 1976, les couples en union de fait étaient assimilés, dans les statistiques, à des couples mariés.
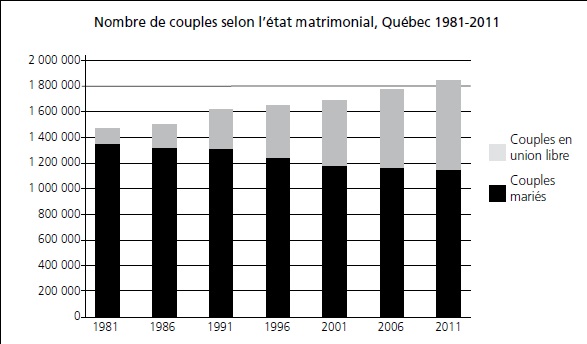
Source : Statistique Canada, Rencensement de la population
Le Québec se distingue en cela du Canada où, malgré une hausse sensible au cours des dernières années, 16,7 % des couples vivaient en union de fait en 2011, donc deux fois moins qu’au Québec. Il se distingue également en venant au premier rang des États occidentaux où la proportion de couples vivant dans ce type d’union est la plus élevée, même si les couples mariés y demeurent encore majoritaires. Le Québec surpasse à ce titre la Suède où 29 % des couples sont des conjoints de fait.
L’écart entre le Québec et le reste du Canada est encore
plus marqué chez les jeunes de moins de 35 ans. Dans le jugement Éric c. Lola, le juge LeBel l’a souligné, disant que : « Les jeunes Qué-
bécois optent pour l’union de fait dans des proportions nettement supérieures (51 %) à celles de l’ensemble des jeunes Canadiens (29 %) »
(Éric
c. Lola, paragr.126, opinion du juge LeBel).
Selon l’ISQ, 66 % des femmes âgées de 15 à 34 ans qui vivaient en couple en 2011 étaient conjointes de fait. (ISQ, « Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2011 »).
Les naissances hors mariage
Dans le Québec d’aujourd’hui (2012), près des deux tiers des enfants (63,3 %) sont nés de couples non mariés, alors qu’en 1981, 15,6 % des naissances avaient lieu hors mariage.
Cette proportion a d’ailleurs augmenté plus rapidement que celle des couples vivant en union de fait, comme l’illustre le graphique suivant.
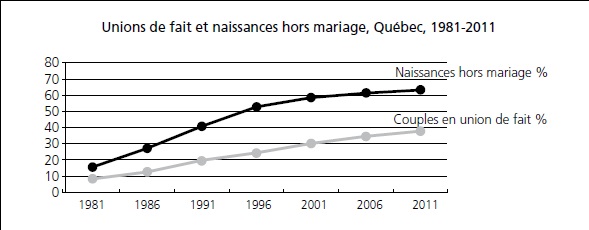
Comparé aux pays de l’OCDE, le Québec est le territoire où l’on compte proportionnellement le plus de naissances hors mariage. En 2007, c’était le cas de 61,9 % des naissances, alors qu’aux États-Unis, la proportion était de 39,7 %, en France, de 51,7 %, et en Suède, de 54,8 % (MFA, 2013).
Dans une étude statistique portant sur le contexte de vie des enfants de moins de 5 ans, le ministère de la Famille et des Aînés constate que les jeunes enfants sont de plus en plus nombreux à vivre avec des parents non mariés. En 2006, c’était le cas de 45 % des enfants de moins de 5 ans, soit une proportion supérieure à celle des enfants du même groupe d’âge vivant avec leurs parents mariés (42 %). Les autres jeunes enfants, 13 %, vivaient dans une famille monoparentale.
La même étude fait ressortir que 8 % des familles connaîtront, durant la première année de vie des enfants, un épisode de vie en famille monoparentale (MFA, 2013).
Les familles monoparentales
Au Québec, le nombre de familles monoparentales est en hausse continue. En 1986, les 252 805 familles monoparentales que l’on recensait au Québec représentaient 20,8 % de l’ensemble des familles avec enfants, alors qu’en 2011, ce nombre – 365 510 – correspond à 28,7 % de toutes les familles avec enfants.
La majorité des familles monoparentales (76 %) sont aujourd’hui sous la responsabilité d’une femme, et ce, bien que l’on ait enregistré une hausse de la proportion de celles qui sont dirigées par un homme. Cette proportion est passée de 17,5 % en 1986 à 24 % en 2011 (ISQ, « Familles selon la structure, la présence d’enfants et l’âge des enfants, Québec, 1986-2011 »).
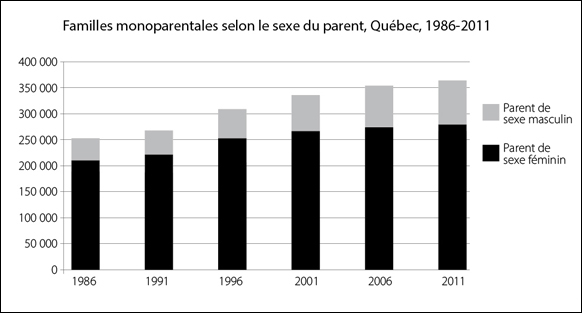
Divers événements sont susceptibles d’expliquer la formation d’une famille monoparentale : naissance hors union, décès d’un parent, divorce ou séparation. De plus, la monoparentalité est en général un état transitoire dans l’histoire des familles. Mais la rupture de l’union de fait des parents ressort comme le principal événement à l’origine de la monoparentalité.
L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec menée par l’ISQ a examiné le parcours familial des enfants de moins de 8 ans entre 1998 et 2006, en particulier le premier épisode de monoparentalité vécu par certains. On y observe que pour près de la moitié (48,8 %) d’entre eux, ce premier épisode était consécutif à la rupture de l’union de fait des parents comparativement à 26,2 % de ces épisodes qui étaient causés par la dissolution du mariage des parents. Par ailleurs, la naissance hors union était à l’origine de 24,3 % des premiers épisodes de monoparentalité vécus par les enfants de la même cohorte. Mentionnons que les enfants nés en 1997-1998 étaient issus en plus grande proportion d’unions de fait (48 %) que d’unions maritales (44 %).
Pour compléter ce portrait, ajoutons qu’un pourcentage infime des enfants qui ont vécu, avant l’âge de 8 ans, dans une famille monoparentale, l’ont fait à la suite du décès d’un de leurs parents (Ducharme et Desrosiers, 2008).
La gestion du revenu au sein des couples
Une étude de Statistique Canada basée sur les données de l’Enquête sociale générale de 2007 met en évidence les caractéristiques des couples qui influencent leur stratégie de gestion du revenu. Les revenus des deux conjoints seront-ils mis en commun, gérés séparément ou un des deux conjoints recevra-t-il une allocation de la part de l’autre? Cette étude, qui porte sur des personnes âgées d’au moins 45 ans et vivant au Canada, confirme que les couples en union de fait sont beaucoup plus susceptibles de séparer leurs revenus que les couples mariés. Parmi ceux qui sont en union de fait, 75 % des couples ont des comptes séparés, 11 % ont un compte commun et 12 % combinent les deux types de comptes. Parmi les couples mariés, 40 % ont des comptes séparés, 40 % ont un compte commun et 20 % combinent les deux. L’étude montre en outre que le choix d’une stratégie de gestion du revenu est fortement lié à des caractéristiques socio-économiques qui diffèrent systématiquement entre les couples mariés et les couples en union de fait (Laporte et Schellenberg, 2011).
On observe un lien étroit entre la probabilité de mettre les revenus en commun et la durée de la relation. Les couples dont la relation dure depuis moins de 5 ans sont les plus susceptibles de séparer leurs revenus, ceux qui sont unis depuis plus de 20 ans sont les plus susceptibles de les mettre en commun et ceux dont la relation dure depuis plus de 10 ans et moins de 20 ans ont une probabilité intermédiaire de partager leurs revenus (ibid., p. 19).
Les personnes nées au Canada ont une plus forte propension à séparer leurs revenus que les personnes immigrées. On sait par ailleurs que le modèle de la famille où le mari est l’unique soutien existe au sein de nombreux groupes de la population immigrée, alors qu’il décline généralement dans la population native.
Dans l’ensemble, les couples québécois ont moins tendance à avoir une gestion commune de leurs revenus que ceux qui résident dans les autres provinces ou territoires. De même, le fait de parler français est associé à une plus grande probabilité de séparer les revenus au sein du couple. Il n’existe pas d’études qui expliquent cette particularité.
Les couples qui n’ont pas d’enfants sont moins sujets à mettre leurs revenus en commun que les parents d’enfants. Ceux dont les enfants sont encore à la maison sont plus susceptibles de mettre les revenus en commun que ceux dont les enfants ne résident plus au domicile familial. La nécessité de subvenir aux besoins des enfants constitue donc un motif répandu de partage des dépenses par les parents.
Les personnes ayant déjà été mariées ont une probabilité deux fois plus grande d’opter pour la séparation des revenus que les personnes jamais mariées auparavant.
Enfin, la probabilité de séparer les revenus augmente avec le revenu de la femme, mais ne dépend pas du revenu de l’homme ni du rapport entre le revenu des conjoints. Laporte et Schellenberg (2011) y voient une plus grande importance accordée à l’indépendance ou à l’autonomie par les femmes touchant de hauts revenus que par les autres. Le désir de garder le contrôle sur son revenu personnel ou une conception différente de la propriété des biens personnels sont d’autres facteurs entrant en ligne de compte.
Les stratégies de gestion du revenu durant la relation se répercuteront sur les modalités de partage des revenus et des actifs entre les membres du couple, à la fin de la relation.
Le partage des responsabilités parentales
Les Québécoises sont aujourd’hui très nombreuses à exercer un emploi sur le marché du travail et, dans tous les groupes d’âge, leur taux d’activité est voisin de celui des hommes. En effet, si l’on s’arrête à la population âgée de 25 à 54 ans, soit la tranche d’âge où se conjuguent la plus grande part des responsabilités familiales et l’activité professionnelle, 84,3 % des femmes occupent un emploi rémunéré en 2012, contre 90,5 % des hommes.
En contrepartie de cette intensification de l’activité professionnelle des femmes, on n’a pas encore assisté à une diminution importante de la part des tâches et des responsabilités familiales qui pèsent sur leurs épaules. Nous verrons dans la présente section que les femmes assument, encore aujourd’hui, une plus large part des soins des enfants et du travail domestique que les hommes.
Les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour s’acquitter des obligations familiales qui leur incombent toujours vont du choix d’un emploi rémunéré moins exigeant à la diminution des heures de travail rémunéré ou, pour un certain nombre d’entre elles, au retrait temporaire du marché du travail.
Les données chiffrées tirées du dernier cycle de l’Enquête sociale générale procurent un éclairage sur le partage inégal du travail parental et domestique. À partir de cette enquête, l’Institut de la statistique du Québec estime que le temps moyen consacré quotidiennement par les femmes aux tâches domestiques ou aux soins aux enfants est supérieur à celui qu’y passent les hommes. Dans la population âgée de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, les femmes consacrent respectivement 29 % et 44 % plus de temps que les hommes à ces activités. Le tableau suivant présente ces moyennes, calculées pour la population qui participe aux activités visées. Soulignons l’amélioration globale qui s’est produite par rapport aux données observées en 1998. Cette année-là, il était estimé que, dans les couples avec au moins un enfant de moins de 5 ans, les femmes consacraient 72 % plus de temps que les hommes aux activités domestiques (ISQ, 2010 : 256).
| 25-34 ans | 35-44 ans | ||
|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
| 6,2 | 4,8 | 5,2 | 3,6 |
Source : Enquête sociale générale 2010, adaptée par l’ISQ
Dans les couples ayant des enfants de 4 ans et moins et où les deux parents travaillent à temps plein, le temps moyen consacré quotidiennement par les hommes aux tâches domestiques et aux soins des enfants s’est accru de 27 %, passant de 3,3 heures en 2005 à 4,2 heures en 2010, pendant que chez les femmes, ce temps augmentait de 13 %, passant de 4,8 en 2005 à 5,4 heures en 2010 (ISQ, « Moyenne quotidienne de temps consacré aux activités principales de l’emploi du temps par la population en emploi à temps plein et vivant avec au moins un enfant âgé de 4 ans ou moins dans le ménage, selon le sexe, Québec, 1992, 1998, 2005 et 2010 »).
Enfin, le choix du régime de travail semble influencé davantage par les obligations familiales dans le cas des femmes que dans celui des hommes. Quand vient le temps de choisir de travailler à temps plein ou à temps partiel, la prise en charge des obligations familiales est déterminante, surtout pour les femmes. Selon l’Enquête sur la population active, en effet, plus d’un demi-million de Québécoises (502 700) et 271 300 Québécois travaillent à temps partiel, en 2013. Parmi ces personnes, 53 800 femmes, ou 10,7 %, déclarent avoir choisi ce régime de travail pour prendre soin des enfants ou en raison d’autres obligations personnelles ou familiales, ce qui est le cas de seulement 5 900 hommes, ou 2,2 % (Statistique Canada, tableau 28-0014)*. Dans l’ensemble, il est deux fois plus probable pour une femme que pour un homme de travailler à temps partiel : en 2011, 26 % des femmes en emploi étaient à temps partiel contre 13 % des hommes (ISQ, 2013a).
Les résultats cités précédemment témoignent bien de la persistance de la division sexuelle du travail au sein des couples et, en contrepartie, d’une diminution des revenus d’emploi des femmes et de leur autonomie financière.
Sur le partage de la garde des enfants et des responsabilités financières, les résultats de l’Étude longitudinale du développement des enfants au Québec (ELDEQ) ont permis au ministère de la Famille et des Aînés d’estimer l’importance des différentes modalités de garde et de mesurer la participation financière de chacun des parents séparés.
En 2004, sur 100 enfants âgés d’environ 6 ans et dont les parents étaient séparés, 76 vivaient avec leur mère, 21 vivaient en garde partagée et 3 habitaient avec leur père. Parmi les enfants qui vivaient avec leur mère, plus de la moitié (40/76) voyaient leur père chaque semaine ou chaque quinzaine, et un sur quatre (19/76) n’avait aucun contact avec lui (MFA, 2013).
La situation économique des familles après la rupture
Il est difficile d’appréhender statistiquement les
rapports économiques qu’entretiennent les conjoints séparés, compte tenu de la définition même de la famille et des conjoints. Selon ce qu’ont
souligné Lapierre-Adamcyk et Le Bourdais dans leur communication intitulée Couples et familles : une réalité sociologique et
démographique en constante évolution, cette définition voulant que les membres d’une famille vivent sous le même toit, il devient
difficile d’évaluer l’implication des mères ou des pères auprès de leurs enfants après une rupture d’union : « il est virtuellement impossible
de saisir l’importance du soutien économique ou autre provenant des membres d’une famille qui vivent dans un autre ménage »
(Lapierre-Adamcyk
et Le Bourdais, 2004 : 64). On ne sait pas, faute d’études, quel pourcentage des familles monoparentales ont été formées à la suite d’un
divorce, d’un décès, de la rupture d’une union de fait ou par le choix du parent seul. On sait néanmoins que les familles monoparentales
québécoises sont exposées à un risque d’appauvrissement plus grand que les familles dirigées par deux parents, ce que les statistiques
démontrent. Lors de la rupture d’une union, le conjoint qui a la garde des enfants et qui ne touche aucun revenu ou a un revenu inférieur à
celui de l’autre conjoint sera, règle générale, dans une situation économique plus précaire s’il vivait en union de fait que s’il était marié,
à moins qu’il n’y ait une entente privée entre les parties. Par contre, lors de la rupture du mariage, le conjoint le plus pauvre aura droit au
partage du patrimoine familial, à une prestation compensatoire et à une pension
alimentaire, selon les circonstances, alors qu’à la rupture d’une union de fait, il n’aurait droit à aucun montant pour lui-même. Des études
longitudinales seraient cependant nécessaires pour mesurer l’importance et la durée des conséquences économiques entre les familles à la suite
de la rupture conjugale selon l’état matrimonial des parents.
Enfin, il faut souligner que, quel que soit leur statut matrimonial, un petit nombre d’ex-conjointes reçoivent une pension alimentaire pour subvenir à leurs propres besoins. D’abord, les cas d’ex-conjointes de fait qui bénéficieraient d’une telle pension sont rarissimes, comme nous le confirme la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, et ensuite, avec la progression qu’ont connue les femmes sur le marché du travail, on observe aujourd’hui que, dans une grande proportion des couples, les conjoints ont des revenus équivalents, ce qui exclut la nécessité d’une pension alimentaire.
Pour estimer le nombre d’ex-conjointes8, mariées ou en union de fait, touchant une pension alimentaire pour elles-mêmes, les seules données dont nous disposions proviennent des statistiques fiscales des particuliers. Celles-ci nous apprennent qu’en 2011, 14 254 femmes avaient reçu une pension alimentaire de leur ex-conjoint, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Or, nous savons que, depuis le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfants, versées au parent gardien par suite d’une entente écrite ou d’un jugement rendu après le 30 avril 1997 sont défiscalisées, c’est-à-dire qu’aux fins de l’impôt, elles n’ont pas à être incluses dans le revenu du parent gardien. De ce fait, le nombre de contribuables déclarant une pension alimentaire pour enfants diminue, d’année en année, à mesure que prennent fin les pensions attribuées avant la défiscalisation. En 1996, dernière année complète où les pensions alimentaires pour enfants faisaient partie des revenus imposables du parent gardien, 83 021 femmes avaient déclaré avoir reçu une pension, pour elles ou pour leurs enfants. Quoique ce nombre ait diminué de façon importante entre 1996 et 2011, nous supposons qu’encore aujourd’hui, un petit nombre de femmes contribuables continuent de déclarer une pension alimentaire qu’elles reçoivent pour leurs enfants. Le nombre de 14 254 bénéficiaires de pension alimentaire ne comprend donc pas uniquement des femmes qui reçoivent une pension pour elles-mêmes : cette statistique doit donc être prise comme un maximum pour ce nombre (Ministère des Finances et de l’Économie, 2014).
Le graphique suivant présente l’évolution du nombre total de femmes bénéficiaires d’une pension alimentaire pour elles-mêmes ou pour les enfants dont elles ont la garde, depuis la défiscalisation des pensions pour enfants. La forme asymptotique de la courbe suggère que ce nombre tendra à se stabiliser entre 10 000 et 15 000.
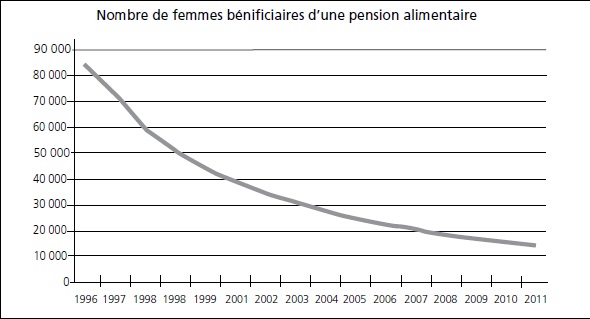
Les revenus et les actifs des familles
Le recensement permet de comparer le revenu médian des couples en union de fait et celui des couples mariés à celui des familles monoparentales, selon le sexe du parent qui en est responsable.
Au Québec, le revenu médian des couples en union de fait est supérieur à celui des couples mariés, ce qui s’expliquerait par le fait que les familles à deux revenus sont plus fréquentes parmi les couples en union de fait que chez les couples mariés. Les familles monoparentales ont un revenu médian inférieur à celui des familles à deux parents, particulièrement celles dont le chef est une femme.
Les données de 2005 sont présentées au tableau 4.
| Revenu médian | Revenu médian après impôt | |
| Couples en union de fait | 65 132 $ | 55 734 $ |
| Couples mariés | 63 327 $ | 54 307 $ |
| Familles monoparentales homme | 47 362 $ | 41 758 $ |
| Familles monoparentales femme | 34 689 $ | 33 254 $ |
Source : Recensement de 2006.
Le portrait des familles avec de jeunes enfants que brosse le ministère de la Famille et des Aînés fait ressortir un fort lien entre la structure des familles et le revenu d’emploi de celles-ci. Une forte proportion (71 %) de mères seules responsables de jeunes enfants disposent d’un revenu avant impôt inférieur à 30 000 $ par an, sort que partagent 40 % des pères seuls et 11 % des familles biparentales. À l’autre extrémité de la distribution des revenus, 4 % des mères seules avec de jeunes enfants bénéficient d’un revenu supérieur à 60 000 $ par année, comme 16 % des familles monoparentales dirigées par le père et 55 % des familles biparentales.
L’Enquête canadienne sur les capacités financières permet d’établir que les familles monoparentales ayant une femme à leur tête ont des actifs moyens plus faibles que celles qui ont un homme à leur tête : 187 000 $ comparé à 282 000 $ en 2008. Ces familles dirigées par une femme ont en outre des actifs médians beaucoup plus faibles que leurs actifs moyens (60 000 $ comparé à 187 000 $), ce qui indique que la majorité d’entre elles possèdent des actifs largement inférieurs à la moyenne.
Les familles monoparentales ayant un homme à leur tête détiennent, elles aussi, des actifs médians inférieurs à leurs actifs moyens, mais l’écart est moins important (200000 $ comparé à 280 000 $), ce qui nous permet de conclure que ces familles sont moins concentrées dans les très bas niveaux d’actifs que les familles monoparentales dirigées par une femme.
Les conditions de vie des familles monoparentales
Les familles monoparentales connaissent une situation économique nettement moins avantageuse que celle des autres familles. C’est particulièrement le cas des familles monoparentales sous la responsabilité d’un parent de sexe féminin, lesquelles sont exposées à un risque élevé de vivre sous le seuil de faible revenu.
Le quart (25,9 %) des familles monoparentales dirigées par une femme vivait sous le seuil du faible revenu (mesure du panier de consommation ou MPC9), en 2010. Par comparaison, le taux de faible revenu des familles comptant deux parents avec enfants est de 3,9 %.
Comme le montre le tableau suivant, le taux de faible revenu des familles a diminué durant la dernière décennie, et ce, particulièrement pour les familles monoparentales. Par rapport aux 25,9 % de mères seules avec enfants vivant sous le seuil de faible revenu, MPC, en 2010, c’était, en 2000, 40,1 % des familles monoparentales dirigées par une femme qui disposaient d’un revenu inférieur à ce seuil. Ce type de familles demeure néanmoins celui qui est exposé au plus grand risque de compter sur un revenu inférieur au seuil de faible revenu.
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||
| Toutes les unités familiales | 15,0 | 13,3 | 12,0 | 12,6 | 12,8 | 13,6 |
| Type de famille | ||||||
| Couples sans enfants | 6,0 | 6,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Couples avec enfants | 6,9 | 5,5 | 3,7 | 4,1 | 5,7 | 3,9 |
| Familles monoparentales | 36,7 | 30,8 | 22,7 | 19,6 | 21,6 | 24,9 |
| soutiens femmes | 40,1 | 35,6 | 27,0 | 23,4 | 24,5 | 25,9 |
| soutiens hommes | 22,0 | 13,6 | Donnée trop peu fiable pour être publiée | Donnée trop peu fiable pour être publiée | Donnée trop peu fiable pour être publiée | Donnée trop peu fiable pour être publiée |
| Autres types de famille | 6,3 | 6,6 | 4,7 | 6,8 | 5,2 | 6,6 |
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) et Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), fichiers maîtres, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
En décembre 2010, on comptait au Québec 38 108 familles monoparentales inscrites au Programme d’aide sociale et 34 026 d’entre elles (ou 89,3 %) étaient dirigées par une femme. Les chefs de familles monoparentales représentaient 16,7 % de la clientèle adulte du programme, alors que les femmes chefs de familles monoparentales formaient 30,6 % de toutes les femmes prestataires du programme (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2010).
Mais les femmes qui vivent en couple ne sont pas toujours le conjoint le moins favorisé. Une étude basée sur l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu a permis d’estimer que, dans les couples à deux soutiens, la proportion de femmes touchant un revenu supérieur à celui de leur conjoint s’était accrue au Canada de façon importante. Cette proportion est passée de 11 % en 1967 à 29 % en 2003 (Sussman et Bonnel, 2006, p. 10). Une autre étude, exploitant les résultats du recensement de 2006, a permis à la Société d’habitation du Québec d’estimer qu’en 2006, 25,7 % des familles biparentales du Québec avaient une femme pour principal soutien (Senécal, 2012, tableau 1.C). Mentionnons cependant que le fait qu’elles soient le principal soutien du ménage ne signifie pas que les femmes soient riches pour autant. Des statistiques sur la répartition des revenus au sein des ménages seraient nécessaires pour le vérifier, mais les grands organismes statistiques n’adoptent pas cette perspective dans leurs enquêtes.
Les données chiffrées présentées dans ce chapitre dévoilent que, dans le Québec contemporain, les couples tendent de plus en plus à vivre en union de fait plutôt qu’à se marier, et que la majorité des naissances surviennent hors mariage. Elles confirment également la multiplication des familles monoparentales et le fait que plus des trois quarts de ces familles sont dirigées par une femme. Par ailleurs, nous avons montré dans ce chapitre que les familles monoparentales, avec des revenus médians plus faibles que les familles dirigées par deux parents, sont exposées à un plus grand risque de vivre sous le seuil de faible revenu, particulièrement lorsqu’elles sont dirigées par une femme. Enfin, nous avons mis en évidence le fait que les conjointes assument, au sein du couple, la plus grande part des responsabilités familiales et du travail domestique, et qu’elles le font au prix d’une réduction de leur temps de travail rémunéré et de leurs gains d’emploi. La conjonction de tous ces facteurs se traduit par une tendance des femmes à s’appauvrir durant l’union conjugale.
Le prochain chapitre examine le droit familial en vigueur au Québec et l’encadrement des conséquences de l’union conjugale, selon le statut matrimonial des conjoints. Les conjoints mariés bénéficient d’une protection juridique leur donnant droit, au moment de la rupture, au partage du patrimoine familial ainsi qu’à une pension alimentaire de la part de leur ex-conjoint, s’il y a eu appauvrissement relatif durant la relation. Ce n’est pas le cas des conjoints de fait, dans le contexte législatif actuel. Pourtant, les conjointes de fait jouent un rôle comparable à celui des épouses, au sein de la famille et de la communauté. C’est pourquoi nous recommanderons, au chapitre cinq, qu’elles bénéficient d’une protection équivalente à celle que garantit le Code civil aux conjointes mariées.
Chapitre3
Transformation du droit familial
Pour bien comprendre l’état actuel du droit en matière d’encadrement des conjoints de fait, il est intéressant de considérer le chemin qui a mené la société québécoise à la situation actuelle. Plusieurs essais récents en droit familial nous renseignent à ce sujet (Roy, 2013a, 2013b; Lafond et Lefebvre, 2003).
Dans son analyse de l’évolution récente du droit familial québécois,
le professeur Alain Roy explique précisément de quelle manière le législateur québécois a permis que l’union de fait passe de la réprobation sociale la
plus complète à « une manière socialement et juridiquement acceptable de vivre une relation conjugale »
(2013b : 304). Il examine aussi comment la
législation québécoise s’est progressivement ouverte à la reconnaissance de modèles alternatifs au modèle traditionnel représenté par le couple
hétérosexuel marié, en accordant certains droits et avantages aux conjoints de fait, en créant l’union civile accessible aux conjoints de même sexe et de
sexe différent, et en ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
Avec d’amples références aux débats tenus à l’Assemblée nationale et dans les commissions parlementaires qui se sont penchées sur les projets de loi encadrant le droit familial, Alain Roy décrit les étapes par lesquelles l’union de fait a accédé à la reconnaissance sociale et juridique. Il est particulièrement intéressant de voir comment, à travers les avancées en faveur de la reconnaissance de l’union de fait, chaque fois qu’a été soulevée la question de l’opportunité de prévoir des conséquences juridiques de la rupture de ces unions, les élus ont refusé de franchir ce pas. Autre constante : ce refus s’appuyait invariablement sur le respect de la liberté et de l’autonomie des conjoints.
Des statuts juridiques distincts
Selon le Code civil du Québec, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille (art. 394 C.c.Q.); ils contribuent en proportion de leurs facultés respectives, y compris par leurs activités au foyer, aux charges du ménage (art. 396 C.c.Q.); l’époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage pour le tout son conjoint non séparé de corps (art. 397 C.c.Q.); les époux choisissent de concert la résidence familiale (art. 395 C.c.Q.). Dans le mariage, chacun des époux conserve son nom (art. 393 C.c.Q.). Pour contrer les injustices qui pourraient découler, surtout à l’égard des femmes, de la rupture conjugale, le législateur québécois a adopté le mécanisme de la prestation compensatoire (art. 427 C.c.Q.), par lequel le conjoint qui a enrichi le patrimoine de son ex-conjoint par son travail à la maison peut obtenir une compensation10. Devant la réticence des tribunaux à appliquer cette mesure, qui s’apparente à l’action pour enrichissement injustifié, le législateur a imposé en 1989 le partage du patrimoine familial lors du divorce11, peu importe le régime matrimonial choisi par les époux. Le mariage est ainsi devenu une union économique entre les conjoints qui vise à protéger le plus vulnérable.
Mais l’union de fait n’a pas de statut dans le Code civil, si bien que les règles évoquées ci-dessus ne s’appliquent pas aux conjoints de fait. Le régime en vigueur a été bien décrit par le juge LeBel:
La loi n’impose à ces conjoints aucun devoir d’assistance et de secours, donc d’obligation alimentaire. Le partage des charges du ménage est laissé à leur discrétion; ils ne sont pas tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés respectives. Ils n’ont pas d’obligation de choisir de concert la résidence familiale. L’exercice de leurs droits de propriété sur cette dernière n’est pas limité par l’application de dispositions impératives (Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, paragr. 112).
Jusqu’en 1980, le Code civil du Bas-Canada encadrait les obligations des époux, au Québec. L’union des conjoints en dehors des liens du mariage y était perçue comme contraire à la stabilité de la famille et jugée peu souhaitable socialement. Pour éviter que de telles unions se multiplient, l’État n’accordait sa protection qu’aux époux. Dans ce contexte, le législateur niait aux concubins le droit de se consentir des donations entre vifs12, à l’exception des aliments, et il privait les enfants issus du concubinage de la protection à laquelle avaient droit les enfants issus du mariage : devoir d’entretien et d’éducation de la part des parents, possibilité d’hériter ab intestat de leurs ascendants.
La reconnaissance juridique timide de l’union de fait
L’encadrement légal des familles québécoises a connu une importante réforme, en 1980, lorsque fut adopté le Livre deuxième du Code civil du Québec, portant strictement sur le droit de la famille. Le législateur a alors introduit en droit la notion d’autorité parentale (art. 600 C.c.Q.) et celle d’égalité des conjoints (art. 392 C.c.Q.), renversant la vision de la famille contenue dans le Code civil du Bas-Canada, suivant laquelle l’autorité paternelle et maritale était nécessaire pour assurer la stabilité de la famille (Mayrand, 1985).
L’un des objets de la réforme était de garantir à tous les enfants les mêmes droits, notamment celui de bénéficier, en cas de divorce ou de séparation des parents, d’une pension alimentaire qui serait calculée en fonction du revenu des deux parents, et ce, sans égard au statut matrimonial de ceux-ci. Cette réforme a donc défini les droits et les devoirs des parents et établi leur autorité conjointe.
Depuis la réforme du droit de la famille en 1980, une acceptation progressive de l’union de fait s’est installée en droit. Les tribunaux ont reconnu la validité des ententes de cohabitation prévoyant les conditions de règlement d’une éventuelle rupture des unions de fait. Au nom du respect de la diversité des familles, les lois à caractère social ont aussi reconnu ces unions. La Cour suprême le souligne :
On peut aussi constater que l’hostilité législative traditionnelle semble s’être généralement muée en acceptation du phénomène de l’union de fait. À cet effet, rappelons que les lois sociales québécoises n’entretiennent plus de distinctions entre les divers modes de conjugalité : voir notamment Loi sur l’aide financière aux études; Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques; Loi sur l’assurance automobile. Les conjoints de fait, comme les époux et les conjoints unis civilement, sont soumis à une application uniforme de ces lois tant sur le plan des bénéfices accordés que sur celui des obligations imposées lorsqu’il s’agit de leurs rapports avec les institutions publiques (Éric c. Lola, paragr. 250, opinion du juge LeBel).
L’institution du patrimoine familial
Puis en 1989, en adoptant la Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux (L.Q. 1989, c. 55), le législateur a redéfini le contenu impératif du mariage en imposant à tous les couples mariés l’obligation de partager, en part égales, le patrimoine familial acquis au cours de l’union, au moment d’une rupture ou d’un décès. Ce patrimoine englobe les principaux biens acquis par l’un ou l’autre des conjoints durant le mariage, soit : les résidences principale et secondaire de la famille, les meubles meublants, les véhicules automobiles et les régimes de retraite privés et publics. L’objectif de cette loi était de préserver les femmes mariées de l’appauvrissement économique dans lequel un régime matrimonial inéquitable risquait de les jeter, en cas de divorce.
Au sujet de l’esprit du partage obligatoire du patrimoine
familial, le juge Baudouin, de la Cour d’appel du Québec, a formulé un commentaire qui a été cité avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt Éric c. Lola,
et que nous reprenons ici : « Le législateur, en introduisant dans notre droit le partage du patrimoine familial, a entendu remédier à des
injustices dont une certaine catégorie de femmes mariées pouvaient être victimes et reconnaître la valeur du travail au foyer »
(paragr. 75,
opinion du juge LeBel).
Ainsi, en voulant reconnaître la valeur du travail au foyer dans le cadre du mariage et garantir, le cas échéant, une compensation à celui des deux époux (habituellement la femme) qui a suspendu sa participation au marché du travail pour l’accomplir, le législateur a nié aux conjoints mariés la liberté de choisir leur régime matrimonial en ce qui concerne les biens inclus dans le patrimoine familial.
La réforme du droit familial amorcée en 1980 s’est
poursuivie en 1991, avec la révision du Code civil. Si, comme le souligne Alain Roy dans « L’évolution de la politique législative de l’union
de fait au Québec »
(Roy, 2013a : 103), des dispositions ont été prévues pour reconnaître certains avantages aux conjoints de fait, le projet
de loi que proposait le ministre de la Justice ne comprenait aucune nouvelle mesure visant à réglementer les rapports privés entre eux.
Néanmoins, la révision du Code civil de 1991 a permis des avancées quant à leur statut juridique.
En matière d’adoption, les conjoints de fait ont obtenu l’autorisation d’adopter l’enfant de leur partenaire, sur la base d’un consentement spécial, soit de la même façon que les conjoints mariés (art. 555 C.c.Q.). Relativement au logement, le concubin a pu, à l’instar de l’époux, exercer son droit au maintien dans le logement loué par son conjoint, au décès de celui-ci ou dès que cessait la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.), et le concubin copropriétaire d’un immeuble a obtenu le droit de prendre possession d’un logement dans un immeuble qu’il détenait avec son partenaire (art. 1958 C.c.Q.). De plus, les conjoints de fait se sont vu attribuer des droits en matière successorale, pouvant désormais obtenir le droit d’occuper l’immeuble qui servait de résidence à leur conjoint défunt (art. 857 C.c.Q.). Ils ont pu intervenir en tant que proches pour exercer un recours direct en responsabilité, à la suite du décès de leur conjoint (art. 1457 C.c.Q.), ou bénéficier de l’assurance vie de celui-ci (art. 2419 C.c.Q.). Enfin, ils ont pu consentir à ce que leur conjoint, devenu inapte, obtienne les soins nécessités par son état, dans le cas où ce conjoint n’aurait ni représen- tant légal ni conjoint marié (art. 115 C.c.Q.).
Les lois à caractère social ou fiscal ont fait l’objet, elles aussi, de nombreux amendements depuis 1965, ceux-ci visant à attribuer aux conjoints de fait des avantages équivalents à ceux dont bénéficiaient les époux. Ces modifications législatives étaient nécessaires, car le régime antérieur était discriminatoire. Le gouvernement n’avait d’autre choix que d’accorder aux conjoints de fait le même soutien économique et social qu’aux couples mariés.
La création de l’union civile
En juin 2002, le législateur québécois a introduit l’union civile dans le Code civil pour encadrer juridiquement les couples non mariés, autant homosexuels qu’hétérosexuels, qui désiraient s’y soumettre. Cette nouvelle forme de conjugalité impose aux couples qui la retiennent des obligations et des droits comparables à ceux que procure le mariage (art. 521.6 C.c.Q.). Il en est résulté un nouvel élargissement de la notion de conjoint; cet élargissement a d’ailleurs poussé le législateur à revoir la notion de conjoint en ajoutant un article à ce sujet à la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16, art. 61.1.). L’union civile est toutefois demeurée marginale, comme le révèlent les statistiques. De 2002 à 2010, c’est entre 165 et 280 couples par année qui ont choisi l’union civile, pendant qu’entre 22 000 et 23 000 mariages étaient célébrés annuellement. Globalement, cette forme d’union n’a été choisie que par un petit nombre d’adeptes, joignant environ 100 fois moins de couples que le mariage. Il faut aussi tenir compte de l’importance numérique des unions homosexuelles : celles-ci représentent 40 % de toutes les unions civiles conclues durant cette période. Par conséquent, le poids statistique de l’union civile est encore plus faible chez les couples hétérosexuels (Pacaut, 2013). En 2005, la Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33) a été modifiée de façon à rendre accessible le mariage aux couples de même sexe, modifiant ainsi partout au Canada la définition du mariage. Ce changement législatif a encore diminué l’intérêt pour l’union civile.
Les conséquences de la rupture en union de fait
Dans l’état actuel du droit québécois, les dispositions du Code civil régissant les rapports financiers entre les ex-conjoints, au moment de la rupture ou du décès, ne s’appliquent qu’aux époux et aux conjoints unis civilement.
Après la rupture, s’ils n’ont pas prévu une convention de cohabitation ou l’acquisition des biens en copropriété, les membres d’une union de fait ne bénéficient quant à eux d’aucune protection ni d’aucun encadrement légal pour assurer le versement d’une pension alimentaire à un conjoint ou le partage équitable des biens acquis durant la vie commune. Outre les prestations de dernier recours, les conjoints économiquement vulnérables n’ont alors que le recours coûteux aux tribunaux en plaidant l’enrichissement injustifié13.
Le Conseil du statut de la femme remet en question la supposée liberté de choix qui justifierait l’exclusion des conjoints de fait des règles du Code civil du Québec et il s’inquiète des conséquences économiques néfastes pour les conjointes de fait.
Les limites de la liberté de choix
Plusieurs juristes remettent en
cause depuis des années cette dichotomie de traitement entre le mariage d’une part – encadré par un partage obligatoire des biens – et
l’union de fait d’autre part où les conjoints ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques. Selon Benoît Moore, un tel régime
peut être qualifié de « schizophrénie québécoise », ou tout au moins, de paradoxe difficilement justifiable (Moore, 2013 : 67).
L’auteur soutient que le droit familial québécois manque de cohérence interne dans la reconnaissance de deux valeurs fondamentales :
l’autonomie individuelle d’une part et la solidarité de l’autre. « Dans l’état actuel du droit, ces valeurs cohabitent de manière
parallèle, la solidarité maritale imposée face à la liberté des conjoints de fait. Or […] ces deux valeurs devraient se retrouver dans
l’ensemble des modèles familiaux, non pas nécessairement de manière identique, mais à tout le moins de manière cohérente»
(ibid., p. 67-68). On pourrait donc voir l’union de fait, telle qu’encadrée dans le modèle juridique actuel,
comme « un vestige du dogme de l’autonomie de la volonté »
(idem). Toujours selon Moore, il est surprenant que
l’on accorde autant d’importance à la volonté individuelle des conjoints dans un domaine où il est bien difficile de prévoir l’avenir.
La justification du respect de la liberté des conjoints de fait « ne peut faire autrement que surprendre en ce
qu’elle est fondée sur un discours individualiste, pourtant écarté dans le mariage, de même que sur une conception de l’autonomie de la
volonté qui, partout ailleurs en droit des contrats, est aujourd’hui vue comme archaïque »
(ibid., p. 72).
De son côté, Louise Langevin,
qui est une des coauteures de cet avis, soutient qu’en ne protégeant pas le conjoint de fait vulnérable, l’État « privatise les
ententes conjugales pour certains couples et permet à certains conjoints de fuir leur responsabilité à l’égard de leurs ex-conjoints,
comme à l’époque des couples mariés en séparation de biens. En fait, cette décision respecte essentiellement la liberté de choix de la
partie la plus forte dans le couple, qui n’est pas souvent la femme »
(Langevin, 2009 : 20). Il est difficile également de plaider que
l’État ne veut pas intervenir dans une affaire privée comme la rupture d’union de fait alors qu’il est intervenu de plain-pied dans
un autre choix supposément « privé » : le mariage.
Le débat sur la liberté de choix dans l’union de
fait a trouvé son chemin jusqu’à la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c.
Walsh, 2002 CSC 12, on observe ce que Langevin décrit comme un des nombreux exemples de « décisions de la Cour suprême qui
sacralisent le respect de la liberté de choix en matière conjugale»
(Langevin, 2009 : 15). Dans une opinion dissidente, la juge
L’Heureux-Dubé se demandait qui pouvait exercer concrètement la liberté de choix, quand il est question de relations conjugales. Selon
elle, « les couples ne conçoivent pas leur union en termes de contrats. [D’ailleurs,] le fait que le mariage donne lieu à des obligations
juridiques n’indique pas en soi que la source de ces obligations résulte d’un échange négocié ou d’un
consensus »
(opinion de la juge L’Heureux-Dubé, Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC
12, paragr. 145 et 146). La juge Abella, dans l’arrêt Éric c. Lola, reprend la même position : elle dénonce le caractère illusoire du
choix (paragr. 375 et suiv.).
Moore est du même avis, affirmant que « l’union
de fait est moins un choix qu’un état de fait »
(Moore, 2012 : 372). Il s’agit donc, selon lui, d’une situation de facto, découlant
d’un rejet de l’institution du mariage, et non pas d’un « désir réel de conjugalité contractualisée »
(idem).
En effet, comme nous le précisions plus tôt, une faible proportion de couples en union de fait (19 %) signent des contrats de partage
des biens (Chambre des notaires du Québec et CROP, 2013).
Dans l’arrêt Éric c. Lola, la juge Abella
souligne que le caractère impératif du régime québécois qui encadre le mariage et l’union civile « fait bien ressortir la priorité qu’a
accordée le Québec aux préoccupations relatives à la protection des conjoints vulnérables par rapport à d’autres valeurs comme la
liberté de choix en matière contractuelle »
(opinion de la juge Abella, Québec (Procureur général) c. A,
paragr. 309). Cette protection obligatoire du conjoint vulnérable a pour effet collatéral de rendre le mariage moins attrayant pour
ceux qui souhaitent se soustraire à une telle responsabilité envers leur ex-conjoint. Ainsi, « […] l’union de fait est aujourd’hui
devenue un outil de “contournement” de la loi impérative, en ce qu’elle permet, dans des situations qui peuvent souvent comporter des
similarités fonctionnelles importantes avec le mariage, d’écarter les effets impératifs de celui-ci »
(Moore, 2010 : 97). Le refus du
mariage ne peut être considéré automatiquement comme une décision prise à deux.
Dans un récent essai, la sociologue Hélène Belleau a démontré que la décision de se marier ou non faisait rarement consensus au sein des couples : la moitié des couples rencontrés dans le cadre de son étude ont fait état d’un désir de se marier plus fort chez un conjoint que chez l’autre.
Chez les conjoints de fait en particulier, le quart des répondants ont admis que l’un des conjoints souhaitait se marier, mais que l’autre s’y opposait, pour diverses raisons. […] Lorsque les différences d’opinion sur ces questions apparaissent insurmontables, cette divergence aboutit parfois […] à l’abandon de l’idée de se marier, idée qui s’avère trop conflictuelle pour continuer à être discutée (Belleau, 2012 : 97-98).
La vulnérabilité économique en cas de rupture
Au-delà de l’argument du libre choix, on ne peut ignorer le sort du conjoint de fait le plus vulnérable sur le plan économique au moment de la rupture, et ses conséquences pour la famille. Selon Goubau, Otis et Robitaille,
[I]l n’est pas possible d’occulter, au nom de l’autonomie des couples et du respect de la volonté des individus, le problème social réel et préoccupant de la précarité financière des familles monoparentales dans un contexte d’augmentation importante des ruptures familiales. […] Il est vrai que, en fait de précarité matérielle au moment de la rupture, la situation du couple non marié n’est pas nécessairement différente de celle du couple marié. Il y aurait donc autant de raisons de protéger les uns que les autres. Et lorsque les enfants sont issus de l’union, cette similitude est encore plus évidente (Goubau, Otis et Robitaille, 2003 : 7).
Cette préoccupation particulière pour les enfants au moment de la rupture fait dire à certains juristes ainsi qu’à la FAFMRQ (2009) qu’il faudrait prévoir des régimes de protection différents, en cas de séparation, pour les conjoints avec enfants ou sans enfants, qu’ils soient en union de fait, mariés ou en union civile. Selon ces auteurs, la présence d’enfants au sein du couple peut entraîner la vulnérabilité économique du conjoint, très souvent la femme, qui s’investit dans la famille (Roy, 2013b : 302-306; Goubau, Otis et Robitaille, 2003 : 43-51)). Les mécanismes de protection s’appliqueraient alors avec la naissance d’un enfant, que le couple soit marié ou non.
Selon un autre argument avancé par ces
intervenants, les enfants ne font pas le choix du régime qui unit leurs parents et n’ont donc pas à subir les conséquences de la
différence de protection entre les couples mariés et non mariés. « En ne reconnaissant pas l’égalité de traitement entre les enfants
nés hors mariage et ceux nés de parents mariés, le Code civil crée deux catégories d’enfants basées sur le statut civil de leurs
parents »
(FAFMRQ, 2009). Pourtant, depuis la réforme de 1980, le Code civil ne distingue plus entre les enfants selon le statut
matrimonial de leurs parents. « Ils ont les mêmes droits et les mêmes
obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance »
(art. 522 C.c.Q.). On peut s’interroger sur les effets
discriminatoires envers les enfants de cette décision de la Cour suprême du Canada. Discrimination ou pas, le meilleur intérêt de
l’enfant n’est pas assuré (art. 33 C.c.Q. et Charte des droits et libertés de la personne, art. 39). Précisons
qu’aucun des juges du plus haut tribunal n’a abordé cette question dans l’arrêt Éric c. Lola, bien que la FAFMRQ, intervenante dans
cette affaire, ait présenté cet argument.
Si l’on suit ce raisonnement, il faut aussi tenir compte du rôle de proches aidantes auprès de personnes âgées qu’assument majoritairement les femmes. Pourquoi une femme en union de fait, ayant pris soin de ses beaux-parents pendant 10 ans alors que son conjoint poursuivait sa carrière, ne pourrait-elle bénéficier d’une reconnaissance égale à celle associée au soin des enfants à la suite d’une rupture? Les heures non rémunérées passées auprès de parents ou d’enfants méritent, selon nous, la même reconnaissance.
Louise Langevin offre un éclairage féministe sur cette absence de protection des conjoints de fait au moment de la rupture.
D’abord, bien que la rupture conjugale rende précaire la situation économique des femmes avec des enfants, elle peut aussi placer des femmes sans enfants dans la gêne financière. Pourquoi le législateur devrait-il respecter davantage la liberté de choix de ces femmes sans enfants? Il est difficile de croire qu’elles ont vraiment « choisi » leur statut conjugal, à la différence des femmes avec enfants, qui selon cette proposition n’auraient quant à elles pas pu vraiment choisir. Les femmes, avec ou sans enfants, font souvent des choix dictés par la solidarité familiale et conjugale pouvant avoir des effets sur leurs capacités financières. Les lois des autres provinces canadiennes ne limitent pas le versement de la pension alimentaire aux cas de rupture de conjoints de fait avec enfants. De même, chez les couples mariés, le versement d’une pension alimentaire en cas de rupture n’est pas lié seulement à la présence d’enfants (Langevin, 2009 : 31).
Les enjeux entourant la sécurité économique des femmes au moment de la dissolution de leur union ne concernent donc pas uniquement celles qui ont des enfants, car le travail non rému- néré des femmes dans l’espace privé peut être réalisé au bénéfice d’autres personnes incluant le conjoint.
Le double discours du législateur québécois
Comment expliquer que le législateur québécois reconnaisse la diversité des unions conjugales dans les lois à caractère social et fiscal, et non dans le Code civil du Québec, qui est le droit commun, c’est-à-dire le droit de base applicable à tous? Ce double discours législatif est certainement à l’origine de la confusion entre le statut juridique des couples mariés et des conjoints de fait dans la population, selon Louise Langevin.
La dichotomie entre la sphère privée et la sphère publique me semble ici à l’œuvre. En effet, comme le législateur ne doit pas discriminer dans ses politiques publiques et ses lois à l’égard des différentes formes de familles et de couples, au nom du respect de la diversité et du droit à l’égalité, il reconnaît les couples mariés et non mariés dans de nombreuses politiques publiques. Dans l’arrêt Walsh, la Cour suprême distingue toutefois la relation du couple par rapport à un tiers, l’État, des rapports entre les conjoints ou parties au mariage même. Et lorsque l’État refuse d’intervenir dans la liberté de choix des couples non mariés, c’est encore une fois au nom du respect de la diversité (Langevin, 2009 : 18).
Cet argument soulève toutefois plusieurs problèmes, notamment celui de renforcer la distinction entre la sphère privée et la sphère publique; distinction qui a longtemps servi de justification au maintien des inégalités entre les femmes et les hommes dans la famille. Louise Langevin souligne que :
L’État refuse d’intervenir (ce qui n’est pas une décision neutre en soi) dans la décision des couples non mariés au nom du respect de la sphère privée, mais pourtant, il intervient dans tous les aspects de la vie des justiciables (et des payeurs de taxes). Avec l’adoption des chartes, le droit de la famille n’est-il pas de plus en plus l’objet de débats sur la place publique et soumis au jugement des tribunaux? Voilà un paradoxe de la présente affaire, l’État ne veut pas intervenir dans les choix privés des couples non mariés (et des femmes), mais il le fait pour les couples mariés et il intervient dans la vie d’ex-conjointes de fait qui auront besoin d’aide sociale en raison de leur vulnérabilité économique causée en grande partie par leur situation conjugale antérieure (idem).
Les positions défendues relativement aux droits des conjoints de fait
Dans l’arrêt Éric c. Lola, la Cour suprême a conclu, par un vote très divisé, que le régime juridique différencié en matière d’union de fait était valide d’un point de vue constitutionnel. Le législateur québécois n’a pas été contraint à modifier les paramètres du droit familial, mais la teneur de ce jugement l’a incité à mener une réflexion en profondeur sur l’opportunité d’encadrer les effets de l’union de fait. Comme dans le cas du mariage, il s’agirait de protéger les conjoints de fait contre la vulnérabilité économique qui risque de survenir advenant la rupture de l’union.
Les neuf juges du plus haut tribunal ont reconnu que les dispositions du Code civil du Québec qui prévoient les conséquences de la rupture du mariage créent une distinction sur la base de l’état matrimonial, quant aux droits des personnes vivant en couple, et que cette distinction entraîne un désavantage pour les conjoints de fait. En revanche, ils n’ont pas été unanimes pour conclure que le désavantage était discriminatoire au sens de l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Quatre d’entre eux ont en effet jugé que l’exclusion des conjoints de fait du champ d’application des dispositions sur les conséquences de la rupture du mariage ne perpétuait aucun préjugé à l’égard des conjoints de fait, pas plus qu’elle ne résultait de l’application d’un stéréotype. À leur avis, il n’y avait pas d’atteinte au droit à l’égalité fondé sur l’état matrimonial. Quatre autres juges ont décidé que le traitement différencié des conjoints était discriminatoire et qu’il ne pouvait être justifié dans une société libre et démocratique (art. 1 Charte canadienne).
La juge en chef a, elle aussi, jugé cette exclusion discriminatoire, mais elle a néanmoins estimé que ce genre de limite était justifié dans une société libre et démocratique (art. 1 Charte canadienne). Le Québec était libre de statuer sur la protection des conjoints de fait. C’est donc de justesse que la Cour suprême a reconnu le droit du législateur québécois d’exclure les conjoints de fait des dispositions du Code civil prévoyant les conséquences de la rupture du mariage.
En réponse au jugement du plus haut tribunal dans la cause Éric c.
Lola, le ministre de la Justice du Québec a confié au Comité consultatif sur le droit de la famille le mandat d’évaluer l’opportunité de modifier le droit de la famille québécois et
de proposer les éléments à revoir pour assurer la protection des familles en cas de rupture. Dans un rapport préliminaire, ce comité a déjà précisé les
grands principes qui guideront sa réflexion. D’abord, le régime actuel « laisse à découvert une portion importante des couples auprès desquels il aurait
pourtant vocation à s’appliquer »
(Comité consultatif sur le droit de la famille, 2013 : 4).
Le comité estime également que « la principale source
d’interdépendance conjugale et familiale réside dans la naissance ou la prise en charge d’un enfant »
(idem). L’intérêt de
l’enfant, et non la durée de la relation, apparaît central dans la poursuite de la réflexion de ce comité, dirigé par le juriste Alain Roy. Cela pourrait
signifier que dès qu’il y a naissance ou adoption d’enfant, des obligations et des droits spécifiques entre conjoints en découleraient, quel que soit le
type d’union en cause.
Dans ce contexte, une réforme globale du droit familial se dessine, plus de 30 ans après la réforme de 1980. Des points de vue s’affrontent et peuvent être placés sur un spectre qui va de la position minimale de protection à la position maximale de protection du conjoint vulnérable sur le plan financier. Sur ce spectre, s’échelonnent une grande variété de solutions juridiques d’encadrement des unions. Nous examinerons les quatre principales positions en présence.
La première de ces positions repose sur l’hypothèse qu’il est discriminatoire que les articles du Code civil reconnaissant, après la rupture, l’obligation alimentaire des conjoints mariés ou unis civilement ne s’appliquent pas également aux conjoints de fait, qu’ils aient des enfants ou non. Les défenseurs de cette position demandent au législateur une révision du droit de la famille pour reconnaître, dans le Code civil du Québec, l’obligation alimentaire des conjoints de fait, à la fin de l’union. Ils soutiennent qu’une pension alimentaire versée pour les enfants ne pouvant suffire à maintenir le niveau de vie de la famille, celle-ci sera directement appauvrie par la rupture des parents, si le parent gardien se trouve en situation de pauvreté en étant privé d’une pension alimentaire pour lui-même. Cette position est celle qu’ont défendue les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis, dans l’arrêt Éric c. Lola, comme les juges Dutil et Giroux à la Cour d’appel.
La deuxième position, ou position d’intégration, consiste à dire qu’il est discriminatoire de réserver aux conjoints mariés ou unis civilement l’ensemble des dispositions du Code civil qui encadrent juridiquement les conséquences de la rupture. Les articles concernant l’obligation alimentaire tout comme ceux qui visent le partage des biens devraient, selon les défenseurs de cette position, s’appliquer également aux conjoints de fait. Autrement dit, le Code civil devrait être révisé de façon que l’obligation alimentaire, la prestation compensatoire ainsi que les règles de partage du patrimoine familial soient garanties à tous les couples, quel que soit leur statut matrimonial. Dans le cas des unions de fait, des conditions relatives à la stabilité de l’union ou à la présence d’enfants pourraient s’appliquer, pour que le couple se qualifie. Cette position a été défendue par la juge Abella, dans l’arrêt Éric c. Lola. Cette deuxième position intégrationniste peut être déclinée de différentes façons. Les protections juridiques pour tous les couples peuvent être réduites ou augmentées. Par exemple, le contenu du patrimoine familial peut être révisé pour inclure les entreprises. L’encadrement juridique en cas de rupture peut s’appliquer à tous les couples par défaut, ceux-ci pouvant s’exclure en respectant certaines formalités.
Une position mitoyenne entre les deux décrites précédemment consiste à demander une protection juridique identique pour les couples mariés et non mariés dès lors que des enfants sont nés de l’union ou ont été adoptés par le couple. Dans ce cas, pour protéger le meilleur intérêt des enfants, souvent lié à celui du parent le plus vulnérable sur le plan économique, la rupture des conjoints de fait devrait être encadrée de la même manière que celle des conjoints mariés.
La quatrième position veut qu’il soit juste, au nom de la liberté de choix, de ne pas encadrer juridiquement les rapports interpersonnels entre les conjoints de fait. Il n’y aurait pas lieu, par conséquent, d’inclure ces derniers aux articles du Code civil du Québec qui prévoient, pour les conjoints mariés ou unis civilement, l’obligation alimentaire ou qui encadrent le partage des biens après la rupture. C’est le statu quo. Il s’agit de la position défendue par les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver dans l’arrêt Éric c. Lola.
Chapitre 4
Regard comparatif sur l’encadrement juridique de la conjugalité de fait
Dans l’arrêt Éric c. Lola, tout en soulignant le caractère distinct de la société québécoise et de son système de droit, les juges LeBel et Abella invitent le législateur québécois à regarder les solutions d’encadrement juridique des conjoints de fait adoptées par les autres provinces canadiennes14.
L’exercice de droit comparé que nous entreprenons vise ici à découvrir de nouvelles façons d’appréhender le droit, à éviter certaines erreurs, à mieux comprendre notre propre système juridique, à le critiquer et à en dénoncer les mécanismes d’oppression15. L’analyse ne cherche pas à remplacer nos propres débats sur ce sujet ou à adopter des solutions « idéales » toutes prêtes sans réflexion. Si l’effort de droit comparé s’impose dans un contexte de globalisation16 − et le système juridique québécois a su tirer à plusieurs reprises le meilleur parti des solutions étrangères 17 −, il doit se faire aussi avec beaucoup de discernement. Les règles régissant la conjugalité doivent s’analyser dans un cadre plus large : il faut tenir compte des mesures à caractère social et fiscal, des valeurs sociétales, ainsi que des données démographiques des pays donneur et récepteur. Les juristes qui proposent des solutions inspirées d’ailleurs les adaptent à leur propre système juridique.
L’expérience des provinces canadiennes de common law en matière d’encadrement de la conjugalité de fait s’avère intéressante et pertinente pour la réflexion que mène le Conseil sur le sujet. Nous avons aussi choisi d’élargir notre étude à d’autres pays. La situation juridique en France mérite d’être décrite en raison des liens de parenté étroits entre les droits civils québécois et français. Nous nous penchons aussi sur les mesures de protection prévues en cas de rupture des unions de fait en Suède, pays où le droit à l’égalité pour les femmes est le plus abouti18et où le droit de la conjugalité, qui a eu une grande influence sur le droit européen, reflète cette valeur19. Enfin, l’expérience néo-zélandaise nous semble aussi pertinente, puisqu’elle propose un modèle de retrait pour les couples mariés ou non (opting out)20, comme le prévoient la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Saskatchewan et le Manitoba.
La présente étude n’analyse pas la jurisprudence qui interprète les dispositions législatives. Il faut donc être conscient que, dans certains cas, les meilleures intentions législatives peuvent être contrecarrées par des tribunaux conservateurs, réticents ou mal outillés.
La situation dans les provinces et les territoires canadiens de common law
Les provinces et les territoires de common law21 ont trouvé des réponses législatives variées aux conséquences économiques de la rupture conjugale22. Dans certains cas, ils ont imposé une obligation alimentaire en faveur de l’ex-conjoint dans le besoin en fonction de la capacité de payer de l’autre ex-conjoint et du partage du patrimoine familial23.
La nouvelle loi de la Colombie-Britannique entrée en vigueur en mars 2013 mérite une analyse plus poussée. Notons que ces lois visent autant les couples hétérosexuels que les couples homo- sexuels.
L’obligation alimentaire pour l’ex-conjoint de fait
Neuf provinces et les Territoires du Nord-Ouest prévoient une obligation alimentaire entre ex-conjoints de fait lors de la rupture (avec certaines modalités de cohabitation, comme la présence d’enfants ou une période de cohabitation minimale de deux ou trois ans)24.
Cela signifie donc que le Québec est la seule province canadienne qui ne prévoit aucune obligation alimentaire pour l’ex-conjoint le plus vulnérable économiquement en cas de dissolution d’une union de fait.
Goubau, Otis et Robitaille font remarquer que la législation ayant cours dans le reste du Canada était conçue pour protéger les mères et les familles de l’appauvrissement.
L’objectif initial des lois des provinces anglophones qui prévoient une obligation alimentaire entre conjoints de fait était en réalité de venir en aide aux mères qui avaient (comme c’est généralement le cas) la garde des enfants, prenant acte de ce que la maternité représente un facteur d’appauvrissement (Goubau, Otis et Robitaille, 2003 : 46).
Le partage du patrimoine familial entre les ex-conjoints de fait
Les provinces et les territoires de common law régissent différemment le partage du patrimoine familial entre ex-conjoints de fait25. Il est possible de les regrouper sous deux modèles : 1) les conjoints de fait ne sont pas assimilés aux conjoints mariés dans les lois portant sur le partage du patrimoine familial26, mais peuvent sous certaines conditions encadrer les conséquences éco- nomiques de leur rupture; 2) les conjoints de fait sont assimilés aux conjoints mariés dans ces mêmes lois et tous les couples peuvent aménager par le mécanisme contractuel le partage de leur patrimoine familial.
Dans la première catégorie de lois, les conjoints de fait ne sont pas assimilés aux conjoints mariés (ils ne sont pas soumis au partage du patrimoine familial comme prévu par la loi), mais ils peuvent par la technique du contrat27 anticiper les conséquences juridiques de la fin de leur union (par la rupture ou lors du décès de l’un des conjoints). Ils peuvent s’assujettir aux mêmes protections que les conjoints mariés ou à des protections différentes. Leur situation juridique ressemble donc à celle des conjoints de fait québécois, qui peuvent régler le contenu du patrimoine familial et ses modalités de partage par le contrat.
Si les conjoints de fait ne rédigent pas de contrat, en cas de litige, ils peuvent intenter un recours en enrichissement injustifié. C’est le cas en Alberta28, en Ontario29, au Nouveau-Brunswick30, à Terre-Neuve-et-Labrador31, à l’Île-du-Prince-Édouard32 et au Yukon33. Par ailleurs, en Alberta (art. 37 et 38), en Ontario (art. 52), au Nouveau-Brunswick (art. 34), à l’Île-du-Prince-Édouard (art. 51), à Terre-Neuve-et-Labrador (art. 62) et au Yukon (art. 60), les conjoints mariés peuvent conclure des contrats afin d’aménager le contenu et le partage de leur patrimoine familial à leur guise. Ils se trouvent donc à mettre de côté les dispositions législatives qui prévoient le contenu du patrimoine et les modalités de son partage. Ces ententes peuvent évidemment être déclarées nulles par un tribunal en cas de consentement vicié (par exemple, si la partie vulnérable ne comprenait pas les conséquences économiques de l’entente; si elle se sentait obligée de signer afin d’éviter des conséquences pires), ou si l’entente porte atteinte au meilleur intérêt de l’enfant34. Ce droit de retrait pour les couples mariés ou unis civilement n’existe pas au Québec.
Un deuxième groupe de provinces traitent de la même façon les conjoints mariés et de fait relativement au partage du patrimoine familial en cas de rupture : les Territoires du Nord-Ouest35, le Nunavut36, la Saskatchewan37, le Manitoba38 et la Colombie-Britannique39. Notons que les conjoints de fait et mariés peuvent se soustraire à l’application de cette loi au moyen d’une entente entre conjoints, connue au Canada anglais sous le nom d’opting out.
Un commentaire s’impose au sujet de la possibilité de se soustraire à l’application de la loi. Dans un premier temps, la loi vise tous les couples, mariés ou non (dans ce cas, la loi définit les critères de vie maritale), de même sexe ou de sexe différent. Dans un deuxième temps, les couples visés par la loi peuvent prévoir les modalités de partage de leur patrimoine familial dans un contrat et ainsi mettre de côté celles inscrites dans la loi. C’est le mécanisme du droit de retrait. Cependant, ce contrat peut être déclaré nul par un tribunal si les formalités prévues par la loi ne sont pas respectées. Par exemple, si les parties ne se sont pas fait expliquer les conséquences juridiques de leur contrat par un avocat ou une avocate. Dans ce cas, la loi s’appliquera. Donc la possibilité de se soustraire à l’application de la loi est toujours conditionnelle au respect de la loi elle-même40.
Outre ces deux modèles, la Nouvelle-Écosse propose un régime de partenariat enregistré qui permet aux conjoints non mariés qui s’enregistrent auprès du Directeur de l’état civil (Registrar) de partager le patrimoine familial à la fin du partenariat41. Quant aux conjoints de fait qui n’enregistrent pas leur union, ils peuvent établir dans un contrat les modalités du partage du patrimoine42. S’ils n’ont pas prévu de contrat, les règles de l’enrichissement injustifié pourront s’appliquer à eux43. Les conjoints mariés peuvent se soustraire à l’application du partage du patrimoine familial par un contrat44.
L’analyse de la nouvelle loi de la famille de la Colombie-Britannique
En 2010, dans son livre blanc sur la réforme du droit de la famille45, le gouvernement de la Colombie-Britannique note le nombre croissant de conjoints de fait et l’incapacité de la common law (la fiducie constructive [constructive trust]) de leur assurer un juste partage en cas de rupture. Il plaide aussi en faveur d’une plus grande cohérence dans le traitement des conjoints de fait en droit de la famille et dans les autres domaines du droit. Dans cette province, le droit des successions et le droit fiscal reconnaissent déjà les conjoints de fait. Le débat sur la réforme du droit de la famille a duré quelques années. Les groupes féministes ont bien accueilli la protection financière accrue préconisée par le gouvernement pour les conjoints vulnérables en cas de rupture d’une union de fait46, ou y ont opposé peu de résistance. D’autres éléments plus problématiques de la réforme du droit familial – tels les risques de la médiation en cas de violence conjugale – ont retenu davantage leur attention47.
La nouvelle loi donne une définition large de conjoints : ils sont mariés ou ils cohabitent dans une relation semblable au mariage (marriage-like relationship), de même sexe ou de sexe différent48. Dans le cas des conjoints non mariés, ils doivent avoir cohabité de façon continue pendant au moins deux ans pour profiter des avantages de la loi, à moins d’avoir un enfant (art. 3(1))49. Dès qu’il y a naissance d’un enfant, les conjoints sont soumis au nouveau régime de protection.
La loi prévoit le partage du patrimoine familial (l’actif et le passif) en parts égales lors de la séparation des conjoints (art. 81). Elle définit le patrimoine familial (family property). Il ne s’agit plus pour le tribunal de déterminer le caractère familial ou non des biens, comme sous l’ancienne loi. Sont inclus dans le patrimoine, entre autres, tous les biens, les entreprises familiales, les régimes de retraite privés et publics, les maisons, les comptes en banque, l’augmentation pendant l’union de la valeur des propriétés acquises avant l’union (art. 84 (2)). Sont entre autres exclus du patrimoine familial : les biens acquis avant et après l’union, les héritages et les donations (art. 85).
Le tribunal peut partager le patrimoine de façon inégale s’il considère qu’un partage égal serait très inéquitable (significantly unfair) (art. 95). Dans ce cas, il doit tenir compte de certaines circonstances comme la durée de la relation, la contribution d’un conjoint à la carrière de l’autre, le comportement de mauvaise foi d’un conjoint afin de réduire la valeur du patrimoine familial, etc. (art. 95 (2)).
Les conjoints mariés ou non jouissent de la possibilité de retrait en prévoyant dans une convention le contenu et les modalités de partage du patrimoine familial (clause du droit de retrait) (art. 92). La convention doit être faite par écrit, signée par les deux conjoints devant au moins un témoin (art. 93). Le tribunal est alors lié par cet accord. Il peut cependant annuler la convention s’il est convaincu que le consentement de l’un des conjoints n’a pas été obtenu de façon libre et éclairée. Par exemple, si l’un des conjoints n’a pas déclaré tout son actif ou passif, ou tout élément d’information pertinent à l’autre partie lors de la négociation; si l’un des conjoints a profité de la vulnérabilité de l’autre (il a profité de son ignorance, de sa situation de vulnérabilité ou de sa situation de détresse). Ou encore si l’un des conjoints ne comprenait pas la nature ou les conséquences de l’accord.
Bien que la loi n’exige pas l’obtention d’avis juridiques indépendants50, un tribunal pourra déclarer un tel accord nul si le consentement de l’un des conjoints n’est pas libre et éclairé. À ce sujet, il est instructif de prendre connaissance de la première décision rendue à propos de la nouvelle loi :Asselin v. Roy51. Dans une relation de fait de long terme, la conjointe avait signé, à son désavantage, une convention de cohabitation qui excluait des biens importants du patrimoine familial. À la rupture, elle plaide qu’elle n’avait pas reçu de conseil juridique indépendant; elle ne comprenait pas ce qu’elle signait et elle n’avait pas été avertie qu’elle allait rencontrer un avocat pour signer un tel document. Le tribunal considère que le consentement de Madame était vicié et annule l’entente. Il procède ensuite au partage du patrimoine familial.
Le tribunal peut aussi déclarer nulle une convention si elle est très inéquitable en raison du temps écoulé depuis sa conclusion, de l’intention des parties et du respect plus ou moins grand de la convention par ces dernières (art. 93 (5)).
Dans son mémoire sur la réforme du droit
familial, la professeure Susan Boyd (2010) écrivait : [traduction] « Je suis très en faveur de l’inclusion des couples non mariés dans
le régime de propriété, tel que proposé. Ceux qui ne veulent pas être inclus peuvent s’en retirer. Il est préférable de placer sur eux
ce fardeau, car beaucoup de couples vivant en union de fait croient qu’ils sont déjà couverts par le régime52
»
. Le droit de retrait semble donc plus équitable pour le conjoint le plus vulnérable que l’absence totale de
protection prévue dans le régime encadrant l’union de fait au Québec et la possibilité de conclure un contrat de cohabitation. Il est
plus difficile d’obliger quelqu’un à signer un contrat, mais dans un régime avec droit de retrait, le conjoint vulnérable peut plus
facilement refuser de donner son consentement écrit au retrait des protections prévues par la loi en cas de rupture. Et si ce
consentement a été obtenu sous la contrainte, des recours juridiques sont possibles.
La dernière province canadienne à avoir modifié son droit de la conjugalité a choisi un modèle intégrationniste dans lequel les conjoints mariés ou de fait sont traités de la même façon quant au partage du patrimoine familial. Ils peuvent cependant se soustraire à ce régime par la conclusion d’un contrat. Deux tableaux résumant l’encadrement juridique des conjoints et le contenu du patrimoine familial selon les lois provinciales canadiennes sont présentés en annexe.
L’encadrement juridique du concubinage en France
Selon des statistiques françaises récentes, un couple sur cinq vit en union de fait. Les écarts entre générations sont importants, ce qui indique une tendance lourde vers cette forme d’union (80 % des jeunes de 20-24 ans en couple vivent en union de fait, contre 5 % des plus de 65 ans)53. En 2010, on comptait deux pactes civils de solidarité (PACS) pour trois mariages. En France, comme dans d’autres pays occidentaux54, la pluralité caractérise les couples et les familles. Le législateur français est donc intervenu de différentes façons pour accorder ses règles en matière de conjugalité avec les nouvelles réalités sociales. Ainsi, les discussions sur la définition du mariage ont occupé l’espace médiatique français au printemps 2013 avec la reconnaissance du mariage pour tous55.
Le droit français reconnaît trois formes de conjugalité ouverte à tous les couples, de même sexe ou de sexe différent : le mariage, le pacte civil de solidarité (PACS)56 et l’union de fait (concubinage). Le législateur français donne une définition du concubinage à l’article 515-8 du Code civil57. Cependant, il ne lui attache pas de conséquences juridiques58. Le Code civil ne prend pas en compte les unions de fait ni pendant la communauté de vie ni à la rupture. Les conjoints de fait n’assument pas de devoir de secours, de fidélité et d’assistance59, pas de contribution aux charges du ménage, ni de pension alimentaire ou de partage du patrimoine ou des revenus en cas de rupture, pas de droits successoraux, à moins d’avoir rédigé un testament. Par ailleurs, les contrats de concubinage par lesquels les conjoints de fait peuvent organiser les effets juridiques de leur union semblent de plus en plus fréquents. De telles conventions se limitent aux seules relations patrimoniales, à l’exclusion des relations personnelles entre concubins. Notons qu’en concluant un PACS, le couple bénéficie d’un régime légal qui ressemble à la séparation de biens60. Les conjoints de fait peuvent aussi conclure un contrat d’indivision pour l’achat du logement commun61.
Même si elle demeure une situation de fait pour le Code civil, cette forme de conjugalité est par ailleurs reconnue dans d’autres domaines du droit qui s’efforcent d’aligner son statut sur celui du mariage. La législation sociale assimile depuis longtemps les concubins aux époux (droit social, allocation de soutien familial, en matière d’aide juridique, de droit au logement, aide au logement, le droit de recourir à la procréation médicale assistée pour avoir des enfants)62.
Sur le plan fiscal, la loi traite différemment les couples mariés, « pacsés » et de fait, ces derniers bénéficiant ou non de certains avantages réservés aux couples mariés et « pacsés »63.
En cas de rupture, les effets du mariage prévus au Code civil ne régissent pas la vie des conjoints de fait. Comme solution de substitution, ils doivent alors se tourner vers le droit des obligations64. Dans certaines situations, les ex-conjoints de fait pourront recourir à l’enrichissement sans cause, à la société créée de fait, à l’obligation naturelle pour corriger certaines injustices. Néanmoins, la jurisprudence s’est montrée particulièrement exigeante. Bien que le concubinage repose sur le principe de la liberté de rompre l’union à tout moment, la responsabilité civile du conjoint fautif peut aussi être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour compenser le préjudice subi du fait de ses agissements abusifs, déloyaux ou dolosifs.
Se dessine en France une tendance à l’uniformisation juridique des trois formes de conjugalité, le mariage servant de modèle. Certains auteurs concluent à la supériorité du mariage comme institution sur les autres formes d’union65. D’autres y voient une indifférenciation des formes de conjugalité et une source de discrimination à l’égard des conjoints de fait66. Des juristes proposent un droit commun des couples67. Bien que la doctrine souligne les inconvénients et les risques qui peuvent découler de l’absence de régime patrimonial pour les conjoints de fait lors de la rupture68, la littérature scientifique témoigne peu actuellement des revendications pour un traitement juridique identique de tous les couples69. Le législateur français ne semble pas non plus s’inquiéter des injustices que peuvent vivre les conjointes de fait à la dissolution de l’union, puisqu’aucun projet de loi harmonisant les traitements juridiques des couples n’apparaît dans ses carnets.
Cette question n’a pas été soulevée lors des débats portant sur le mariage pour les couples de personnes de même sexe70. L’absence d’un tel discours peut s’expliquer par la place qu’a prise le débat sur le PACS et sur le mariage pour les personnes de même sexe en France.
Il faut aussi souligner que la modification du droit de la conjugalité et de la famille n’a pas été une stratégie retenue par le mouvement des femmes en France, contrairement aux féministes québécoises71. Une meilleure prise en charge sociale du conjoint vulnérable à la suite de la rupture de l’union de fait pourrait aussi expliquer une telle occultation dans les débats politiques72.
L’encadrement juridique des conjoints de fait en Suède
Pour bien comprendre les choix législatifs suédois en matière d’encadrement des conjoints de fait, il faut savoir que le Code du mariage de Suède de 1920 reconnaissait déjà l’égalité entre les époux. Les femmes n’étaient plus sous la tutelle de leur mari et pouvaient administrer leurs propres biens. Le principe du mariage comme projet mutuel, basé sur l’égalité, auquel chaque époux contribue selon ses capacités, jouait un rôle central dans le Code du mariage de 1920. Ce code très libéral dans le contexte européen et avant-gardiste reconnaissait aussi le droit au divorce (déjà inclus dans une loi de 1915) et un régime matrimonial de communauté de biens différée. Cependant la division sexuée des tâches continuait d’avoir cours73. Lors de la réforme du droit du mariage en 1973, l’approche de la neutralité dans le mariage avait été privilégiée par les directives émises par le ministère de la Justice74. Selon cette approche, les couples mariés et non mariés vivant dans des situations identiques ne devaient pas être traités différemment par l’État qui ne devait pas favoriser une forme d’union plutôt qu’une autre. Le principe de l’autonomie des conjoints, qui peuvent librement se marier et divorcer, sous-tendait cette réforme.
Lors de l’adoption de la loi de 1973 prévoyant la protection de la résidence familiale en faveur de l’ex-conjoint de fait dans le besoin à la suite de la rupture75, le législateur suédois a voulu protéger l’ex-conjoint de fait le plus vulnérable, habituellement la femme, des conséquences économiques de la séparation76. En 1973, seulement le quart des Suédoises mariées étaient financièrement indépendantes, entre autres en raison du manque de garderies.
En 1973, le législateur suédois a adapté le droit de la conjugalité au phénomène grandissant des couples non mariés77. Cet objectif de protection et d’égalité a été repris par la suite dans les diverses modifications législatives en matière de conjugalité. Notons que les lois à caractère social et fiscal traitent de la même façon tous les couples et toutes les familles. L’État suédois a créé un filet social visant une meilleure répartition de la richesse entre les pauvres et les riches, entre les femmes et les hommes, les couples mariés et non mariés, les couples de sexe différent et de même sexe, les enfants nés dans le mariage et hors mariage78.
Dès les années 1960, les autorités suédoises ont reconnu que la participation des femmes au marché du travail constituait un moyen important pour les protéger contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La politique familiale suédoise a donc visé le principe de la « double émancipation » : assurer l’accès des femmes au marché du travail79, entre autres par un réseau étatique de garderies et un partage égal entre les parents des tâches familiales, et offrir des congés parentaux très avantageux80.
Aujourd’hui, le taux d’activité des Suédoises s’établit à 77 % et celui des Suédois à 83 %. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à travailler à temps plein (53 % comparativement à 74 %) et on note que 90 % des personnes employées à temps partiel sont des femmes. Les Suédoises passent donc en moyenne moins de temps que les hommes sur le marché du travail (30 h/sem. comparativement à 37 h/sem.) et elles accomplissent davantage de travail non payé à la maison qu’eux (en moyenne 3,5 h/jour comparativement à 2,5 h/jour pour les hommes). Les femmes travaillent à temps partiel pour pouvoir s’occuper des enfants. En 2012, les mères ont pris 76 % des journées de congés parentaux et les pères en ont pris 24 %81.
Le droit suédois prévoit trois formes de conjugalité : le mariage, le partenariat enregistré82 et l’union de fait, ouvertes à tous les couples.
La Loi sur les cohabitants (conjoints de fait) de 200383 a englobé les conjoints de même sexe et de sexe différent84. Cette loi, comme les précédentes de 1973 et de 1987, vise à procurer une protection minimale au conjoint économiquement vulnérable à la fin de l’union conjugale. Selon cette loi, les « cohabitants » doivent habiter ensemble dans une relation permanente à caractère sexuel85. Aucun délai de cohabitation n’est prévu pour profiter des avantages de la loi. Les « cohabitants » doivent partager les tâches et les dépenses du ménage.
La loi prévoit le partage en parts égales de la valeur du « patrimoine familial » pour les conjoints de fait86. Sont inclus dans le patrimoine la résidence familiale et les meubles meublants achetés pour l’usage conjoint (même s’ils ont été achetés avec des revenus gagnés avant le début de la cohabitation). Sont exclus les autos, les chalets, les comptes en banque, les actions d’entreprise, les héritages et les dons. Est aussi exclu l’immeuble acheté avant la cohabitation, et dans lequel emménage l’autre conjoint, puisque cet immeuble n’a pas été acquis en vue de l’usage des deux conjoints87.
Les conjoints de fait peuvent se soustraire à ce régime en concluant une entente écrite et en la signant tous les deux. Si la résidence familiale a été exclue du partage patrimonial, un des ex-conjoints peut quand même obtenir le transfert du bail résidentiel (right to take over, art. 22, Loi de 2003). Le tribunal pourrait modifier le contenu de cette entente si elle est jugée déraisonnable (art. 9, Loi de 2003). Les ex-conjoints de fait ont un an à partir de la fin de l’union (soit la fin de la cohabitation, le décès ou le mariage de l’un d’eux) pour demander la dissolution du régime patrimonial.
Le régime d’application automatique du partage du patrimoine (by default) avec possibilité de retrait a été préféré à un régime d’enregistrement (registration procedure), parce que ce dernier système n’assure pas la meilleure protection sociale. Il y a un grand risque que le conjoint le plus vulnérable ne soit pas en mesure d’enregistrer son union. Comme les conjoints de fait suédois étaient peu enclins à rédiger des ententes de cohabitation, ils n’auraient pas été portés à enregistrer leur union.
La loi encadrant l’union de fait en cas de rupture a une portée plus limitée que le Code du mariage. D’abord, aucune obligation alimentaire lors de la rupture n’est prévue entre conjoints de fait. Il faut cependant noter que l’obligation alimentaire pour les ex-conjoints mariés revêt un caractère exceptionnel et temporaire. Il s’agit du principe du clean break, que l’on pourrait traduire par « règlement définitif », à la suite du divorce. Selon le Code du mariage suédois, le divorce met fin à toute obligation légale entre conjoints mariés. Donc après le divorce, chaque ex-époux doit subvenir à ses propres besoins (chap. 5, art. 7 Code du mariage). Lorsque nécessaire, un ex-époux ou une ex-épouse aura droit à une pension alimentaire pour une période transitoire (de un à quatre ans) après le divorce (chap. 6, Code du mariage). Cette aide vise à permettre à l’ex-époux dans le besoin de compléter son éducation ou de trouver un emploi, sans avoir à s’endetter. Le principe du clean break, prévu dans le Code du mariage de 1978, avait été auparavant développé par les tribunaux. Il envoyait le message que le mariage est une union volontaire à laquelle chaque époux peut mettre fin. La mise sur pied de l’État-providence entre 1930 et 1970 encourageait les femmes à quitter le domicile, à travailler sur le marché du travail et à être indépendantes financièrement. Cependant, au cours du mariage, les époux doivent partager les dépenses du ménage et ils ont droit au même niveau de vie.88.
Ensuite, un régime matrimonial de communauté de biens différée est appliqué aux époux (il y aura partage des biens lors de la dissolution du mariage). Pendant le mariage, chaque conjoint est propriétaire de ses biens et est responsable de ses propres dettes89.
Le patrimoine familial est plus englobant pour les époux que pour les conjoints de fait90. De plus, contrairement aux conjoints mariés, les conjoints de fait ne sont pas visés par les règles successorales, bien qu’ils puissent rédiger un testament en faveur de leur conjoint91.
Les couples mariés peuvent se soustraire au régime de partage du patrimoine familial (communauté de biens différée) au moyen de l’enregistrement d’un contrat de mariage écrit et signé par les deux conjoints, déposé auprès d’un tribunal de première instance92. Ils peuvent ainsi choisir la séparation de biens au lieu du partage93. Il s’agit d’une simple procédure écrite qui ne requiert pas la présence d’avocats ou celle des parties. Le tribunal ne vérifie pas la validité du contrat. Le contrat de mariage est ensuite inscrit dans un registre central (Sweden’s Central Marriage Registry). Lors du divorce, la validité de ce contrat pourra être remise en question.
L’encadrement juridique des conjoints de fait en Nouvelle-Zélande
En 2001, la Nouvelle-Zélande a inclus les conjoints de fait dans sa législation sur le partage du patrimoine familial94. Ainsi, les couples mariés de sexe différent et les couples en union de fait de même sexe ou de sexe différent étaient automatiquement traités de façon semblable en cas de rupture. En 2005, le législateur néo-zélandais a adopté le concept d’union civile (partenariat enregistré) pour les couples de même sexe et de sexe différent95. Les unions civiles étaient prises en compte de la même façon que les mariages. En 2013, la définition du mariage a été élargie pour inclure les couples de même sexe96. Donc, la Nouvelle-Zélande reconnaît et encadre législativement de façon à peu près identique les mariages, les unions civiles et les unions de fait pour tous les couples, de même sexe ou de sexe différent97. Par ailleurs, tous les couples visés par la loi peuvent décider de se soustraire à son application par une démarche contractuelle (droit de retrait).
La loi de 2001 prévoit à son article 1 N les principes qui la sous-tendent et qui doivent guider l’atteinte des objectifs législatifs : l’égalité entre les femmes et les hommes, la reconnaissance de la valeur égale de toutes les contributions aux mariages, unions civiles et unions de fait, une juste division du patrimoine familial en tenant compte des désavantages économiques engendrés par la relation et le principe que tout litige découlant du partage du patrimoine doit se régler à peu de frais, simplement et avec célérité.
Aux fins de notre propos, quatre aspects retiendront notre attention : la définition de conjoint de fait, la possibilité de se soustraire à l’application de la loi, le contenu du patrimoine familial et l’obligation alimentaire.
Sont considérés comme des conjoints de fait, au sens de la loi, deux personnes vivant ensemble comme un couple depuis plus de trois ans98, et qui ne sont pas mariées ou unies civilement. La loi propose des critères pour déterminer l’existence d’un tel couple99. En cas de cohabitation de moins de trois ans (relationship of short duration), suivie d’une séparation, le droit commun s’applique aux ex-conjoints de fait (entre autres par la notion de constructive trust)100.
Le Property (Relationships) Act 1976 de 2001 impose un régime de communauté de biens différé, le partage du patrimoine familial ayant lieu lors du divorce, de la rupture ou du décès101. Une présomption de partage égal du patrimoine s’applique102. Sont inclus dans le patrimoine la résidence familiale, les meubles meublants, les entreprises familiales, les placements financiers, les fonds de retraite et les polices d’assurance (relationship property). Les biens acquis avant le mariage, l’union civile ou l’union de fait (et qui n’ont pas été inclus dans le patrimoine familial au cours de l’union), les donations et les héritages reçus avant le mariage, l’union civile ou l’union de fait (et qui n’ont pas été inclus dans le patrimoine familial au cours de l’union) sont exclus (separate property). La résidence familiale et les meubles meublants, peu importe leur date d’acquisition, ne peuvent être exclus du patrimoine.
Le Property (Relationships) Act offre la possibilité aux couples mariés, en union civile ou en union de fait de prévoir le contenu et les modalités de partage du patrimoine familial par la conclusion d’accords. Ces ententes peuvent être conclues avant l’union, pendant l’union pour exclure certains biens, ou au moment de la séparation (entente prénuptiale, entente de cohabitation ou entente de séparation). Précisons qu’en 1976, les couples mariés pouvaient aussi se soustraire à l’application de la Matrimonial Property, 1976 (art. 21). À partir de 1986, les conjoints de fait pouvaient conclure un contrat de cohabitation, modification législative qui a mis fin à certains doutes sur la validité de ces ententes103.
Comme nous l’avons vu pour d’autres lois du même type offrant la possibilité aux conjoints de se soustraire aux modalités de partage du patrimoine familial, des formalités sont imposées à la conclusion de l’accord pour assurer un consentement libre et éclairé des conjoints104. L’entente doit être faite par écrit et signée par les deux parties devant avocat. Chacune des parties doit avoir reçu des conseils juridiques indépendants qui visent à expliquer les conséquences de l’entente (donc de deux avocats différents) avant de signer. Les principes de base en matière contractuelle peuvent aussi être utilisés pour annuler toute entente qui y porterait atteinte. La possibilité pour les couples de prévoir, à l’intérieur de certaines limites, leur propre régime matrimonial par contrat a permis une plus grande acceptabilité sociale de la portée élargie de la loi de 2001, qui incluait les unions de fait105. Afin de permettre à plus de couples de conclure une telle entente à moindres frais, le législateur néo-zélandais a même prévu un modèle de contrat (optionnel), dans une annexe de la loi106. Le tribunal conserve la possibilité d’invalider de telles ententes lorsqu’il en découle un sérieux préjudice. La loi prévoit un délai de prescription pour s’adresser au tribunal de la famille afin de demander un partage du patrimoine107. Les couples mariés ou en union civile ont 12 mois à la suite de la dissolution de leur union pour présenter une telle demande. Quant aux couples en union de fait, ils disposent de trois ans à la suite de leur séparation.
Le tribunal peut accorder une somme forfaitaire à l’un des ex-conjoints ou un transfert de propriété des biens faisant partie du patrimoine, si le revenu et le niveau de vie de l’un des ex-conjoints sont supérieurs de façon significative à ceux de l’autre, à la suite de la séparation. Cette disparité économique doit découler du partage des tâches pendant l’union. Par exemple, un des conjoints a renoncé à sa carrière pour permettre à l’autre de se consacrer à la sienne; un des conjoints s’est occupé des enfants ou a soutenu financièrement l’autre conjoint qui a poursuivi ses études108. Cette disposition met donc de côté le principe du partage égal du patrimoine.
L’obligation alimentaire entre ex-conjoints a un caractère temporaire. Des conditions strictes encadrent l’attribution d’une telle pension, les ex-conjoints ayant l’obligation d’assurer leur survie économique. Par exemple, peut être pris en compte le fait qu’un des conjoints a la garde exclusive des enfants issus de l’union, un des conjoints a renoncé à un travail rémunéré et s’est occupé des tâches ménagères et des enfants pendant l’union, ou encore un des conjoints retourne aux études après la rupture pour améliorer sa capacité de gagner des revenus.
Comme dans d’autres pays occidentaux, depuis les années 1970, se dessinent au Canada, en France, en Suède et en Nouvelle-Zélande des tendances législatives similaires en matière de conjugalité reflétant la progression des droits des femmes : d’abord, un plus grand accès au divorce jusqu’au divorce sans faute, une reconnaissance de l’apport du travail des femmes dans la sphère privée lors de la rupture (par un régime de communauté de biens différé avec un partage égal des biens), ensuite une reconnaissance sociale et législative progressive des unions de fait hétéro- sexuelles (dans toutes les lois), puis des conjoints de fait de même sexe par une institution autre que le mariage (comme le partenariat enregistré), et enfin, l’ouverture du mariage pour tous.
Il faut noter aussi que le Québec ressort comme étant un cas unique dans cette analyse de droit comparé. Contrairement à ceux d’autres provinces et de beaucoup de pays, les couples mariés et unis civilement au Québec ne peuvent pas, d’un commun accord, se retirer du régime imposé par l’État qui définit et partage également le patrimoine familial. Par ailleurs, c’est aussi au Québec que la protection juridique pour les couples vivant en union de fait est la moins grande advenant une rupture. En fait, aucune protection particulière n’est prévue dans le Code civil pour le conjoint le plus vulnérable économiquement en cas de rupture, alors que les statistiques indiquent que le mariage est en sérieuse décroissance au Québec, et qu’il compte le plus grand nombre d’unions de fait des pays occidentaux, toute proportion gardée.
Chapitre 5
Liste des recommandations du Conseil
Pour le Conseil du statut de la femme, la différence d’encadrement juridique entre le mariage et l’union de fait représente une forme de discrimination qui est particulièrement préjudiciable pour les conjointes de fait. Comme nous l’avons vu, la réalité quotidienne du couple non marié n’est pas différente de celle du couple marié. Or, en se retirant du marché du travail ou en diminuant leur nombre d’heures rémunérées pour prendre en charge la plus grande part du travail parental et domestique, bon nombre de conjoints (qui sont le plus souvent des femmes) se placent en position de vulnérabilité économique, advenant une rupture. L’absence de protection juridique pour celles qui vivent en union de fait peut les placer dans une situation très précaire. Elles deviennent alors les seules à subir les conséquences des choix, établis par solidarité familiale et conjugale, qu’elles font avec leur conjoint de renoncer au développement de leur carrière pour toutes sortes de raisons : donner naissance à un enfant et en prendre soin, s’occuper d’un parent malade, accepter de nombreux déménagements pour suivre le conjoint. Le Conseil croit que toutes les conjointes de fait, qu’elles aient des enfants ou non, doivent être protégées en cas de rupture. Il est certain que les conjoints de fait masculins peuvent aussi se retrouver, en moins grand nombre, dans une telle situation de vulnérabilité et ils doivent, eux aussi, bénéficier d’une telle protection.
La majorité des familles monoparentales étant dirigées par une femme, la protection des ex-conjointes, peu importe le type d’union, profiterait à toute la famille. Le Conseil croit que l’absence d’encadrement juridique des unions de fait prive les familles des mécanismes capables de leur assurer un niveau de vie équitable après la rupture des conjoints. Nous souhaitons favoriser le développement d’une solidarité entre les membres du couple, et ce, peu importe la forme de l’union conjugale. Nous croyons que cette solidarité devrait permette au conjoint le plus vulnérable d’obtenir le soutien financier du conjoint favorisé, à la fin de l’union, tant et aussi longtemps que la cohabitation a une durée raisonnable ou a engendré un enfant.
Il est nécessaire, selon nous, que le droit familial reconnaisse le principe du partage équitable des conséquences économiques de l’union de fait, au même titre que celles du mariage. Cet avis nous a permis de montrer que, tant dans les unions de fait que dans les unions matrimoniales, le poids des responsabilités familiales peut modifier le parcours professionnel d’un des conjoints en l’incitant à réduire sa prestation de travail rémunéré. En pareil cas, il y a d’un côté des inconvénients économiques pour le conjoint qui privilégie les charges familiales et de l’autre côté, des avantages économiques pour le conjoint qui privilégie le travail rémunéré. La loi devrait permettre de maintenir, dans la limite du possible, un niveau de vie équitable pour la famille après la rupture.
Après une étude approfondie des différents modèles juridiques existant au Canada et ailleurs, le Conseil estime qu’au Québec les conjoints de fait devraient bénéficier de la même protection juridique que les couples mariés au moment de la dissolution de l’union. C’est le choix que la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ont fait. À des degrés divers, la Suède et la Nouvelle-Zélande protègent aussi les conjoints de fait en cas de rupture.
Aux yeux du Conseil, l’État québécois a le devoir, lui aussi, d’assurer la protection juridique de la conjointe ou du conjoint le plus vulnérable au moment de la rupture. Le niveau de vie de la famille et celui des enfants en dépendent. Pour le Conseil, il est impératif que le droit familial du Québec s’ajuste aux réalités sociales changeantes.
Il faut considérer que le mariage est rarement refusé d’un commun
accord par les deux membres d’un couple. Pour ceux-ci, le refus du mariage équivaut à un consentement à l’union de fait, et nous dirons avec Moore que ce
refus « a ceci de particulier qu’il ne s’exprime pas nécessairement de manière particularisée; souvent il ne découlera que du passage du temps »
(Moore,
2010 : 104). S’ajoutant à cela, il est plutôt rare, comme nous l’avons vu précédemment, que les conjoints de fait concluent une convention pour encadrer
les conséquences de leur union.
Dans un tel contexte, le statu quo conduirait à refuser la protection juridique à la plupart des couples en union de fait qui n’ont pas conclu de convention. Aussi, pour que la protection des conjoints contre les effets socioéconomiques de la conjugalité s’applique au plus grand nombre, le Conseil du statut de la femme recommande :
Que l’obligation alimentaire s’applique aux conjoints de fait, de la même façon qu’elle s’applique aux conjoints mariés, et que les conjoints de fait soient soumis aux règles de partage du patrimoine familial, celui-ci comprenant les principaux biens acquis par l’un ou l’autre des conjoints pendant la durée de l’union. Les conjoints de fait seraient soumis à l’ensemble de ces règles, dès lors qu’ils satisferaient aux conditions de cohabitation établies (par exemple, s’ils ont cohabité de façon continue pendant deux ans ou s’ils ont eu des enfants ensemble).
Même si l’opportunité de négocier ne se présente pas dans la majorité des couples, il faut reconnaître que le régime que nous proposons d’application par défaut peut ne pas convenir à la totalité des couples. Ce sera le cas, par exemple, de deux adultes d’un âge avancé, qui ont eu des enfants d’unions précédentes et qui ne veulent pas prendre d’engagement financier vis-à-vis d’une autre personne. Pour tenir compte de ces situations particulières, le Conseil propose de permettre aux couples qui le désirent de se soustraire au régime de protection offert par défaut. Il recommande donc au législateur :
Que les conjoints de fait puissent se soustraire à l’application du régime (droit de retrait) en décidant d’un commun accord des modalités de partage du patrimoine qu’ils préfèrent voir appliquées. Dans l’optique de s’assurer d’un réel consentement de la part des deux parties, des formalités devraient être respectées: les deux conjoints devraient recevoir des conseils juridiques indépendants pour parvenir à une entente équitable et signer, devant témoin, une convention sur les règles de partage. La forme notariée serait requise, afin de garantir un consentement éclairé conformément au droit civil109.
Les personnes à faible revenu pourraient bénéficier d’une forme de remboursement des frais engagés pour la consultation juridique.
Étant donné la méconnaissance répandue dans la population des modalités des différents régimes de conjugalité, le Conseil recommande :
Qu’une vaste campagne d’information destinée au grand public accompagne la future réforme du droit familial, en mettant un accent particulier sur les différences entre le mariage et l’union de fait afin que les couples puissent faire un véritable choix en toute connaissance de cause.
Conclusion
Le Conseil du statut de la femme estime qu’il est temps que les conjointes et les conjoints de fait bénéficient d’une véritable protection juridique, car la réalité sociale québécoise a beaucoup changé depuis 1980, année de la dernière réforme majeure du droit de la famille. Près de quatre couples sur dix (37,8 %) vivent maintenant en union de fait, alors que la proportion n’était que de 8,3 % en 1981. Plus de 60 % des enfants québécois naissent dans ce type d’union et les ruptures y sont aussi fréquentes que dans les mariages. Elles touchent près d’un couple sur deux.
Dans cet avis, le Conseil s’est appliqué à démontrer les limites de la liberté de choix des conjointes de fait, tout en soulignant les conséquences économiques possibles de la rupture des unions de fait sur les femmes et les enfants. Il s’est aussi penché sur l’évolution du droit de la famille québécois, depuis les années 1980, ainsi que sur l’encadrement des conjoints de fait prévu dans d’autres législations dont le Québec pourrait s’inspirer.
Les nombreux bouleversements sociaux survenus depuis la Révolution tranquille ont amené la population québécoise à rejeter l’emprise de l’Église et à tourner le dos à l’institution du mariage. Se percevant comme libres et égaux, les individus sont persuadés qu’ils doivent assumer seuls les conséquences de leurs choix. Mais l’organisation de la vie familiale tarde à évoluer: les transformations associées à la diffusion de la norme d’égalité entre les sexes et à une montée de l’individualisme se sont répercutées de manière limitée sur la division du travail domestique et parental. Notre société et, avec elle, l’institution de la famille continuent d’être structurées par des rapports sociaux de sexe inégalitaires, ce qui limite et oriente différemment la liberté de choix des divers acteurs au sein de la famille.
Le Conseil a longtemps soutenu que, bien informées à propos des droits et obligations conférés par le mariage ou par l’union de fait, les femmes seraient en mesure de choisir la forme d’union conjugale la plus adaptée à leur situation personnelle. Le Conseil espérait qu’en étant mieux informées, les femmes sauraient que, dans le cadre d’une union de fait, une entente de vie commune était nécessaire pour prévoir les conséquences de la rupture éventuelle. Au regard de la protection des conjoints de fait, les recommandations du Conseil se limitaient donc à demander au législateur de mener des campagnes d’information sur le fait que le traitement juridique des conjoints variait selon la forme d’union dans le Code civil et sur le rôle des contrats d’union de fait. Or, comme le révèlent les plus récents sondages de la Chambre des notaires, la majorité des couples en union de fait ignorent toujours que le droit actuel ne leur procure pas la même protection juridique qu’aux conjoints mariés. Quant aux contrats d’union de fait, les mêmes sondages révèlent que peu de couples y recourent.
Ces données et l’absence d’égalité de fait entre les conjoints et les conjointes amènent donc le Conseil à remettre en cause le caractère éclairé des choix faits par les femmes pour une forme d’union plutôt qu’une autre.
De plus, malgré la croissance de la proportion d’unions de fait au Québec, les pratiques au sein des couples hétérosexuels demeurent telles que, lorsque la famille s’agrandit, les femmes continuent de s’investir davantage dans les tâches non rémunérées au sein de la maisonnée tandis que les hommes accroissent leur participation au travail rémunéré. Ces comportements ont pour effets d’accroître la vulnérabilité économique des femmes et de les exposer à un risque accru de pauvreté, advenant la rupture du couple.
L’examen des conditions économiques dans lesquelles vivent les familles québécoises d’aujourd’hui permet de mettre en évidence les différences entre celles qui sont dirigées par deux parents et celles qui le sont par un seul. Or, la plupart des familles ayant à leur tête un parent seul – dont 76 % sont dirigées par des femmes – ont été formées à la suite d’un divorce ou d’une rupture d’union de fait.
Au regard de l’évolution du droit familial au Québec, le Conseil constate enfin que, bien que la perception de l’union de fait se soit transformée depuis 1980, au point de devenir une forme d’union conjugale pleinement reconnue dans la société et dans les lois sociales, les unions de fait n’ont acquis durant ce temps aucun statut dans le Code civil. Elles demeurent donc exclues de la protection juridique prévue pour les conjoints mariés en cas de rupture, à savoir le droit à une pension alimentaire et au partage du patrimoine familial pour celui des deux conjoints, le plus souvent la femme, qui a touché, durant l’union, le revenu d’emploi le plus faible. Puisque les couples ont des comportements similaires, qu’ils soient unis par le mariage ou dans le cadre d’une union de fait, et qu’ils jouent le même rôle au sein de leur communauté, le Conseil remet en cause le traitement différencié qui est accordé dans le Code civil aux ex-conjoints, selon la forme de leur union. Le traitement équivalent des couples dans les lois sociales et fiscales milite aussi en faveur d’une définition de conjoint qui assimile les deux formes d’union.
En somme, le Conseil montre dans cet avis que, dans les unions hétérosexuelles, les conséquences juridiques de la rupture d’une union de fait sont généralement ignorées par la population québécoise, ce qui permet d’invalider la théorie du choix individuel libre et éclairé. Par ailleurs, l’organisation matérielle de la vie conjugale demeurant façonnée par la division sexuelle du travail, les femmes se retrouvent souvent en situation de vulnérabilité économique du fait de leur plus important investissement dans l’espace domestique. Elles sont donc en général désavantagées advenant la rupture du couple. Dans un tel contexte, les arguments soutenus pour défendre le traitement inégal des couples mariés et non mariés ne tiennent plus.
Pour le Conseil, le conjoint vulnérable ne doit pas assumer seul, au moment de la rupture, les conséquences des choix faits au nom du bien-être de la famille, tant dans le cadre d’une union de fait que dans celui du mariage. Une modification du Code civil devient nécessaire pour que l’obligation alimentaire de même que les dispositions sur le partage du patrimoine familial s’appliquent à tous les couples, quel que soit leur statut matrimonial, et qu’il y ait eu ou non des enfants issus de l’union.
Par les recommandations qu’il formule dans cet avis, le Conseil du statut de la femme prend position pour que la réforme du droit familial québécois corresponde vraiment à la situation concrète de la majorité des femmes et des couples d’aujourd’hui. Il demande ainsi au législateur d’accorder un traitement juridique équitable à toutes les personnes qui, s’engageant dans une vie conjugale, tentent de concilier les responsabilités inhérentes à la vie familiale avec les exigences élevées du travail salarié et professionnel.
Annexe 1
| Provinces | Obligation alimentaire pour ex-conjoints mariés ou non | Traitement législatif identique conjoints de fait/époux pour partage du patrimoine | Contrat entre époux (partage du patrimoine) | Contrat entre conjoints de fait (partage patrimoine) (reconnu dans la loi) | Contrat entre conjoints de fait (non prévu spécifiquement par la loi de la famille) | Obtention de l’usage de résidence familiale par conjoint de fait non propriétaire (prévu dans la loi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Ontario | Oui | Non | Oui | Oui | Non | |
| Colombie-Britannique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Alberta | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |
| Manitoba | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Nouveau-Brunswick | Oui | Non | Oui | Oui | Non | |
| Nouvelle-Écosse | Oui | Seulement en cas de partenariat enregistré | Oui | Non | Oui | Oui |
| Île-du-Prince-Édouard | Oui | Non | Oui | Oui | Non | |
| Saskatchewan | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | Non | Oui | Oui | Non | |
| T.D.N.O. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Nunavut | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Yukon | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
Annexe 2
| Provinces et territoires | Biens inclus dans le patrimoine familial | Biens exclus du patrimoine familial | Possibilité de retrait par la conclusion d’un contrat entre conjoints mariés ou de fait |
| Ontario Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 |
Les biens ayant servi à des fins de transport, de logement, d’éducation, pour la maisonnée, pour les loisirs, à des fins sociales ou esthétiques, pour un conjoint ou pour les deux ou pour le ou les enfants, les régimes de pensions privés ou publics, les actions en bourse, les comptes en banque, les équipements électroniques, les objets d’art; l’augmentation pendant l’union de la valeur des propriétés acquises avant l’union (art. 4(1)) | Entre autres : des dons ou des héritages reçus pendant le mariage et provenant de quelqu’un d’autre que le conjoint, sous réserve que ces dons ou héritages n’aient pas été utilisés pour le foyer conjugal (art. 4(1)). Les biens acquis avant et après l’union. | Oui, Art. 52 |
| Alberta Matrimonial Property Act, R.S.A. 2000, C. M-8 |
Comme en Ontario, plus les entreprises familiales (art. 1(b)) | Comme en Ontario(art. 1(b)) | Oui, Art. 37 et 38 |
| Nouveau-Brunswick Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.-B. 2012, c. 107 |
Comme en Ontario(art. 1) | Comme en Ontario(art. 1) | Oui, Art. 34 |
| Terre-Neuve-et-Labrador Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-2 |
Comme en Ontario(art. 18 (c)) | Comme en Ontario(art. 18 (c)) | Oui, Art. 51 |
| Île duPrince-Édouard Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-2.1 |
Comme en Ontario(art. 4 (1) b)) | Comme en Ontario(art. 4 (1) b)) | Oui, Art. 51 |
| Yukon Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 2002, c. 88 |
Comme en Ontario(art. 4) | Comme en Ontario(art. 4) | Oui, Art. 60 |
| Nouvelle-Écosse Matrimonial Property Act, RSNS 1989, c 275 |
Comme en Ontario(art. 4 (1)) | Comme en Ontario(art. 4 (1)) | Oui, Art. 23 |
| Manitoba Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. c. F25 |
Comme en Ontario(art. 1(1) ) | Comme en Ontario(art. 1(1)) | Oui, Art. 5 |
| Colombie-Britannique Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25 |
Comme enOntario, plus les entreprises familiales | Comme en Ontario(art. 84 (2), art. 85) | Oui, Art. 92 |
| Saskatchewan Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F-6.3. |
Comme en Ontario(art. 2 (1), art. 33) | Comme en Ontario(art 2 (1)) | Oui, Art. 24 et 38 |
| Territoires du Nord-Ouest Loi sur le droit de la famille, L.T.N.-O. 1997, ch. 18. |
Comme en Ontario | Comme en Ontario | Oui, Art. 3 et 4 |
| Nunavut Family Law Act (Nu) 1997 c. 18. |
Comme en Ontario(art.33) | Comme en Ontario | Art. 10. |
Bibliographie
AGELL, Anders (1980). « The Swedish Legislation on Marriage and Cohabitation - A Journey without a Destination », 24 Scandinavian Stud. L. 9.
AKERBLOM, Annika (2004-2005). « La parité hommes-femmes en Suède : une rétrospective », Nordiques, no 6, p. 77-100.
AMAR, Élise et Sophie GUÉRIN (2007). « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Économie et statistique, n° 401, p. 23.
AMBERT, Anne-Marie (2005). Union libre et mariage: y a-t-il des similitudes?, Institut Vanier de la famille, Ottawa, 28 pages.
ATKIN, Bill (2008). « The Legal World of Unmarried Couples - Does The New Zealand Approach Shed any Light on the Future? », 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 793.
ATKIN, Bill (2007). « Economic Disparity – How did we end up with it? Has it been worth it? », 5 New Zealand Family law Journal 299.
ATKIN, Bill (2003). « The Challenge of Unmarried Cohabitation – The New Zealand Response », 37 Family L Quarterly 303.
AUSTIN, Graeme W. (2006). « Essay : Family Law and Civil Union Partnerships – Status, Contract and Access to Symbols », 37 Victoria U. Wellington L. Rev. 183.
BADEL, Maryse, Anne-Marie GILLES, Jean-Pierre LABORDE, Valérie LACOSTE et Monique SUBRENAT (2003). « Référence au lien familial et accès aux droits sociaux », Recherches et Prévisions, Dossier Famille et droit social, n° 73 (septembre), p. 25.
BALA, Nicholas (2003). « Controversy over Couples in Canada : The Evolution of Marriage and Other Adult Interdependent Relationships », 29 Queen’s L.J. 41.
BARSALOU, Dominique (2013). Ma mère ne travaille pas. Le traitement juridique de la mère au foyer en droit québécois de la famille, Cowansville, Blais, 262 pages.
BELLEAU, Hélène (2012). Quand l’amour et l’État rendent aveugle – Le mythe du mariage automatique. Presses de l’Université du Québec, Québec, 158 pages.
BELLEAU, Hélène, Marie-Josée BÉCHARD, Manon LACHAPELLE, Christelle LEBRETON et Julie SAINT-PIERRE (2008).Enquête qualitative sur les représentations de la conjugalité au Québec, INRS-Urbanisation, Culture et Société, Montréal, 81 pages.
BELLEAU, Hélène, et Pascale CORNUT-ST-PIERRE (2011). « La question du “choix” dans la décision de se marier ou non au Québec », Lien social et Politiques, n° 66, p. 65-89.
BÉNABENT, Alain (2012). Droit de la famille, Paris, Montchrestien.
BLOUGH, Rachel (2009). « Le concubinage, dix ans après », Dr. fam. Études 19, p. 2.
BOSHIER, Peter (2008). « Is there a Yardstick of Equality in our backyard?», 13th National Family Law Conference, Adelaide Convention Centre (8 April), [en ligne sur le site du ministère de la Justice de la Nouvelle-Zélande], http://www.justice.govt.nz/courts/family-court/publications/speeches-and-papers/is-there-a-yardstick-of- equality-in-our-backyard (Page consultée le 9 janvier 2014).
BOURGAULT-CÔTÉ, Guillaume (2013). « Recensement - Le Québec fait famille à part, La province se distingue sur tous les plans par rapport au Canada », Le Devoir, 12 septembre.
BOYD, Susan (2010). Feedback on White Paper on Family Law, Faculty of Law, University of British Columbia, Vancouver, B.C., p. 6 (Copie obtenue de l’auteure).
BRACHET, Sara (2007). « Les résistances des hommes à la double émancipation. Pratiques autour du congé parental en Suède », Sociétés contemporaines, vol. 01, n° 65, p. 175-197.
BRACHET, Sara (2004). « L’égalité : une vaine quête ? Hommes, femmes et congé parental en Suède », Terrain, Revue de l’ethnologie de l’Europe [En ligne], http://terrain.revues.org.acces.bibl.ulaval.ca/1735, (Page consultée le 8 mai 2014).
BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL (2010). White Paper on Family Relations Act Reform: Proposals for a New Family Act (July).
BRUNETTI-PONS, Clotilde (2002). « Couple, concubinage et PACS, De l’émergence d’une hiérarchie des couples ? », dans Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, Paris, LGDJ, p. 37.
BRUNETTI-PONS, Clothilde (1999). « L’émergence d’une notion de couple en droit civil », Rev. Trim. Dr. civ. 27.
CASTONGUAY, Alec (2010). « “Lola et Éric“ : pas d’obligation financière sans contrat de mariage, disent les Québécois », Le Devoir, lundi 15 novembre, p. A4.
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC et CROP (2013). Sondage sur les perceptions des Québécois vivant en union de fait quant à leur état matrimonial (mars).
CHELACK , Colette, et Joan MACPHAIL (2005). « Sharing a Life : Manitoba Legislation Respecting Rights and Obligations of Common-Law Partners », 31 Man. L.J. 111.
COCHARD, Renee R (2012). « Unmarried Cohabitants : Property Rights : A Gendered Analysis » (November) (inédit). COLLECTIF CLIO (1992). L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 646 pages.
COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE (2013). Rapport sur l’opportunité d’une réforme globale du droit de la famille québécois, Québec (septembre), 14 pages.
COMMISSION DE DROIT EUROPÉEN DE LA FAMILLE (Page consultée le 9 janvier 2014), [en ligne], http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-French1.pdf.
COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE. (Page consultée le 25 novembre 2013). Annual Report 2012 - 2013, [en ligne], http://www.lawreform.ns.ca/Downloads/Annual%20Report%202012-13.pdf.
COMMISSION DU DROIT DU CANADA (2001). Au-delà de la conjugalité. La reconnaissance et le soutien des rapports de nature personnelle entre adultes, Ottawa.
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (2013). Perspective Grand Montréal, no 24, Montréal (décembre), 8 pages.
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (1995). Avis sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [recherche et rédaction : Lucie Desrochers], Québec, 41 pages.
CORBEIL, Christine et Francine DESCARRIES (2003). « La famille : une institution sociale en mutation », Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, no 1, p. 16-26..
Couples en Europe, Le droit pour les couples dans 27 pays européens, Suède, (Page consultée le 17 novembre 2013), [en ligne], http://www.coupleseurope.eu/fr/sweden/topics/8-Que-pr%C3%A9voit-la-loi-pour-les-biens-des-partenaires-enregistr%C3%A9s-et-non-enregistr%C3%A9s.
CRESPO, Stéphane (2009). « Entrer dans une situation de faible revenu et en sortir : les influences d’événements relatifs au travail et à la famille », Données sociodémographiques en bref, volume 14, numéro 1, Institut de la statistique du Québec (octobre).
Dalloz action Droit de la Famille, (Page consultée le 17 novembre 2013) (en ligne). http://www.dalloz.fr.acces.bibl.ulaval.ca/documentation/Document?id=DAFAMILLE#TargetSgmlIdACTION/FAMILLE/L0T0
Dalloz Répertoire de droit civil, (Page consultée le 17 novembre 2013) (en ligne). http://www.dalloz.fr.acces.bibl.ulaval.ca/documentation/Document?id=CIV
DANDURAND, Renée B. (1990). « Le couple : les transformations de la conjugalité», p. 23-41 dans Denise LEMIEUX,Familles d’aujourd’hui, IQRC, Québec, 243 pages.
DANDURAND, Renée B. (1988). Le mariage en question. Essai sociohistorique, Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 188 pages.
DANDURAND, Renée B. et Lise ST-JEAN (1988). Des mères sans alliance. Monoparentalité et désunions conjugales, Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 297 pages.
DEL VALLE-LÉZIER, Ismérie (2005). « Solidarité dans les couples, Les aspects civils », Revue française des affaires sociales, vol. 4, n° 4, p. 81-100.
DESCARRIES, Francine et Christine CORBEIL (2002). « Articulations famille/travail : quelles réalités se cachent derrière la formule? », dans F. DESCARRIES et C. CORBEIL, Espaces et temps de la maternité, Les Éditions du Remue-ménage, Montréal, p. 456-477.
DOUGLAS, Kristen (2008). Le divorce — état du droit au Canada, Bulletin d’actualité 96-3F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, révisé le 30 septembre 2008.
Droit-finances.net, (Page consultée le 28 octobre 2013), [en ligne], droit-finances.commentcamarche.net/forum/ affich-4214914-signification-vie-maritale.
DUCHARME, Amélie et Hélène DESROSIERS (2008). « La monoparentalité dans la vie des jeunes enfants québécois : une réalité fréquente, mais souvent transitoire », Portraits et trajectoires, série ÉLDEQ, Québec, ISQ.
DUCHESNE, Louis (2004). « La diffusion des naissances hors mariage, 1950-2003 », p. 21-40 dans La situation démographique au Québec. Bilan 2004, Institut de la statistique du Québec, Québec, 355 pages.
DUVAL, Luce (2000). « Les jeunes couples – fonder une famille dans un contexte de précarité : un pari risqué », p. 64-68 dans Madeleine GAUTHIER et al., Être jeune en l’an 2000, Les Éditions de l’IQRC, St-Nicolas, 154 pages.
ÉDUCALOI. www.educaloi.qc.ca (Page consultée le 12 mars 2014).
ÉGÉA, Vincent (2013). « Statistiques de l’INSEE : « Le couple dans tous ses états » », Droit de la famille n° 4, avril 2013, alerte 19 (Page consultée le 18 novembre 2013). En ligne : http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-famille/04-2013/019_PS_FAM_FAM1304AL00019.htm#.U2svwctOVYY
ELGAN, Elisabeth (2009). « Pouvoir économique en Suède et inégalités des sexes », Caisse nationale des Allocations familiales, vol. 1 - n° 151, p. 84-91.
ELGAN, Elisabeth (2004-2005). « L’égalité des sexes par la seule volonté ? Le succès politique des femmes suédoises », Nordiques, no 6, p. 47-57.
EUROSTATS. (Page consultée le 24 novembre 2013). Naissance vivante hors mariage, [en ligne], http://epp. eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/8/80/Live_births_outside_marriage%2C_selected_years%2C_1960-2011_%28%25_share_of_total_live_births%29-fr.png.
FAVIER, Yann (2002). « Les concubins et leurs droit sociaux », Études offertes à J. Rubellin-Devichi, Des concubinages, droit interne, droit international, droit comparé, Paris, Litec, p. 241.
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC (FAFMRQ) (2009). « Jugement de la Cour supérieure sur les conjoints de fait - Un déni de droits pour les enfants nés hors mariage! » (16 juillet) , communiqué de presse, [en ligne], http://www.fafmrq.org/federation/2009/07/ jugement-de-la-cour-sup%C3%A9rieure-sur-les-conjoints-de-fait-un-d%C3%A9ni-de-droits-pour-les- enfants-n%C3%A9s-hors.html (Page consultée le 18 novembre 2013).
FONGARO, Éric (2013). « Vers un droit patrimonial européen de la famille?», La semaine juridique, notariale et immobilière, no 15 (12 avril), p. 27.
GALARNEAU, Diane et René MORISSETTE (2013). « La situation des jeunes a-t-elle changé au Canada? » Regards sur la société canadienne, Statistique Canada, Ottawa (juillet), 75-006-X au catalogue.
GALARNEAU, Diane et Jim STURROCK (1997). « Revenu familial après séparation », Perspective, Ottawa, Statistique Canada (été).
GLENN, H. Patrick (1990). « Droit comparé et droit québécois », 24 Revue juridique Thémis 342.
GODBOUT, Jacques T. (1990). « L’État, un ami de la famille? », p. 173-185 dans Denise LEMIEUX, Familles d’aujourd’hui, IQRC, Québec, 243 pages.
GOUBAU, Dominique (2003). « La conjugalité en droit privé : comment concilier autonomie” et protection”? », dans Pierre-Claude LAFOND et Brigitte LEFEBVRE, L’union civile – Nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle. Actes du colloque du Groupe de réflexion en droit privé, Cowansville, Blais, p. 153.
GOUBAU, Dominique, Ghislain OTIS et David ROBITAILLE (2003). «La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre choix et ses “dommages collatéraux” », 44 Cahiers de Droit. 3.
GRAINER, Virginia (2002). « What’s Yours Is Mine: Reform of the Property Division Regime for Unmarried Couples in New Zealand », 11 Pac. Rim L. & Pol’y J. 285.
GRANET, F. « Le concubinage », dans Pierre CATALA (sous la dir. de), J.-Cl. Civil code, art. 515-8 [en ligne], (Page consultée le 29 octobre 2013).
GRAVERSEN, Jorgen (1990). « Family Law as a Reflection of Family Ideology », 34 Scandinavian Studies in Law 69.
GROSSWALD CURRAN, Vivian (1998). « Dealing in Difference : Comparative Law’s Potential for Broadening Legal Perspective », 46 Am. J. Comp. L. 657.
Halsbury’s Laws of Canada - Family Law, (Page consultée le 18 novembre 2013). [en ligne] http://www.lexisnexis.com.acces.bibl.ulaval.ca/ca/legal/results/tocBrowseNodeClick.do?rand=0.5770289676134778&tocCSI=342995&clickedNode=source%3BTAAB.
HÉRAUD, J. (2008). « Les couples unis par les liens … de l’impôt : le concubinage en droit fiscal », JCP N, 1326.
HOLLAND, Winifred (2000). « Intimate Relationships in the New Millennium: the Assimilation of Marriage and Cohabitation ? »,17 Can. J. Fam. L. 114.
HOLLAND, Winifred H., et Barbro E. STALBECKER-POUNTNEY (dir.). Cohabitation: the Law in Canada, Carswell, (Feuilles mobiles).
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2013a). Annuaire québécois des statistiques du travail – Portrait des principaux indicateurs du marché et des conditions de travail 2002-2012, vol. 9, Québec, l’Institut, 2e trimestre, 265 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2013b). Coup d’œil sociodémographique, no 28, Québec, l’Institut (juin), 5 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2013c). Panorama des régions du Québec, édition 2013, Québec, l’Institut, 3e trimestre, 189 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2012a). Annuaire québécois des statistiques du travail – Portrait des principaux indicateurs du marché et des conditions de travail 2001-2011 Volume 8, Québec, l’Institut, 2e trimestre, 264 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2012b). Le bilan démographique du Québec, édition 2012 Québec, l’Institut (décembre), 172 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2010). Portrait social du Québec – données et analyses, édition 2010, Québec, l’Institut (décembre), 310 pages.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 10 février 2014). « Familles selon la structure, la présence d’enfants et l’âge des enfants, Québec, 1986-2011 » [en ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/tableau_30.htm.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 28 janvier 2014). Le marché du travail et les parents, Québec, l’Institut (décembre) (59 pages). [en ligne], http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB-01680FR_marche_travail_parents2009H00F00.pdf.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 15 janvier 2014). « Mariages et unions civiles selon le sexe des conjoints, Québec, 2002-2012 ». [en ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/mariages-divorces/501b.htm.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 28 janvier 2014). « Moyenne quotidienne de temps consacré aux activités principales de l’emploi du temps par la population en emploi à temps plein et vivant avec au moins un enfant âgé de 4 ans ou moins dans le ménage, selon le sexe, Québec, 1992, 1998, 2005 et 2010 » [en ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/conciliation-travail/tab_pop_temps_plein_4.htm.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 15 janvier 2014). « Naissances selon l’état matrimonial des parents, Québec, 1951-2012 ». http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/ naissance-fecondite/410.htm.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (Page consultée le 15 janvier 2014). « Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2011 » [en ligne], http://www. stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/familles-menages/202_2011.htm.
JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit (2002). University of Uppsala (October), Grounds For Divorce And Maintenance Between Former Spouses, Sweden, Commission on European Family Law, Divorce / Maintenance, Reports by Jurisdiction, [en ligne], http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Sweden-Divorce.pdf (Page consultée le 25 novembre 2013).
JÄNTERÄ-JAREBORG, Maarit. Margareta BRATTSTRÖM et Kajsa WALLENG (2008). Uppsala University (October), Property relationship between spouses – Sweden, Commission on European Family Law, [en ligne], http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Sweden-Property.pdf (Page consultée le 25 novembre 2013).
JARRY, Jocelyne (2008). Les conjoints de fait au Québec: vers un encadrement légal, Cowansville, Blais, 256 pages.
JP Boyd on Family Law, Click Law Wikibook, [en ligne]: http://wiki.clicklaw.bc.ca/index.php/JP_Boyd_on_Family_Law (Page consultée le 9 janvier 2014).
LAFOND, Pierre-Claude et Brigitte LEFEBVRE (2003). L’union civile – Nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle. Actes du colloque du Groupe de réflexion en droit privé, Cowansville, Yvon Blais, 399 pages.
LANGEVIN, Louise (2009a). « Liberté contractuelle et relations conjugales font-elles bon ménage? », Nouvelles questions féministes, vol. 28, n° 2, p. 24-35.
LANGEVIN, Louise (2009b). « Liberté de choix et protection juridique des conjoints en cas de rupture : difficile exercice de jonglerie », 54 Revue de droit de McGill 697.
LANGEVIN, Louise (Page consultée le 16 janvier 2014). « Protection juridique des conjointes de fait – Au-delà des 50 millions $, il y a les autres femmes», 29 janvier 2009, [en ligne], http://sisyphe.org/spip.php?article3197.
LAPIERRE-ADAMCYK, Evelyne et Céline LE BOURDAIS (2004). « Couples et familles : une réalité sociologique et démographique en constante évolution », Actes de la XVIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville, Québec, Blais, p. 61-86.
LAPORTE, Christine, et Grant SCHELLENBERG (2011). La gestion du revenu chez les couples au Canada: la situation des 45 ans et plus, Statistique Canada, No 11F0019M au catalogue, Ottawa, 28 pages.
LEMIEUX, Denise (1990). « Enfants et familles du passé : une histoire entre mythes et réalités », p. 55-71 dans Denise LEMIEUX, Familles d’aujourd’hui, IQRC, Québec, 243 pages.
LEMOULAND, J.-J. (2007). « Vers un droit commun de la formation des couples ? », Petites affiches, 20 décembre 2007, n° 254, p. 1.
LEMOULAND, J.-J. (1999). « Présentation de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité », D., chr. P. 483.
MARSHALL, Katherine (2012). « Travail rémunéré et non rémunéré sur une période de trois générations », L’emploi et le revenu en perspective, Statistique Canada, Ottawa, (printemps).
MATUTANO, Edwin (2011). « Les normes du couple, un droit positif fragmenté pour un concept socialement uniforme », 3 Revue de la recherche juridique. Droit prospectif 1299.
MAYRAND, Albert (1985). « Égalité dans le droit familial québécois », 19 Revue juridique Thémis 249.
MILES, Joanna (2004). « Financial Provision and Property Division on Relationship Breakdown: A Theoretical Analysis of the New Zealand Legislation », 21 New Zealand University Law Review 268.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Page consultée le 12 mars 2014) http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union-civ.htm#definitions.
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE (2010). Rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance sociale (décembre), [en ligne], http://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/archives.asp (Page consultée le 12 décembre 2013).
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (2013). Regard statistique sur les jeunes enfants au Québec, non publié.
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (2011). Un portrait statistique des familles au Québec 2011, Québec, 635 pages.
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE (2014). Statistiques fiscales des particuliers – année d’imposition 2011, Québec, 281 pages.
MINISTRY OF JUSTICE, SWEDEN (Page consultée le 17 novembre 2013). Cohabitees and their joint homes - a brief presentation of the Cohabitees Act, 29 janvier 2013, [en ligne], http://www.government.se/content/1/c6/20/80/65/b26d0ece.pdf.
MINISTRY OF JUSTICE, SWEDEN (Page consultée le 18 novembre 2013). Family Law, Information Material, 26 August 2013, [en ligne], http://www.government.se/sb/d/12680/a/138344.
MOLIÈRE, Aurélien (2013). « Union libre, partenariat, mariage : stratégies patrimoniales - Le choix du régime », Droit de la famille, n° 7 (juillet), dossier 20.
MOORE, Benoît (2013). « Passé et avenir de l’union de fait : entre volonté et solidarité », Actes de la XXe conférence des juristes de l’État (9 et 10 avril), [en ligne] http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-conferences/pdf/2013/Benoit_Moore.pdf (Page consultée le 15 novembre 2013).
MOORE, Benoît (2012). « Auprès de ma blonde », p. 359-380 dans Brigitte LEFEBVRE et Antoine LEDUC (dir.),Mélanges Pierre Ciotola, Montréal, Thémis, 587 pages.
MOORE, Benoît (2010). « Variations chromatiques : l’union de fait entre noir et blanc », dans Benoît MOORE et Générosa BRAS MIRANDA (dir.), Mélanges Adrian Popovici, Montréal, Thémis, p. 97-124.
MOREL, Nathalie (2001). « Politique sociale et égalité entre les sexes en Suède », Recherches et prévisions, n° 64, p. 65-79.
MOREUX, Colette (1982). Douceville en Québec. La modernisation d’une tradition, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 453 pages.
PACAUT, Philippe (2013). « Les mariages au Québec en 2012 : les cérémonies religieuses représentent tout juste un mariage sur deux », Coup d’œil sociodémographique, no 28, Institut de la statistique du Québec, Québec (juin), 5 pages.
PAYNE, Julian D. et Marilyn A. PAYNE (2011). Canadian Family Law, 4e éd., Toronto, Irwin Law.
PEART, Nicola (2008-2009). « The Property (Relationships) Amendment Act 2001 : A Conceptual Change », 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 813.
PERROTIN, Frédérique (2010). « Nouvelles conjugalités et fiscalité », Petites affiches (21 mai), n° 101, p. 8.
PFERSMANN, Otto (2001). « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », 53 Revue internationale de droit comparé 275.
REID, Hubert (1996). Dictionnaire de droit québécois et canadien, Montréal, Wilson et Lafleur.
Review Panel on Common Law Relationships, Opinion on Common-law Relationship of Jennifer A. Cooper, Q.C., (2001). Final Report, Manitoba (31 déc.).
RÉVILLARD, Anne (2011). « Protection humiliante ou source de droits? Prestation compensatoire, pensions alimentaires et luttes féministes », Jurisprudence, Revue critique 217.
RÉVILLARD, Anne (2009). « Le droit de la famille : Outil d’une justice de genre? », L’année sociologique, vol. 59, n°2, p. 345-370.
RICARD-CHÂTELAIN, Baptiste (2013). « Les pères en mutation », Le Soleil, Québec, le 9 novembre, p. 2-3.
RIVIER, Marie-Claire (2002). « Les solidarités entre concubins », Études offertes à J. Rubellin-Devichi, Des concubinages, droit interne, droit international, droit comparé, Paris, Litec, p. 97.
ROY, Alain (2013a). « L’évolution de la politique législative de l’union de fait au Québec », XXe Conférence des juristes de l’État, Québec (9 et 10 avril), p. 81-154. (Page consultée le 15 novembre 2013) [en ligne] http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/0a/26/alain-roy.pdf.
ROY, Alain (2013b). « Affaire Éric c. Lola : une fin aux allures de commencement », XXe Conférence des juristes de l’État, Québec (9 et 10 avril), p. 259-308. (Page consultée le 15 novembre 2013) [en ligne] http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/5a/c8/alain-roy-fin.pdf.
ROY, Alain (2002). Le contrat de mariage réinventé: Perspectives socio-juridiques pour une réforme, Montréal, Thémis.
ROY, Alain (2012). « L’évolution de la politique législative de l’union de fait au Québec – Analyse de l’approche autonomiste du législateur québécois sous l’éclairage du droit comparé », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, p. 235.
RYZNAR, M. et A. STEPIEN-SPOREK (2013). « Tale of Two Federal Systems », 21 Cardozo Journal of International and Comparative Law 589.
SAGAUT, Jean-François (2010). « Couples au XXIe siècle : le nécessaire état des lieux de la conjugalité », Petites affiches (21 mai), n°101, p. 11.
SCHERPE, Jens M. (2007). « The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law», 50 Scandinavian Studies in Law 265.
SEERY, Annabelle (2012). Travail de reproduction sociale, travail rémunéré et mouvement des femmes: constats, perceptions et propositions des jeunes féministes québécoises, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, UQÀM (novembre).
SENÉCAL, Paul (2012). Les femmes et le logement: un pas de plus vers l’égalité, Québec, Société d’habitation du Québec, pagination multiple. [en ligne], http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/ publications/0000021513.pdf (Page consultée le 10 mars 2014).
SÉRIAUX, Alain (2002). « De l’opportunité d’un statut des concubins », dans Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, Paris, LGDJ, p. 39.
SÖRGJERD, Caroline (2012). Reconstructing Marriage, The Legal Status of Relationships in a Changing Society, Cambridge, Intersentia.
STATISTIQUE CANADA (Page consultée le 12 mars 2014). Dictionnaire du recensement 2011, [en ligne], http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/98-301-X2011001-fra.pdf
STATISTIQUE CANADA. « Gains moyens des femmes et des hommes, et ratio des gains des femmes par rapport à ceux des hommes, selon le régime du travail, dollars constants de 2011 », tableau 202-0102.
STATISTICS NEW ZEALAND (Page consultée le 9 janvier 2014), [en ligne], http://www.stats.govt.nz/browse_for_ stats/people_and_communities/marriages-civil-unions-and-divorces/MarriagesCivilUnionsandDivorces_HOTPYeDec12.aspx.
SURPRENANT, Marie-Ève (2009). Jeunes couples en quête d’égalité, Sisyphe, Montréal, 123 pages.
SUSSMAN, Deborah et Stephanie BONNELL (2006). « Ces femmes qui sont le principal soutien de famille », p. 10-18 dans L’emploi et le revenu en perspective, vol. 7, no 8, Statistique Canada, Ottawa (août), 75-001-X au catalogue. [en ligne], http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10806/9291-fra.pdf (Page consultée le 28 janvier 2014).
TERRÉ, François et Dominique FENOUILLET (2011). Droit civil : la famille, 8e éd., Paris, Dalloz.
The Family Law Act Explained (Page consultée le 9 janvier 2014), [en ligne sur le site du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique], http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/family-law/acts-explained.htm.
THERRIEN, Rita et Louise COULOMBE-JOLY (1984). Rapport de l’AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Boréal Express, Montréal, 214 pages.
TREMBLAY, Diane-Gabrielle (2012). Conciliation emploi-famille et temps sociaux, Presses de l’Université du Québec, Québec, 409 pages.
TURCOTTE, Martin (2013). « Vivre en couple chacun chez soi» Regards sur la société canadienne, Statistique Canada, Ottawa (mars). 75-006-X au catalogue.
Unions et désunions: évolutions au cours de la décennie, Rapport du Haut conseil de la famille, note 10 oct. 2012, Répertoire du Notariat Defrénois, 15 novembre 2012, n° 21, p. 1098 (en version électronique dans la base de données Lextenso).
VAUVILLÉ, Frédéric (2009). « L’acquisition et la construction d’un immeuble par un couple de « cohabitants » aujourd’hui », Defrénois (15 décembre), n° 21, p. 2249.
Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012, Statistics Sweden, 2012. [En ligne], http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201ENG.pdf (Page consultée le 25 novembre 2013).
Table de la législation citée
LÉGISLATION CANADIENNE
Loi constitutionnelle canadienne
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)].
Législations fédérales
Loi sur le divorce, S.R. 1970, C. D-8.
Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl).
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23
Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, c. 12
Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33
Législations provinciales
Code civil du Bas-Canada
Code civil du Québec
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12
Loi sur les impôts du Québec, L.R.Q., c.I-3
Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., c. A-29
La loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., c A-13.1.1.
Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55
Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16
Family Law Act, S.A. 2003, c. F-4.5
Matrimonial Property Act, R.S.A. 2000, C. M-8
Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128
Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25
Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-2.1
Loi sur l’obligation alimentaire, L.R.M. 1987, ch. F20
Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. c. F25
Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2
Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.-B. 2012, c. 107
Maintenance and Custody Act, R.S.N.S. 1989, ch. 160
Vital Statistics Act, R.SN.S. 1989, c. 494
Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3
Loi de 1997 sur les prestations alimentaires familiales, LS 1997, c F-6.2
Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F-6.3
Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-2
Loi sur le droit de la famille, L.T.N.-O. 1997, ch. 18
Matrimonial Property Act, R.S.N.S., c. 275
Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 2002, c. 88
Family Law Act (Nu,) 1997 c. 18
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, LRQ, c A-3.001
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Lois françaises
Code civil français
Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
Lois suédoises
Marriage Code, NJA II 1921 (Giftermålsbalken)
Act on the Joint Dwelling of an Unmarried Couple, Lag (1973 : 651) (Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma)
Gender-neutral Marriage and Marriage Ceremonies Act., 2009 Registered Partnership Act (1994:1117)
Cohabitees Act, (2003 : 376) Cohabitees Joint Home Act de 1987 (Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem)
Homosexual Cohabitees Act de 1987 (Lag (1987:813) om homosexuella sambor)
Code du mariage de 1987 (Äktenskapsbalke)
Lois néo-zélandaises
Property (Relationships) Amendment Act, 2001(N.Z.)
Matrimonial Property Act, 1976 (N.Z.)
Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.)
Property (Relationships) Amendment Act, 2005 (N.Z.)
Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act, 2013 (N.Z.)
Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.)
Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act, 2013 (N.Z.)
Property Law Act, 1952 (N.Z.)
Schedule to the Property (Relationships) Model Form of Agreement Regulations 2001 (SR 2001/177)
Table de la jurisprudence citée
Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5.
Asselin v. Roy, 2013 BCSC 1681 (CanLII)
Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83
Moge c. Moge, 1992 CanLII 25 (CSC)
M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539 (C.A.)
Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 18
M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3
Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10
- Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5.
- Selon le Recensement de 2006, chez les femmes de 25-29 ans, 31 % des diplômées de l’université sont mariées, comme 32 % des non-diplômées. Dans le groupe des 45-49 ans, la proportion des femmes mariées atteint 65 % chez les titulaires d’un diplôme universitaire et 61 % chez les non-diplômées. Si les diplômées se marient autant que les non-diplômées, elles ont moins tendance qu’elles à vivre en union de fait. Elles sont aussi plus nombreuses à vivre seules.
- Nous pensons ici à l’investissement en temps de travail et en revenus sacrifiés. Nous verrons au premier chapitre du présent avis que lorsqu’elles deviennent mères, les femmes réduisent leur activité sur le marché du travail, contrairement aux pères qui ont plutôt tendance à augmenter la leur. Du fait de ces comportements différenciés, les conjoints ne sont pas égaux au sein du couple, en matière d’autonomie financière.
- Bien qu’il désapprouve le surnom sexiste donné par les médias à la principale mise en cause dans cette affaire, le Conseil opte pour l’utilisation de l’intitulé Éric c. Lola, plus évocateur pour le grand public, ce qui facilite la lecture de cet avis.
- À Terre-Neuve et au Québec, deux provinces dépourvues d’une loi provinciale en la matière, ceux qui voulaient mettre un terme à leur union devaient faire adopter une loi privée par le Parlement fédéral. Dans la plupart des autres provinces et territoires, la loi provinciale incorporait par renvoi le Matrimonial Causes Act britannique de 1857, qui permettait à un homme d’obtenir un divorce si son épouse avait commis l’adultère. La femme, elle, n’obtenait le divorce que si elle pouvait prouver que son mari s’était rendu coupable d’adultère incestueux, de viol, de sodomie, de bestialité, de bigamie ou d’adultère conjugué à la cruauté ou à l’abandon du domicile conjugal. Les épouses dont il était prouvé qu’elles étaient adultères n’avaient pas droit à une pension alimentaire et les époux ne pouvaient en aucune circonstance demander une pension alimentaire. Certaines provinces ont adopté une loi autorisant l’un ou l’autre des époux à demander le divorce pour adultère. Les lois provinciales sur le divorce sont demeurées en vigueur jusqu’à ce que le Parlement adopte la Loi sur le divorce en 1968 » (Douglas, 2008 : 2).
- Les plus importantes étaient l’adultère, la cruauté et l’abandon du foyer conjugal.
- En 2011, 26,1 % des femmes en emploi travaillent à temps partiel comparativement à 12,9 % des hommes.
- Les conjointes de fait peuvent aussi demander une pension et la recevoir dans certains cas.
- Selon Ressources humaines et développement des compétences Canada, le seuil de référence de la MPC repose sur une mesure du coût des biens et des services devant composer un « panier de consommation » jugé essentiel pour qu’une unité familiale de référence, composée de deux parents (âgés de 25 à 49 ans) et de deux enfants (un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans), comble ses besoins de subsistance et d’intégration sociale. Ce panier est composé d’articles se rapportant à la nourriture, aux vêtements et chaussures, au logement, au transport et à d’autres biens et services, y compris les soins personnels, les besoins ménagers, l’ameublement, le service téléphonique de base, certains loisirs et divertissements, etc. Il est supposé que la totalité des dépenses pour se procurer les articles de ce panier est réalisée par l’unité familiale.
- En 1970, 70 % des couples sont mariés en séparation de biens. Voir Alain ROY (2002), Le contrat de mariage réinventé: Perspectives socio-juridiques pour une réforme, Montréal, Thémis.
- Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55.
« Ce droit de créance donne ouverture à un partage, en parties égales, de la valeur nette de certains biens tels les résidences de la famille, les meubles affectés à l’usage du ménage, les véhicules utilisés par ce dernier, ainsi que les droits au titre de régimes de retraite, et ce, sans égard à l’identité de celui des deux époux qui détient un droit de propriété sur ces biens. »
Opinion du juge LeBel, Québec (Procureur général) c. A, ou « Éric c. Lola », précité, paragr. 72. - Donations consenties par les conjoints de leur vivant.
- L’action en enrichissement injustifié vise à dédommager le conjoint qui s’est appauvri au profit de l’autre pendant l’union. Mais un tel
recours est appliqué avec parcimonie et sert
« uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir »
( Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5, paragr. 117, citant le juge Dalphond dans l’arrêt M.B. c. L.L., [2003] R.D.F. 539 (C.A , paragr. 39)) - Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, opinion du juge LeBel, paragr. 280; opinion de la juge Abella, paragr. 370 et 371.
- Vivian GROSSWALD CURRAN (1998), « Dealing in Difference : Comparative Law’s Potential for Broadening Legal Perspective », 46 Am. J. Comp. L. 657.
- Comme l’affirme Otto PFERSMANN (2001),
« il est moralement irresponsable de ne pas étudier les structures juridiques possibles »
, voir « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », 53 R.I.D.C. 275, p. 288. - Patrick GLENN (1990), « Droit comparé et droit québécois », 24 R.J.T. 342.
- Voir infra.
- Voir, entre autres, Jens M. SCHERPE (2007), « The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law», 50 Scandinavian Studies in Law 265.
- La juge Abella mentionne ce régime dans Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5., paragr. 360 et 370.
« Au sens large, système juridique en vigueur dans de nombreux pays et qui est fondé essentiellement sur la common law d’Angleterre, par opposition aux autres systèmes juridiques qui tirent leur origine du droit romain»
, Hubert REID (1996), Dictionnaire de droit québécois et canadien, Montréal, Wilson et Lafleur, vs common law.- Pour des réflexions plus poussées sur l’évolution du droit de la conjugalité au Canada, voir entre autres COMMISSION DU DROIT DU CANADA (2001), Au-delà de la conjugalité. La reconnaissance et le soutien des rapports de nature personnelle entre adultes, Ottawa; Winifred HOLLAND (2000), « Intimate Relationships in the New Millennium: the Assimilation of Marriage and Cohabitation ? », 17 Can. J. Fam. L. 114; Nicholas BALA (2003) « Controversy over Couples in Canada : The Evolution of Marriage and Other Adult Interdependent Relationships », 29 Queen’s L.J. 41.
- Nous utilisons ici l’expression « patrimoine familial » pour désigner l’ensemble des biens qui peuvent être partagés entre les ex-conjoints à la fin de l’union conjugale. Certaines lois canadiennes utilisent l’expression « biens familiaux » (en Ontario, Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 4 (1)), « élément d’actif familial » (au Manitoba, Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. c. F25, art.1) ou « biens matrimoniaux » (au Nouveau-Brunswick, Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.-B. 2012, c. 10, art. 1).
- Alberta : Family Law Act, S.A. 2003, c. F-4.5; Colombie-Britannique : Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128; Île-du-Prince-Édouard : Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-2.1; Manitoba : Loi sur l’obligation alimentaire, L.R.M. 1987, ch. F20 ; Nouveau-Brunswick : Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2; Nouvelle-Écosse: Maintenance and Custody Act, R.S.N.S. 1989, ch. 160; Ontario : Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3; Saskatchewan : Loi de 1997 sur les prestations alimentaires familiales, LS 1997, c F-6.2; Terre-Neuve-et-Labrador : Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-2; Territoires du Nord-Ouest : Loi sur le droit de la famille, L.T.N.-O. 1997, ch. 18.
- Voir Winifred H. HOLLAND et Barbro E. STALBECKER-POUNTNEY (dir.), Cohabitation: the Law in Canada, Carswell, (Feuilles mobiles); Halsbury’s Laws of Canada – Family Law, accessible en ligne par Quick Law LexisNexis; Renee R. COCHARD (2012), « Unmarried Cohabitants : Property Rights : A Gendered Analysis » (nov.) (inédit); Jocelyne JARRY (2008), Les conjoints de fait au Québec: vers un encadrement légal, Cowansville, Blais; Julian D. PAYNE et Marilyn A. PAYNE (2011), Canadian Family Law, 4e éd., Toronto, Irwin Law; Alain ROY (2012), « L’évolution de la politique législative de l’union de fait au Québec – Analyse de l’approche autonomiste du législateur québécois sous l’éclairage du droit comparé », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, p. 235.
- Par ailleurs, à la suite des décisions Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 18, et M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, les conjoints de fait et mariés ont droit aux mêmes bénéfices et avantages en vertu des lois à caractère social et fiscal. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont adopté des lois pour harmoniser les droits et obligations des couples de même sexe et de sexe différent. Voir, par exemple, la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, c. 12.
- Les lois portant sur le partage du patrimoine familial utilisent diverses expressions pour désigner ce contrat : contrat de mariage, accord de séparation, accord de cohabitation, contrat de cohabitation, contrat domestique, entente prénuptiale, contrat familial.
- Matrimonial Property Act, R.S.A. 2000, c. M-8. En vertu du Family Law Act, S.A. 2003 c. F-4.5, art. 39, il y a possibilité d’obtenir l’usage de la résidence familiale.
- Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 53. Voir Julian D. PAYNE et Marilyn A. PAYNE, précité., chap. 3 et chap. 12.
- Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.-B. 2012, c. 107, art. 35.
- Family Law Act, R.S.N.L. 1990, c. F-2., art. 63.
- Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1, art. 4.
- Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 2002, c. 88. art. 60.
- Voir par exemple l’art. 56 (4) Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3.
- Voir par exemple l’art. 56 (4) Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3.
- Family Law Act (Nu) 1997 c. 18, art. 10.
- Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, c. F-6.3, art. 24 (1).
- Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes, L.M. 2002, ch. 48. (entrée en vigueur le 30 juin 2004). Loi sur les biens familiaux, CPLM c. F25, art. 5. Review Panel on Common law Relationships, Opinion on Common-law Relationship of Jennifer, A. Cooper, Q.C., Final Report, Manitoba, 31 déc. 2001. Voir Colette CHELACK et Joan MACPHAIL (2005), « Sharing a Life : Manitoba Legislation Respecting Rights and Obligations of Common-Law Partners », 31 Man. L.J. 111.
- Family Law Act, SBC 2011, c. 25 (entré en vigueur en mars 2013).
- Nous remercions Me John Paul Boyd pour cette précision. Voir son blogue : http://bcfamilylawresource.blogspot.ca (consulté le 9 janvier 2014).
- Vital Statistics Act, RSNS 1989, c. 494. Une fois que le couple s’est enregistré, le Matrimonial Property Act, R.S.N.S., c. 275, s’applique aux conjoints comme s’ils étaient mariés (art. 54 (2)). Comme les conjoints mariés, ils peuvent aménager les modalités du partage de leur patrimoine familial dans un contrat.
- Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 84, la Cour suprême a décidé qu’un traitement législatif différent entre conjoints mariés et non mariés prévu par le Matrimonial Property Act, R.S.N.S., c. 275, n’était pas discriminatoire selon l’article 15 (1) de la Charte canadienne.
- Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10.
- La Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse travaille à une révision du droit dans ce domaine. Voir son Annual Report 2012-2013.
- BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL (2010), White Paper on Family Relations Act Reform: Proposals for a New Family Act, chap. 2 and 9 (July).
- Susan BOYD, entretien téléphonique, janvier 2014.
- Cette constatation ressort des mémoires présentés par des groupes de femmes de la Colombie-Britannique en réponse au livre blanc sur le droit de la famille en 2010, dont le Conseil a obtenu copie.
- Pour une analyse de la loi, voir The Family Law Act Explained, en ligne sur le site du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique : http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/family-law/acts-explained.htm (Page consultée le 9 janvier 2014); JP Boyd on Family Law, Click Law Wikibook, en ligne : http://wiki.clicklaw.bc.ca/index.php/JP_Boyd_on_Family_Law (Page consultée le 9 janvier 2014).
- Dans le cas d’une union de fait de moins de deux ans avec enfant, les conjoints ne sont pas soumis au partage du patrimoine.
- Voir art. 38 de la Loi sur les biens familiaux, LS 1997, c F-6.3 de la Saskatchewan, qui exige un avis juridique indépendant pour bien informer les conjoints qui désirent se soustraire au partage du patrimoine familial.
- Asselin v. Roy, 2013 BCSC 1681 (CanLII).
- Susan BOYD (2010), Feedback on White Paper on Family Law, Faculty of Law, University of British Columbia, Vancouver, B.C., p. 6 (copie obtenue de l’auteure).
- En février 2013, 73,1 % des couples sont mariés, contre 22,6 % pour le concubinage et 4,3 % pour le PACS. Vincent ÉGÉA (2013), « Statistiques de l’INSEE : “Le couple dans tous ses états” », Droit de la famille, n° 4 (avril), alerte 19; Unions et désunions: évolutions au cours de la décennie, Rapport du Haut conseil de la famille, note 10 oct. 2012, Répertoire du Notariat Defrénois, 15 novembre 2012, n° 21, p. 1098.
- Des universitaires européens ont aussi entrepris un projet d’harmonisation du droit de la famille, voir les principes de droit européen de la famille de la Commission de droit européen de la famille, en ligne. Voir aussi les rapports des différents pays européens, en ligne sur le même site.
- Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
- Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Le PACS a été modifié par la loi du 23 juin 2006 qui a prévu, entre autres, un régime légal de séparation de biens. Art 515-5 C.c.
- Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Il ne faut pas voir dans cette définition une volonté du législateur français d’encadrer le concubinage dans le Code civil. Il s’agit de l’article unique sur le concubinage dans le Code civil. La définition a été proposée par le Sénat, qui était hostile au PACS, afin d’ouvrir le concubinage à tous les couples. Sur l’historique de cet article, voir J.-J. LEMOULAND, « Présentation de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité », D. 1999, chr. P. 483. Rachel BLOUGH (2009), « Le concubinage, dix ans après », Dr. fam. Études 19, p. 2.
- Même si du point de vue juridique le concubinage est considéré comme une « situation de fait », une situation en marge du droit, il est quand même pris en compte par le droit. D’ailleurs, tous les traités et ouvrages portant sur le droit de la famille abordent la question du concubinage. Sur la question de l’encadrement juridique du concubinage en France, voir Alain BÉNABENT (2012), Droit de la famille, Paris, Montchrestien, p. 323 et suiv.; François TERRÉ et Dominique FENOUILLET (2011), Droit civil : la famille, 8e éd., Paris, Dalloz, p. 313 et suiv. ; Dalloz Répertoire de droit civil, « concubinage » ; Dalloz action Droit de la Famille, titre 14, « Le concubinage » ; F. GRANET, « Le concubinage », dans Pierre CATALA (sous la dir. de), J.-Cl. Civil code, art. 515-8; R. BLOUGH, « Le concubinage, dix ans après », op. cit.
- Ismérie DEL VALLE-LÉZIER (2005), « Solidarité dans les couples, Les aspects civils », Revue française des affaires sociales, vol. 4, n° 4, p. 81-100; Marie-Claire RIVIER (2002), « Les solidarités entre concubins », Études offertes à J. Rubellin-Devichi, Des concubinages, droit interne, droit international, droit comparé, Paris, Litec, p. 97.
- Art. 515-3 C.c. depuis le 1er janvier 2007. Voir Dalloz action, Droit de la Famille, titre 15, « Le pacte civil de solidarité ».
- Frédéric VAUVILLÉ (2009), « L’acquisition et la construction d’un immeuble par un couple de “cohabitants” aujourd’hui », Defrénois (15 décembre), n° 21, p. 2249.
- Maryse BADEL, Anne-Marie GILLES, Jean-Pierre LABORDE, Valérie LACOSTE, et Monique SUBRENAT (2003), « Référence au lien familial et accès aux droits sociaux », Recherches et Prévisions, Dossier Famille et droit social, n° 73 (septembre), p. 25 ; Yann FAVIER (2002), « Les concubins et leurs droit sociaux », Études offertes à J. Rubellin-Devichi, Des concubinages, droit interne, droit international, droit comparé, Paris, Litec, p 241; Edwin MATUTANO (2011), « Les normes du couple, un droit positif fragmenté pour un concept socialement uniforme », 3 Revue de la recherche juridique. Droit prospectif 1299.
- Le statut fiscal du PACS a pratiquement été intégralement aligné sur celui du mariage, sauf quelques exceptions. Élise AMAR, et Sophie GUÉRIN (2007), « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Économie et statistique, n° 401, p. 23; J. HÉRAUD (2008), « Les couples unis par les liens… de l’impôt : le concubinage en droit fiscal », JCP N, 1326; E. MATUTANO, « Les normes du couple, un droit positif fragmenté pour un concept socialement uniforme », op. cit.; Frédérique PERROTIN (2010), « Nouvelles conjugalités et fiscalité », Petites affiches (21 mai), n° 101, p. 8.
- Supra note 57.
- F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Droit civil : la famille, op. cit, p. 57; J.-J. LEMOULAND (2007), « Vers un droit commun de la formation des couples ? », Petites affiches (20 décembre), n° 254, p. 1; A. ROY (2012), « L’évolution de la politique législative de l’union de fait au Québec - Analyse de l’approche autonomiste du législateur québécois sous l’éclairage du droit comparé », op. cit., p. 33. Contra : Clotilde BRUNETTI-PONS (2002), « Couple, concubinage et PACS, De l’émergence d’une hiérarchie des couples ? », dans Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, Paris, LGDJ, p. 37.
- E. MATUTANO, « Les normes du couple, un droit positif fragmenté pour un concept socialement uniforme », op. cit.
- R. BLOUGH résume bien le débat : « Le concubinage, dix ans après », op. cit. ; Jean-François SAGAUT (2010), « Couples au XXIe siècle : le nécessaire état des lieux de la conjugalité », Petites affiches (21 mai), n° 101, p. 11.
- Alain SÉRIAUX (2002), « De l’opportunité d’un statut des concubins », dans Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, Paris, LGDJ, p. 39 ; Aurélien MOLIÈRE (2013), « Union libre, partenariat, mariage : stratégies patrimoniales - Le choix du régime », Droit de la famille n° 7 (juillet), dossier 20.
- Dans les années 1990, certains auteurs se sont penchés sur un statut juridique pour les concubins. Voir les références citées par F. GRANET, « Le concubinage », dans Pierre CATALA (sous la dir. de), J.-Cl. Civil code, art. 515-8, paragr. n° 2; Clothilde BRUNETTIPONS (1999), « L’émergence d’une notion de couple en droit civil »,Rev. Trim. Dr. civ. 27.
- J.-J. LEMOULAND, « Présentation de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité », op. cit. ; Rachel BLOUGH, « Le concubinage, dix ans après », op. cit.
- Anne RÉVILLARD (2011) analyse l’autonomisation ou la dépendance pour les femmes qui découle des mesures de redistribution des ressources à la suite d’un divorce. « Protection humiliante ou source de droits ? Prestation compensatoire, pensions alimentaires et luttes féministes », Jurisprudence, Revue critique 217.
- Anne RÉVILLARD (2009), « Le droit de la famille : Outil d’une justice de genre? », L’année sociologique, vol. 59, (2), 345, p. 365.
- Marriage Code, NJA II 1921 (Giftermålsbalken). Voir Caroline SÖRGJERD (2012), Reconstructing Marriage, The Legal Status of Relationships in a Changing Society, Cambridge, Intersentia, p. 60 et suiv).
- Voir C. SÖRGJERD (2012), Reconstructing Marriage, ibid., p. 97, 116, 139; Jorgen GRAVERSEN (1990), « Family Law as a Reflection of Family Ideology », 34 Scandinavian Studies in Law 69.
- Act on the Joint Dwelling of an Unmarried Couple, Lag (1973, p. 651) (Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma). Cette loi avait des effets plutôt limités, car elle ne prévoyait que le transfert du bail résidentiel en faveur de l’ex-conjoint dans le besoin, par exemple celui qui a la garde des enfants, ou le transfert du droit de propriété dans un appartement en copropriété en payant la juste part à l’autre conjoint. La loi ne visait pas le transfert de la propriété de la résidence familiale. Voir, de façon générale, C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., p. 135 et suiv. Pour une analyse historique, voir Anders AGELL (1980), « The Swedish Legislation on Marriage and Cohabitation - A Journey without a Destination », 24 Scandinavian Stud. L. 9.
- Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012, Statistics Sweden, 2012; C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., p. 149 et 159.
- Selon des données de 2011, 29 % des couples en Suède vivent en union de fait. Voir Guillaume BOURGAULT-CÔTÉ (2013), « Recensement - Le Québec fait famille à part, La province se distingue sur tous les plans par rapport au Canada », Le Devoir, 12 septembre. En 2011, 54, 2 % des enfants naissent hors mariage en Suède. Voir EUROSTATS, Naissance vivante hors mariage.
- Voir l’influence de l’État-providence suédois sur les valeurs sous-jacentes au mariage, C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., chap. 4.2.1, p. 92 et suiv.
- Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012, op. cit., C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., p. 149 et 159.
- Voir, entre autres, Elisabeth ELGAN (2009), « Pouvoir économique en Suède et inégalités des sexes », Caisse nationale des Allocations familiales, vol. 1 - n° 151, p. 84-91; Elisabeth ELGAN (2004-2005), « L’égalité des sexes par la seule volonté ? Le succès politique des femmes suédoises », Nordiques, no 6, p. 47-57; Annika AKERBLOM (2004-2005), « La parité hommes-femmes en Suède : une rétrospective », Nordiques, no 6, p. 77-100; Sara BRACHET (2007), « Les résistances des hommes à la double émancipation. Pratiques autour du congé parental en Suède », Sociétés contemporaines, vol. 01, n° 65, p. 175-197; Sara BRACHET (2004), « L’égalité : une vaine quête ? Hommes, femmes et congé parental en Suède », Terrain, Revue de l’ethnologie de l’Europe, 42; Nathalie MOREL (2001), « Politique sociale et égalité entre les sexes en Suède », Recherches et prévisions, n° 64, p. 65-79.
- Voir Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012, op. cit.
- À partir de 2009, les partenariats enregistrés pour conjoints de même sexe ne sont plus possibles, puisque le mariage religieux et civil a été reconnu pour les couples de même sexe et de sexe différent par le Gender-neutral Marriage and Marriage Ceremonies Act. Le Registered Partnership Act (1994, p. 1117), qui permettait les partenariats enregistrés pour les conjoints de même sexe et les traitait de la même façon que les conjoints mariés, a été abrogé. Les partenariats enregistrés avant 2009 sont encore valides et peuvent être transformés en mariage. D’une certaine façon, la loi de 2009 a revalorisé l’institution du mariage.
- Cohabitees Act, (2003, p. 376) entré en vigueur le 1er juillet 2003.
- Les deux lois suivantes ont été fondues en une seule. Le Cohabitees Joint Home Act de 1987 (Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem) était la première loi de ce genre dans le monde; elle reconnaissait un partage très limité du patrimoine familial pour les conjoints de fait. Le Homosexual Cohabitees Act de 1987 (Lag (1987:813) om homosexuella sambor) reconnaissait un partage très limité du patrimoine familial pour les conjoints de même sexe. La Suède était ainsi le premier pays au monde à reconnaître les unions de même sexe dans son droit de la famille. La nouvelle loi de 2003 reprend en majorité les dispositions du Cohabitees Joint Home Act de 1987.
- Ceci exclut d’autres sortes de relations comme des frères et sœurs vivant ensemble ou des parents âgés et leurs enfants vivant ensemble. Le bail de la résidence familiale de ce genre de relation est protégé par la loi.
- C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit. ; MINISTRY OF JUSTICE, SWEDEN, Cohabitees and their joint homes - a brief presentation of the Cohabitees Act, 29 janvier 2013. MINISTRY OF JUSTICE, SWEDEN, Family Law, Information Material, 26 August 2013. Couples en Europe, Le droit pour les couples dans 27 pays européens, Suède.
- Sur certaines incohérences au sujet du contenu du patrimoine à partager, voir les critiques rapportées par C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., p. 150 et suiv.
- Voir C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage, op. cit., p. 110 et suiv.; Maarit JÄNTERÄ-JAREBORG (2002), University of Uppsala (October), Grounds For Divorce And Maintenance Between Former Spouses, Sweden, Commission on European Family Law, Divorce/ Maintenance, Reports by Jurisdiction, p. 17 et suiv. Rappelons que les Suédoises sont très actives sur le marché du travail. Voir Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012, op. cit. Les femmes immigrantes éprouvent plus de problèmes à intégrer le marché du travail. Ce principe du clean break les affecterait davantage.
- La « résidence familiale » (joint dwelling of the spouses) est cependant protégée. L’époux propriétaire de la « résidence familiale » ne pourrait pas la vendre sans l’autorisation de l’autre conjoint non propriétaire. Il peut s’agir d’une copropriété, d’un immeuble ou d’un bail résidentiel. Chap. 7 art. 4, Code du Mariage. Les meubles meublants (joint household goods) sont aussi protégés. Pour une traduction anglaise du Swedish Marriage Code : en ligne : http://ceflonline.net/wp-content/uploads/sweden-divorce-legislation.pdf (Page consultée le 25 novembre 2013).
- Le régime matrimonial prévu par le Code du mariage est la communauté de biens différée. Tous les biens d’un époux sont réputés « biens matrimoniaux », à l’exception des biens suivants qualifiés de « biens propres » : les biens déclarés propres par contrat de mariage; les biens que l’un des époux a reçus d’une personne autre que son conjoint à titre de don ou d’assurance sous la condition qu’ils seront biens propres, ou par testament sous la même condition, soit à titre de légataire, soit à titre d’héritier; les biens qui sont acquis en remplacement des biens propres, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement par l’acte qui les a constitués biens propres. Les fonds de retraite étatiques et de l’employeur ne font pas partie de la communauté de biens, chap. 10, art. 3, Code du mariage. Voir Maarit JÄNTERÄ-JAREBORG, Margareta BRATTSTRÖM et Kajsa WALLENG (2008), Uppsala University (October), Property relationship between spouses – Sweden, Commission on European Family Law.
- Ceci est possible depuis le 1er janvier 2008. Eva Gabrielsson, la veuve de l’auteur suédois de la trilogie Millenium Stieg Larsson, n’a pas hérité de la fortune de son conjoint de fait après 32 ans de vie commune. Larsson est mort à l’âge de 50 ans (en 2004), après avoir soumis ses trois romans à son éditeur. Il est décédé sans testament et selon les lois suédoises, son père et son frère ont hérité de sa fortune estimée à 40 millions de dollars américains.
- Swedish Marriage Code, art. 3, adopté en 1987.
- Au cours du mariage, ils peuvent modifier ce contrat et réintégrer certains biens dans la communauté.
- Property (Relationships) Amendment Act, 2001(N.Z.), entré en vigueur le 1er février 2002, qui modifie le Matrimonial Property Act, 1976 (N.Z.) qui s’intitulera désormais Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). À ce sujet, voir Bill ATKIN (2003), « The Challenge of Unmarried Cohabitation – The New Zealand Response », 37 Family L Quarterly 303; Bill ATKIN (2008), « The Legal World of Unmarried Couples - Does The New Zealand Approach Shed any Light on the Future? », 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 793; Nicola PEART (2008-2009), « The Property (Relationships) Amendment Act 2001 : A Conceptual Change », 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 813; Virginia GRAINER (2002), « What’s Yours Is Mine: Reform of the Property Division Regime for Unmarried Couples in New Zealand », 11 Pac. Rim L. & Pol’y J. 285; Peter BOSHIER (2008), « Is there a Yardstick of Equality in our backyard? », 13th National Family Law Conference, Adelaide Convention Centre, (8 April).
- Property (Relationships) Amendment Act, 2005 (N.Z.), entré en vigueur le 26 avril 2005. À ce sujet, voir Graeme W. AUSTIN (2006), « Essay: Family Law and Civil Union Partnerships – Status, Contract and Access to Symbols », 37 Victoria U. Wellington L. Rev. 183.
- Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act, 2013 (N.Z.), entré en vigueur le 19 août 2013.
- En Nouvelle-Zélande, le taux de mariage est en baisse depuis 1971; le taux de divorce est aussi en baisse. En 2012, 78 % des unions civiles ont été enregistrées par des couples de même sexe. Selon le recensement de 2006, deux hommes et femmes sur cinq, âgés de 15 à 44 ans et qui vivaient en couple, n’étaient pas mariés. Voir les statistiques de 2012, Statistics New Zealand, en ligne.
- Art. 4(5) Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). La période de trois ans a été retenue parce que les mariages ou les unions civiles de moins de trois ans sont traités différemment par la loi. Dans ce cas, il n’y a pas un partage égal du patrimoine. Art. 14 Property (Relationships) Act, 1976.
- Art. 2D (2) et (3) Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). Les relations amicales ou fraternelles sont exclues. Voir spécialement pour certains problèmes dans cette détermination, B. ATKIN, « The Legal World of Unmarried Couples - Does The New Zealand Approach Shed any Light on the Future? », op cit.
- Sauf s’il y a un enfant issu de cette union. Sur les recours de common law, voir B. ATKIN, « The Challenge of Unmarried Cohabitation – The New Zealand Response », op. cit.
- Certaines règles particulières s’appliquent en cas du décès d’un des conjoints. Art. 88 Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.).
- Sauf exception, par exemple en cas de circonstances extraordinaires, art. 13 Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.).
- Property Law Act, 1952 (N.Z.), art. 40A.
- Partie 6, Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.).
- N. PEART, « The Property (Relationships) Amendment Act 2001 : A Conceptual Change », op. cit., p. 825.
- Art. 21 E Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). Voir la Schedule to the Property (Relationships) Model Form of Agreement Regulations 2001 (SR 2001/177).
- Art. 24 Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). Le tribunal peut proroger le délai.
- Art. 15 et 15A Property (Relationships) Act, 1976 (N.Z.). Voir Bill ATKIN (2007), « Economic Disparity – How did we end up with it? Has it been worth it? », 5 NZFLJ 299; Joanna MILES (2004), « Financial Provision and Property Division on Relationship Breakdown : A Theoretical Analysis of the New Zealand Legislation », 21 NZULR 268.
- La forme notariée s’applique déjà pour les contrats de mariage et l’union civile – articles 440 et 521.8 C.c.Q.
- Ces données ont été révisées le 29 juillet 2014.